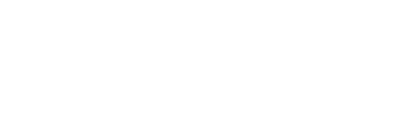L’essence du cinéma, l’évolution de sa place dans le monde des images sont l’objet de réflexions profondes, menées de par les siècles par nombre de revues et de figures. Le fil des images propose une synthèse de ces réflexions.
Publié le 30/11/2016, Mis à jour le 07/05/2023
Rédiger une critique de film compte parmi les activités pédagogiques liées à la transmission du cinéma à l’école. Le principe est d’inviter les élèves à mettre en mots leur compréhension d’un film et les impressions qu’il lui a fait éprouver. Certes, l’exercice exige de leur part de s’acquitter des informations nécessaires sur l’œuvre. Bien plus, il leur demande de formuler une analyse qui s’appuie sur leur expérience de spectateur et de leur culture cinématographique. Un film s’inscrit dans la continuité de l’histoire du cinéma, résonne avec d’autres films, du même auteur ou non ; il s’inspire d’un courant, d’un style, d’un genre propre à une époque ou un pays. L’enjeu d’une critique porte l’écrit qui en résulte bien au-delà de l’exercice de résumé et de l’expression d’une opinion à l’emporte-pièce.
Dans le cadre de l’école, la rédaction de la critique consiste moins à reproduire un travail journalistique qu’à s’efforcer de témoigner d’un regard averti et sensible sur l’art de la réalisation. Par ailleurs, l’histoire et l’actualité de la critique est marquée par des revues et des figures. A ce titre, elle inspire une approche textuelle : certains articles critiques pourraient, par leurs qualités littéraires et la philosophie qui les porte, être étudiés comme tels. Ils témoignent d’une réflexion au long cours sur l’essence du cinéma et l’évolution de sa place dans le monde des images. Le texte ci-après propose une synthèse des réflexions inspirées par l’activité critique en s’appuyant sur des références anciennes et récentes issues du centre de ressources de la Maison de l’image de Strasbourg.

Ce qui est souvent reproché aux élèves quand ils se livrent à l’exercice de la critique – ne parler du film que par son scénario et ses personnages, se contenter d’un j’aime-j’aime pas – l’a été aux journalistes eux-mêmes, en particulier ceux de la presse généraliste. Dès 1967, leur habitude de donner des notes plutôt que de s’expliquer par un argumentaire était dénoncée par Pierre Ajame : « Les directeurs de journaux diminueront progressivement la surface des rubriques jusqu’à les réduire aux stupides étoiles de Paris-Match où, chaque semaine, deux ou trois adjudants décorent ou dégradent selon des critères d’épiciers [1]». Plus de vingt ans plus tard, François Truffaut déplorait que les critiques en restaient au « niveau du ‘Allez-y’ ou ‘N’y allez pas’[2] »). En 1973, Michel Mardore appelait les partisans du « contenu – contenu » ceux qui « se moquent des problèmes esthétiques » et « s’en tiennent au discours [3]». Il opposait la critique « qui paraphrase le contenu des films » à celle dont il se réclamait, qui, d’un film, tâche « de tout mettre à jour, y compris l’inconscient [4]. » De même, en 1981, Jean Mitry se plaignait que les critiques se limitaient au traitement du sujet, des situations, des personnages. Aujourd’hui encore, ces reproches et regrets restent valides, y compris concernant les sites strictement commerciaux ou les blogs amateurs consacrés au cinéma.
Pourtant, les enjeux essentiel de la critique de films restent les mêmes, à savoir :
- La critique propose un regard sur le cinéma en tant qu’art
- La critique caractérise le style du film traité par une analyse du langage cinématographique qu’il a mis en œuvre
- La critique, depuis son approche du film en jeu, montre en quoi il témoigne de l’état présent de notre société,
- La critique est une activité littéraire, employant les mots pour évoquer ce qui passe par les images et les sons
En cela, elle peut être employée comme un exercice scolaire au même titre que la rédaction, le commentaire de texte, la dissertation… articulant savoir cinéphilique, sens de l’analyse des images, et sensibilité personnelle au style des œuvres cinématographiques. Voire, elle peut ouvrir à une réflexion d’ordre philosophique, requiert l’organisation de la pensée et la maîtrise de l’écriture.
Ecrire une critique c’est s’ouvrir à celle des autres, s’intéresser à leurs formulations autant qu’à leurs contenus, entrer dans la grande conversation esthétique que le cinéma inspire depuis les années 20 et que son actualité ne cesse d’alimenter. C’est d’une part prendre l’habitude de lire les articles critiques dans la presse spécialisée et sur le net. C’est aussi se pénétrer de la littérature dont sont responsables certains théoriciens qui ont pensé le cinéma en rédigeant des critiques comme de véritables essais. De même qu’une composition de lettres est supposée attester de la fréquentation de la littérature, la rédaction d’une critique imite les exemples professionnels et se nourrit de la pensée du cinéma par la connaissance de ses figures et de leurs œuvres. Enfin, l’exercice répété de la critique incite à l’analyse du film, à un regard averti sur le cinéma qui se fait ou s’est fait, nourrit la curiosité pour ses nouvelles formes.
Insérer le jugement sur l’œuvre dans une réflexion sur l’art
La tradition de la critique remonte au XVIIIe siècle avec l’organisation de salons qui, concentrant l’actualité de la peinture, permettaient de l’appréhender et d’en débattre. Dans ce contexte, Diderot, engagé par une revue indépendante, L’Observateur littéraire, peut appliquer ses conceptions de l’art à son observation des tableaux exposés sans craindre de censure. Il écrit « sans avoir égard au nom, ni à la réputation des peintres, ni au rang qu’ils occupent. » Il suivra dans ces conditions trois salons, ceux de 1759, 1761, 1763. Dans ses compte rendus s’élabore le langage critique : articulation de réflexions de fond avec des jugements faits sur pièce, revendication de l’approche subjective, style souvent familier pour dynamiser la lecture : « Beaucoup de tableaux, mon ami, beaucoup de mauvais tableaux. ». Sur quoi s’appuie Diderot pour juger la peinture des autres, alors qu’il n’est pas peintre lui-même ? Sur sa capacité d’observation, sa culture en la matière, enfin sur son talent d’écrivain pour restituer et faire partager une impression : l’écriture, le maniement des mots est le moyen d’évocation et d’analyse des images, celui qui reste en vigueur aujourd’hui.
Un siècle plus tard, un nouveau grand nom marque l’histoire de la critique : Charles Baudelaire qui, admiratif du travail de Diderot, entreprend de suivre des salons de peinture à partir de 1845 pour son propre compte et non dans les pages d’une revue. Baudelaire cherche à son tour à faire de la production contingente l’aliment d’une réflexion qui dépasse le temps de l’immédiateté, une critique renvoyant à une autre, s’inscrivant dans la continuité d’une méditation sur la production d’une époque. Diderot, qui encourageait l’observation de la nature, avait à cœur de rappeler dans quels contextes politique et social se produit l’œuvre d’art. De même, Baudelaire cherchait à travers les œuvres rencontrées les indices de la modernité autant que l’expression du beau, établissant une tension entre la quête de l’éternel et la volonté de faire époque. En cela, Diderot et Baudelaire ont élevé le critique au rang d’écrivain et de penseur, dont les écrits font autorité. Leur démarche annonce celles d’André Bazin ou de Serge Daney qui ont transcendé leur condition de critique par leur volonté de plier l’élaboration de leurs textes à la poursuite de questionnements esthétiques sur le cinéma. Les éditer aujourd’hui, c’est faire de leur réunion la substance d’un essai (ainsi, l’édition des critiques de Bazin est intitulé : Qu’est-ce que le cinéma ?) : le film approché n’est pas une fin en soi, il alimente une réflexion qui le devance et le dépasse. C’est pourquoi nous lisons aujourd’hui un article de Bazin sur un film de Roger Leenhardt qu’il n’est plus possible de voir : l’objet de notre curiosité est moins l’œuvre en cause que la méditation esthétique qu’elle sous-tend.

Préparer le jugement de la postérité
Dans son introduction, Baudelaire voit le critique comme une instance de tri qui affronte le tout-venant pour éclairer le public, considéré comme le plus large : « Nous parlerons de tout ce qui attire les yeux de la foule et des artistes – la conscience de notre métier nous y oblige.- Tout ce qui plaît a une raison de plaire et mépriser les attroupements de ceux qui s’égarent n’est pas le moyen de les ramener là où ils devraient être. » Pas de snobisme, pas de choix élitiste, mais un regard qui embrasse la production dans son abondance, y compris les choix populaires, démarche qui sera reprise dans les revues cinéphiles comme Les cahiers du Cinéma ou Positif qui n’hésitent pas à traiter des blockbusters pour juger leur valeur et tenter d’expliquer les ressorts de leur succès.
Dès le temps des pionniers, la fonction critique se fonde sur un double manque : le public, qui n’a pas eu accès à l’œuvre, ou pas encore, cherche à s’en faire une idée ; l’œuvre appelle un discours entre analyse et jugement pour s’accomplir comme objet esthétique. Pour Jean Douchet, une œuvre non désignée, non commentée est condamnée au sommeil, qu’elle soit ou non largement diffusée. « La courte histoire du cinéma abonde ainsi d’exemples de films regardés par des millions de spectateurs et pourtant complètement méconnus. Il a fallu révéler Murnau et Keaton, comme Lang, Hitchcock, Walsh, Hawks, Losey, etc. (…) Considérée sous cet angle, le seul possible d’ailleurs, la critique devient synonyme d’invention, dans le sens courant du terme et dans celui de la découverte [5]. » Jean-Michel Frodon poursuit la même idée en la nuançant. Il rappelle qu’une œuvre d’art, avec des moyens matériels très divers, « s’adresse à notre imaginaire par le biais de nos sens, pour susciter des réactions qu’elle ne contient pas toutes entières elle-même. Une œuvre d’art est un objet troué, où il ya du manque, un espace ouvert que chacun de ceux qui le recevront comblera à sa manière (…) la définition même de l’œuvre d’art est de ne pas être finie, c’est son spectateur qui la complète par lui-même [6]. » Observation qui reprend l’affirmation de Duchamp selon laquelle une œuvre d’art se termine dans le regard du spectateur.
Respecter le travail du cinéaste
Pour Douchet, la tâche du critique consiste aussi dénoncer les « fausses gloires » parmi les réalisateurs, même ceux qui connaissent un succès aussi massif qu’éphémère. Pour Frodon, il lui appartient d’authentifier l’œuvre d’art en identifiant l’ouverture qu’elle est supposée receler ou bien de dénoncer une « fausse œuvre » qui ne serait rien d’autre « qu’une prise de pouvoir sur les esprits ». Nous retrouvons la logique de tri que Baudelaire voulait assumer en se mettant à l’épreuve de la globalité d’une production, sans choix préalable. Vigie intellectuelle, le critique identifie l’émergence de courants innovants, détecte la naissance de nouveaux talents. Ce faisant, il prépare l’histoire, devance le travail de la postérité.. Pour Frodon, l’écrit critique seconde le travail de création en aidant à sa réception : « chaque œuvre repose le défi de sa propre ouverture, des ressources de ses incomplétudes pour ceux qui sont conviés à y entrer. C’est pourquoi, tant qu’il y aura des œuvres, le travail critique aura à s’effectuer. ». Cette fonction fait du critique un partenaire du cinéaste, attentif à la spécificité de son style et respectueux de sa démarche. Pour chacun d’eux, la création cinématographique est un enjeu fondamental. A cet égard, critique et cinéaste entretiennent une relation étroite, nourrie d’attentes mutuelles. Certes, les journalistes peuvent écrire en toute insouciance depuis qu’un arrêt de la Cour d’appel de Paris, en décembre 1930, a établi juridiquement le « droit à la critique » dans les journaux français, qui les protège de poursuites pour diffamation ou en calomnie [7].
Cependant, ils sont appelés à prendre en considération cette relation épidermique que l’artiste entretient avec son travail, à tenir compte des efforts que celui-ci a coûté et de l’enjeu personnel qu’il représente. Rappelons-nous cette scène du « Van Gogh » de Vicente Minelli : « tu peinds trop vite ! » assène Gauguin, « Et toi, tu regardes trop vite ! » lui répond Van Gogh. Le respect critique, c’est à la fois avoir conscience de ce que représente le travail de création. Ceci implique que le critique ait une conscience aigue de la réalité de la fabrication d’un film, qu’il garde à l’esprit la phrase de Philippe Garrel : « Le cinéma, c’est difficile à faire ». Certains critiques comme Alain Bergala ont intensément fréquenté les plateaux de tournage pour devenir intimes des enjeux de la réalisation et découvrir, au moment où elles se prennent, les options de sa mise en œuvre.
Un exercice d’écriture
Comme le remarquait François Truffaut : « Tout le monde a deux métiers : le sien et critique de cinéma ». Le cinéma favorise chez ceux qui ont vu le même film un partage de réactions à chaud. Chacun, fort des émotions qu’il a ressenties, les exprime spontanément dans le feu de l’échange. L’approche critique est différente parce que, passant par l’étape de l’écriture, elle n’est plus, selon Frodon, « dans ce rapport d’immédiateté au film et aux émotions qui caractérise la parole proférée au sortir d’une projection. » L’élaboration du jugement par l’écriture impose un recul nécessaire pour ne pas passer à côté de la substance du film, d’autant que c’est un exercice solitaire déchargé de la pression qu’exercent les enjeux de la conversation. La presse écrite reste à ce titre le lieu privilégié de la critique. Aboutir un commentaire critique requiert la combinaison de deux compétences :
- Compétence journalistique : recueillir les informations nécessaires sur le film, connaître le parcours du réalisateur, des comédiens, du scénariste…, identifier des tendances, des écoles, des courants pour pouvoir situer chaque film auquel il a affaire. Comme l’affirme Jean-Louis Bory il faut que le regard du critique soit mu par une curiosité insatiable et la faculté de garder une disponibilité d’esprit pour les films à découvrir. Chaque séance est l’opportunité d’une initiation : « La première tâche du critique de cinéma c’est de (commençant par lui-même) débarbouiller les yeux et oreilles des taies du cérumen, que sont nos habitudes et qui nous empêchent, regardant, de voir, écoutant, d’entendre. Pareille toilette – j’allais dire « hygiène » – sans quoi il n’y a pas de bon spectateur de films, demande patience et sinon longueur, parcelle de temps. La fréquentation de nombreux film s, et divers, y est nécessaire : commerce qu’il faut bien appeler – j’en suis confus, me pardonnera-t-on cette obscénité ? – culture cinématographique [8]»
- Compétence esthétique : elle requiert une expression structurée de l’émotion éprouvée, quitte à employer le « je » qui, de manière générale, est exclu de la rédaction journalistique, voire à se risquer à des innovations de langage qui rapprochent le résultat écrit de la littérature. Comme le rappelle Prédal, « il faut du style, un vrai bonheur d’expression susceptible de procurer un plaisir de lecture » [9]. Tout critique dont les écrits sont encore lus une fois passé l’actualité des films qu’il a traités a montré d’authentiques talents d’écrivain. D’ailleurs, des hommes de lettres ont continué de faire œuvre d’écriture en poursuivant une activité de critique. Symétriquement, des critiques ont atteint le statut d’hommes de lettres par l’investissement littéraire dont ils ont fait preuve en parlant cinéma.
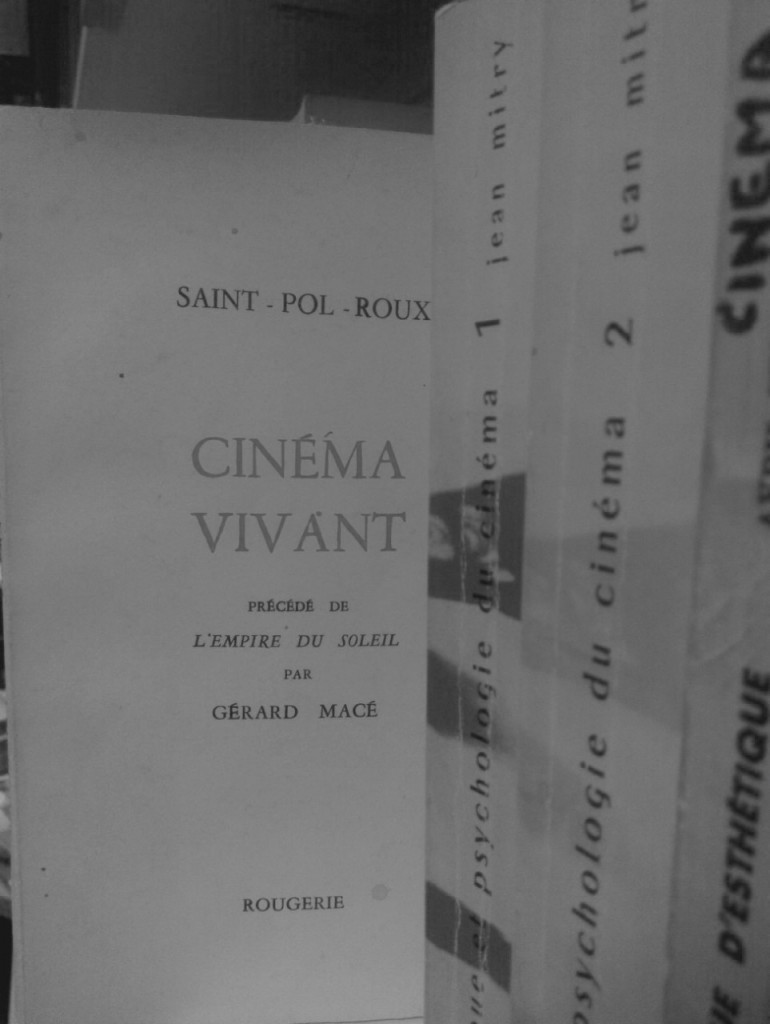
Les regards de la critique sur le cinéma au cours de son histoire
La critique cinématographique a souvent mobilisé des écrivains et des intellectuels qui ont accueilli avec enthousiasme l’émergence du cinéma, y voyant un fait culturel nouveau, qui contribue à caractériser l’époque. Autant qu’aux films eux-mêmes, ils se sont intéressés à la façon dont leur exploitation a façonné le paysage urbain et généré de nouvelles pratiques. Certains ont aimé le cinéma pour sa poésie involontaire, ses récits rocambolesques, ses images insolites. D’autres ont cherché à l’imposer comme un art à part entière, aussi digne d’attention que la peinture. Après la Seconde Guerre Mondiale, le cinéma a acquis cette reconnaissance à laquelle ils ont contribué. Elle génère une culture spécifique appelée « cinéphilie », qui requiert un discours non plus de dilettante mais de spécialiste.
Le cinéma comme un spectacle poétique et enchanteur
La faculté du cinéma de reproduire le réel et de détourner ses représentations par des artifices, sa créativité narrative qui puise dans les figures de l’ellipse ou du dédoublement de l’intrigue, inspirent des spectacles inouïs, du jamais vu qui se manifeste au cœur de tel ou tel film, parfois à son insu. Le cinéma, facteur de merveilleux, parfois fortuit, c’est ce que guette le poète à chaque film qu’il va découvrir : « Ce que nous demandons au cinéma, écrit Robert Desnos dès les années vingt, c’est l’impossible, c’est l’inattendu, le rêve, la surprise, le lyrisme qui efface les bassesses dans les âmes et les précipitent enthousiastes aux barricades et dans les aventures ; ce que nous demandons au cinéma c’est ce que l’amour ou la vie nous refusent, c’est le mystère, c’est le miracle [10]. » Surréaliste comme Desnos, Philippe Soupault a aussi écrit de nombreuses chroniques sur le cinéma, avec le même mélange de ferveur et d’exigence, la même intensité d’attente. Soupault et Desnos se sont enthousiasmés pour Chaplin, les burlesques, et surtout Les vampires ou Fantômas, films d’aventures rocambolesques qu’on qualifierait aujourd’hui de série B. Dans leurs écrits, il s’agit moins de rendre compte d’une œuvre que d’attirer l’attention sur les fulgurances de poésie qu’elle a su générer, de préférence sur le fond d’un quotidien qu’elle vient enchanter. Ecoutons Desnos : « Et tandis qu’à travers les rues désertes d’un Paris en proie aux démences belliqueuses nous quêtions le droit aux aventures ténébreuses de l’amour, sous un ciel déchiré par les projecteurs et les éclatements d’obus, savions-nous que, notre désir de fuite et d’évasion, nous le retrouverions à la suite de Pearl White, dans les randonnées automobiles des Mystères de New York et les luttes factices entre une police de pacotille et des bandits mirobolants ? [11]» Soin de l’écriture portée à la plus haute tenue littéraire, devenue poésie, loin du compte rendu journalistique. Cependant, nous sommes loin de la défense d’un cinéma d’auteurs. Le regard du poète privilégie volontiers les artisans anonymes de films dont la facticité de la mise en scène et l’invraisemblance des situations favorisent, émancipent des codes de l’académisme (défendus par les « médiocres rhéteurs » selon Desnos), préservent des prétentions esthétiques et psychologiques (Desnos détestait les films de Gance ou de Griffith), et ceci à leur corps défendant.
Autre écrivain de cinéma, Jean Cocteau a lui aussi trouvé dans l’espace de la chronique une occasion d’écriture. Comme ses pairs surréalistes, Cocteau se soucie peu de raconter le film, présenter les informations nécessaires sur son auteur et sa production. Ce qui le presse d’écrire à son sujet, c’est telle ou telle séquence qui a frappé son attention, résonnant d’une façon ou d’une autre avec son imaginaire quand bien même il s’agirait d’un documentaire sur les abattoirs comme Le sang des bêtes que Franju a réalisé en 1954. « Jamais vous n’oublierez l’interminable péniche pavoisée de linges ou de linceuls dans la morgue des bêtes, linceuls qui sont leur propre peau [12]. » Ici, l’évocation du film inspire une écriture poétique. Quel qu’en soient le sujet et les auteurs, tout cinéma sur lequel Cocteau écrit devient du Cocteau, comme fabriqué à dessein pour alimenter son écriture. D’une façon générale, ces différents textes se caractérisent par un style aérien, virevoltant, elliptique, épousant la dynamique propre au spectacle cinématographique.
Le cinéma, art du XXe siècle
Divertissement de masses et enjeu économique important, générateur de discours publicitaire et de médiatique, le cinéma peut-il être comparé à la peinture, la sculpture, etc. ? Pour Riccioto Canudo, philosophe et critique d’art, la réponse est oui dès 1922 avec son Manifeste des sept arts, qualifiant le cinéma d’ « art de totale synthèse, nouveau-né fabuleux de la machine et du sentiment. » Cette reconnaissance est confortée dans les mêmes années vingt par plusieurs créateurs qui combinent discours théoriques et réalisations avant-gardiste, situant résolument le cinéma dans le pur univers des formes. Parmi eux, Germaine Dulac, Jean Epstein, Louis Delluc… qui laissent des écrits décisifs dans les nombreuses revues de cinéma qui émergent alors. Faire admettre le cinéma au rang des arts sera un combat de longue durée qu’il revient à la critique de mener, contribuant à fonder ses interventions dans l’espace public : « Tant que le public ne verra dans le cinéma qu’un ‘spectacle’, écrit le théoricien Jean Mitry en 1954, tant qu’il ne le considèrera que comme une distraction du dimanche sans chercher à y reconnaître une valeur d’art, toute critique sera inutile, toute analyse absolument vaine. (…) Que le spectateur commence par considérer le film comme une œuvre d’art possible, telle est la première condition d’existence d’une critique digne de ce nom [13]». Cependant, le souci de justifier le cinéma comme art ne risque-t-il pas de lui ôter les notions de plaisir et d’émotion qui lui sont associées ? Le cinéma doit-il être destiné à un public spécialisé, élitiste à ce titre, comme le sont devenus les Beaux-Arts ? La revue du cinéma, fondée par Jean-Georges Auriol va vivement critiquer les théories avant-gardistes dont elle est contemporaine. Il s’agit de s’opposer à une tendance esthétisante, intellectualisante qui s’est emparée du discours sur le cinéma. Par conséquent, d’écrire autrement à son sujet : « On renonce à la lecture de ces phrases tirebouchonnées et on envoie au diable ce faux pastiche du pire style critique où les mots sont continuellement pipés et vidés de toute signification [14] ». Il s’agit de revenir à une approche prioritairement sensible aux films, qui est celle du public populaire qui fréquente le cinéma. Pour Auriol et son équipe, les critiques doivent se considérer comme de simples « spectateurs délégués », c’est à ce titre qu’ils rédigent leur revue. Leur mise en garde contre le snobisme qui guette la passion pour le cinéma annonce les reproches qui seront adressés à certains discours cinéphiles des années soixante et soixante-dix, considérés comme asséchants et exclusifs.
Approche spécialiste : la cinéphilie
L’activité critique à l’égard du cinéma, à force de se développer, génère des points de vue de spécialistes et une écriture spécifique. Elle évolue dans un nouveau contexte qui tient à deux éléments :
- La revue : La revue du cinéma est un exemple pionnier de ces nombreuses revues qui se consacrent au cinéma, son actualité, ses figures, ses courants. Pour se distinguer des autres et pour nourrir le débat avec elles, une revue dessine une ligne éditoriale précise qui détermine le recrutement du personnel de rédaction, le choix des dossiers, l’approche de chaque film. L’histoire de la critique de cinéma est traversée par la polémique qui oppose Les cahiers du cinéma et Positif, chacune d’eux ayant longtemps suscité une école étanche au sein de son lectorat. Alors que les Cahiers ont supporté avec enthousiasme La Nouvelle Vague, mouvement qui a révolutionné l’approche de la réalisation en France, Positif est resté sceptique sur la qualité de ses films et la réelle portée de ses dogmes. René Prédal rappelle les autres point de divergence entre les deux revues : « Les Cahiers occultent en général la politique alors que Positif y fait plus fréquemment référence (…) Les Cahiers privilégient la notion de mise en scène en tant que regard porté par l’auteur sur son histoire, tandis que Positif part plutôt des sujets abordés par les films. La différence d’optique définit les deux grandes attitudes qui divisent la critique française : partir de l’auteur pour aller au film (Cahiers) ou du film pour remonter à l’auteur (Positif) [15].»
- La salle : n’oublions pas que c’est le premier lieu de rencontre avec le film. Avant l’apparition de la VHS qui a favorisé la diffusion des films en dehors des circuits des exploitants, le rapport à ceux-ci était ponctuel, voire unique, et souvent partagé avec le public venu les découvrir. Ces conditions ont certainement influencé l’écriture des critiques. Par ailleurs, la salle est devenue la matrice de la cinéphilie. De nombreux passionnés se sont donnés rendez-vous à la Cinémathèque où officiait Henri Langlois, passeur exceptionnel de l’histoire du cinéma. Rester dans la salle, échanger sur les films vus, c’est pouvoir écrire dessus, non pas isolément, mais porté par une dynamique de groupe. Une ferveur commune la caractérise, d’essence quasi-religieuse, voire sectaire, codifiée par des références exclusives à ceux qui ont fréquenté les mêmes salles, assisté aux mêmes séances, écouté le même maître.
Le cinéma ayant acquis son autonomie en tant qu’art, multipliant les courants, développant les controverses, inspire des passions exclusives : des personnes se font critiques pour explorer le cinéma comme monde esthétique intègre et cohérent. Leurs contributions successives, plus ou moins stimulées par l’actualité de la production, cherchent à répondre à la question fondamentale : Qu’est-ce que le cinéma ?
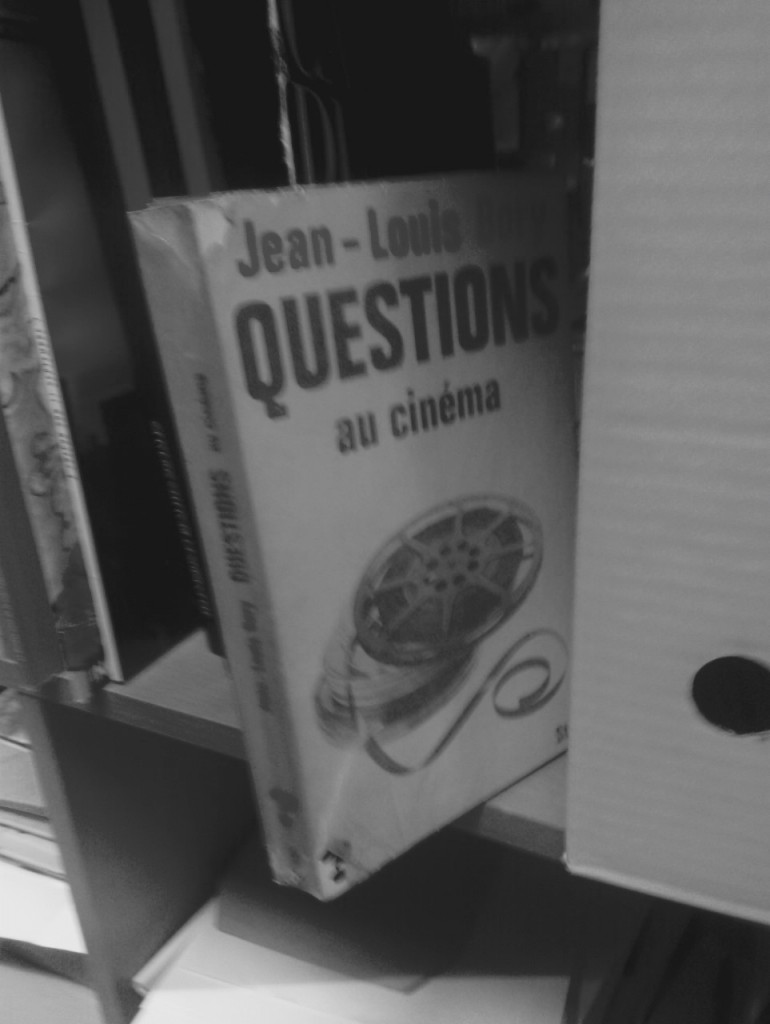
De Bazin à Daney
Deux figures se détachent parmi cet ensemble de critiques-théoriciens : André Bazin et Serge Daney, l’un constituant en quelque sorte le parrain de l’autre. Chacun d’eux a édifié une œuvre littéraire et mené une activité intellectuelle depuis le cinéma, avec le souci de partager leurs idées avec le plus grand nombre par leurs écrits et une constante disponibilité à la conversation. Chacun d’eux a participé à la grande aventure médiatique des Cahiers du cinéma, contribué à en faire un espace de théorie qui brasse toute l’histoire du cinéma en même temps qu’il en sonde l’actualité, défend le statut de l’auteur et assume une subjectivité enthousiaste. Chacun d’eux s’en est tenu au rôle de critique sans passer derrière la caméra, au contraire de nombre de leurs confrères dont Eric Rohmer, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, François Truffaut qui constitueront la première génération de la Nouvelle Vague, ou plus tard Jean Eustache ou encore Olivier Assayas. Ainsi, Bazin et Daney ont montré tour à tour qu’une vision du cinéma pouvait ne pas s’incarner par des œuvres, rester à l’état de pensée, jouer une influence déterminante depuis les mots qui la formulent sur les images des autres : Truffaut, Godard ou Rivette se réclamant de Bazin, Olivier Assayas, Benoît Jacquot ou Xavier Beauvois affirmant leur profonde intimité avec la pensée de Daney. Mots écrits et paroles : Daney et Bazin ont été l’un et l’autre des infatigables parleurs, toujours disponibles pour poursuivre la conversation sur un film, cherchant auprès de l’interlocuteur un partenaire qui, dans la dynamique d’un ping-pong verbal, anime les idées et aide à les aboutir. Assayas affirme que pour Daney, le film approché « est un symptôme du cinéma » : c’est le cinéma le premier lieu de réflexion, son essence, son état, son actualité, son éternité. D’autres critiques ne partagent pas ce point de vue, ainsi Jean-Louis Bory, qui, pourtant, a souvent privilégié les œuvres confidentielles et a montré une grande exigence dans leur approche : « Un film, pour moi, c’est quelque chose de vivant, écrit-il. Chaque film renouvelle l’aventure. Aucun concept du cinéma-en-soi, aucun dogmatisme a priori ne m’embarrasse. Ce n’est pas le cinéma qui existe d’abord, ce sont des films. » [16]. A noter que Bory a écrit dans Le nouvel observateur : le contexte d’une revue généraliste favorise l’approche du film comme événement d’un agenda culturel, rend plus difficile une réflexion au long cours sur l’art qui le porte.
Pour Bazin comme pour Daney, il y a un cinéma en soi, dont ils cherchent les exemples d’un film l’autre, plus particulièrement auprès d’auteurs dont ils ont identifié un style approprié pour l’exprimer. Ce cinéma est un art du réalisme. André Bazin ne quitte jamais de l’esprit que, contrairement aux arts qui l’ont précédé, le cinéma, qui procède de la photographie, produit des images depuis un système mécanique qui enregistre la réalité. « Le dessin le plus fidèle, écrit-il, peut nous donner plus de renseignements sur le modèle, il ne possèdera jamais le pouvoir de la photographie qui emporte notre croyance.(…) La photographie ne crée pas comme l’art, de l’éternité, elle embaume le temps, elle le soustrait à sa propre corruption. » [17]. Le cinéma, mieux encore que la photographie puisqu’il la met en mouvement, donne à voir « les vérités de la nature ». Bazin a aimé Renoir, le néo-réalisme et Flaherty pour avoir réalisé des films qui ont accueilli le réel par un effacement décidé du réalisateur. Leur cinéma tend, selon les mots de son biographe Dudley Andrew, vers « un documentaire créatif » [18]. Le berceau de l’imaginaire cinématographique reste les premiers films de cinéma, ceux tournés par les Frères Lumière : plan fixe qui, dans sa durée d’une unique minute, laisse advenir, comme un piège tendu, l’événement inouï qui va faire récit. A la suite de Bazin, comme son héritier, Daney a défendu un cinéma attentif à ce qui advient au tournage sans être planifié. Il en fait une question éthique, considérant le cinéma héritier des Lumières comme le celui qui permet d’accueillir le spectateur, de solliciter son interprétation dans les interstices de ses plans : « L’enregistrement (Lumière) a, immédiatement, une dimension morale. Puisqu’il est impossible de prévoir de ce qui s’inscrira sur la pellicule, reste à s’accommoder de ce qui vient ‘en plus’. Divines surprises, scories, symptômes objectifs, vérifications et preuves, mauvaises surprises, pointes de réel empêchant l’imaginaire de se clore, prétextes à dialectiques de tous ordres, etc. Le cinéaste regarde une fois, et, passif lui aussi, tient compte du mixte de ce qu’il a restitué (comme vision) et de ce qu’il n’a pas voulu (comme réel, appel de l’Autre) [19]. » Selon le témoignage d’Assayas dans un documentaire consacré à Daney, celui-ci préconisait, au moment du tournage, de faire durer le plan au-delà de l’intention du réalisateur, pour que de semblables présents du réel se produisent devant la caméra qui l’enregistre [20]. Daney s’est intéressé à Kiarostami ou Gitaï qui s’inscrivaient dans la filiation de Rossellini, avec un cinéma pauvre qui exalte le réalisme auquel il se tient.
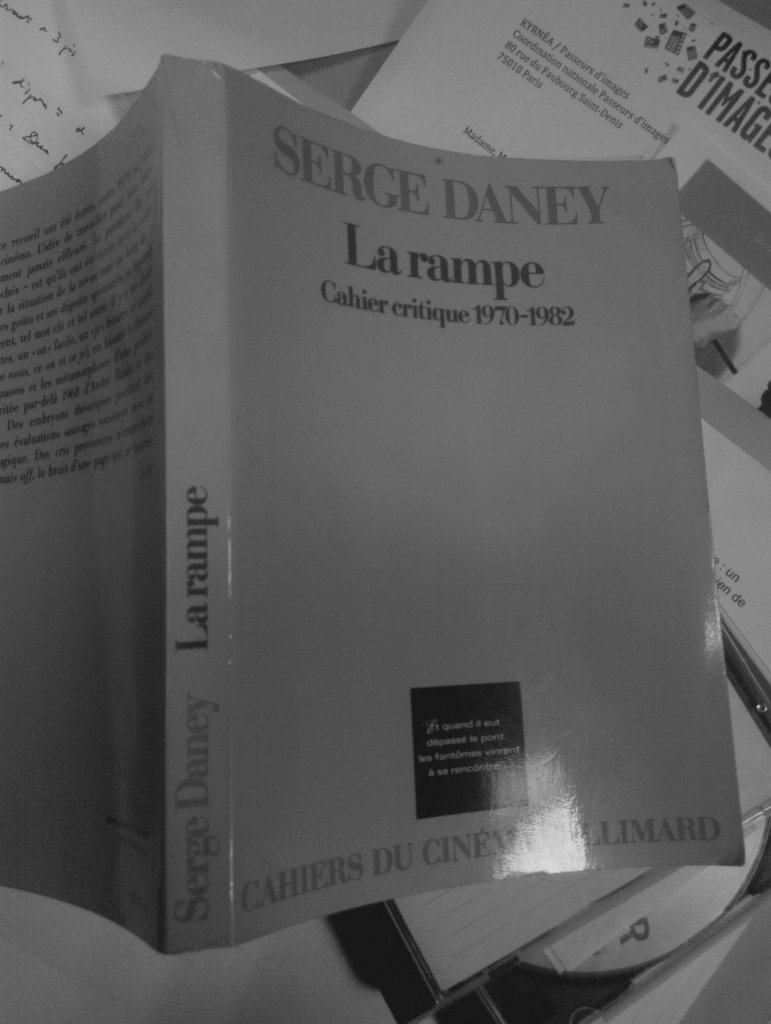
Ecrire sur le cinéma à l’ère de la vidéosphère
En même temps, les parcours de Bazin et Daney se démarquent l’un de l’autre par le simple fait qu’ils ne sont pas contemporains, appartenant à deux générations différentes, deux moments de la société française. Entre-temps, le paysage audiovisuel a connu une révolution qui détermine une nouvelle ère de notre civilisation. Régis Debray l’a appelé « la vidéosphère », la faisant commencer avec l’apparition de la télévision en couleurs : désormais c’est le visible qui fait partout autorité, au moyen d’une diversification de supports médiatiques qui saturent notre environnement d’images [21]. C’est sans doute pourquoi Daney, même s’il n’a jamais quitté le cinéma comme repère référentiel, a décidé d’analyser les programmes de télévision dans les années quatre-vingt. Manière pour lui de prendre acte de la dissolution du cinéma dans l’audiovisuel de masses, lequel tend à imposer ses contenus et ses mises en scène comme repères culturels pour une société entière. « Que s’est-il passé depuis que Bazin n’est plus là ? écrit François Truffaut en 1983. D’abord et avant tout, la télévision a pulvérisé les mythes, détruit les stars et rompu le charme. La généralisation de la couleur a fait régresser la qualité moyenne des images, elle a rendu la ‘lecture’ des films à la fois plus simple et moins envoûtante (…) Malheureusement, la critique d’aujourd’hui, en tous cas dans son exercice quotidien, a presque tout perdu de son influence, principalement à cause de la télévision [22]» (A perte de magie du cinéma, perte d’aura de sa critique : la télévision est devenue l’arène principale de la diffusion des images et des discours à son sujet. Au contraire de Truffaut, Daney ne se limite pas à déplorer une telle évolution : il décide d’appliquer sa compétence critique à cette nouvelle réalité. Quittant les Cahiers pour Libération au début des années quatre-vingt, il y écrit une série d’articles sur les programmes télévisuels sous le titre « Le salaire du zappeur ». Les commentaires qu’ils lui inspirent ne sont pas uniquement négatifs : il a écrit sur les retransmissions de rencontres de tennis avec ferveur et pénétration, mettant en évidence la potentialité dramatique de leurs aléas que la mise en scène télévisuelle a su mettre en évidence : « Le tennis est filmé de mieux en mieux, écrit-il, parce qu’on trouve (sans peine) le moyen d’inscrire ne simultané l’un et l’autre joueur. (…) Le spectacle de celui qui engage est à peine moins intéressant que celui de celui qui reçoit. (…) Les plans interstitiels (attente, jeu de jambes, jeux de scènes) deviennent aussi intéressants que les plan ‘importants’. Ceux-ci, grâce au ralenti technique, deviennent plus énigmatiques, plus riches [23] ». En cela, son parcours annonce la critique à venir. Ses nouvelles figures, enfants de la télévision, sont attentives au contexte médiatique dans lequel s’inscrit toute nouvelle production cinématographique. Par ailleurs, elles cherchent dans le jeu vidéo ou les séries télévisées de nouvelles aires d’expression artistique nichées dans l’offre de divertissement adressée au public le plus large.
Dans La critique de cinéma, à l’épreuve d’internet [24], Sidy Sakho considère ce débordement par la critique de cinéma vers les média comme une évolution logique, prolongeant la conception du cinéma par Bazin comme un « art impur ». Il est vrai que Bazin appelait à un dialogue entre le cinéma et le théâtre, la peinture ou la littérature. Il s’agissait toutefois d’arts nés avant lui. A présent, le cinéma se confronte à de nouvelles formes d’expression pour lesquelles la qualification d’artistique n’est pas évidente. Il reste qu’à l’aube des années 2000, Les cahiers du cinéma ont distingué des séries télévisées comme Les Soprano, 24 heures chrono, the Wire, les jugeant remarquables par la construction scénaristique de leurs épisodes, leur aptitude à incarner de grandes figures tragiques et à restituer avec justesse des univers sociaux. Les mêmes Cahiers du Cinéma, s’emparant du phénomène de la télé-réalité, n’ont pas nié que l’expérience du Loft Story proposait un pur enregistrement du réel, excédait les formats de récit habituels (par sa version continue sur une chaîne payante) et à ce titre, posait des questions de cinéma. Enfin, avec les images qui ont relayé les attentats du 11 septembre 2001, le cinéma des films catastrophe s’est vu concurrencé par le spectacle du réel tel que l’ont capté de multiplies caméras d’amateurs à l’ère de la démocratisation du filmage. « A partir de là, écrit Sidy Sakho, (…) la critique de cinéma sera vraiment soumise à la primauté du monde (des images du monde) sur sa représentation. Non que le cinéma ne compte plus, ne puisse plus continuer après l’ébranlement visible de la première puissance mondiale, mais cette attaque, cette guerre, auront été les points de départ d’un nouveau regard sur le monde et sa configuration » [25]. Pour Antoine De Baecque, la violence mise en scène au cinéma sert à contenir, ordonner, rendre préhensible celle que les média véhiculent sans retenue. Il reste que le critique doit situer chacun de ses films dans le nouveau paysage audiovisuel dans lequel nous nous trouvons, depuis lequel nous le lisons. Selon Sidy Sakho, son écriture est mue par cette nouvelle question : « Qu’est-ce qu’un plan de film, parmi le flot des images qui l’entourent sur le Net, à l’heure du streaming, et du téléchargement, illégal ou non ? » [26]. Question relative au sens et à l’esthétique de l’image, à ses modes de diffusion, à la façon dont le spectateur l’appréhende. Elle résonne avec les récentes écrits de Jean-Louis Comolli dans la revue Trafic que Serge Daney avait fondée à la fin de sa vie. S’appuyant sur les œuvres récentes de Pedro Costa, Comolli a cherché à situer le cinéma comme art qui restaure le rapport aux images, propose une résistance au tout venant de l’audiovisuel. Il rappelle que la salle reste le lieu nécessaire du rapport à l’oeuvre, moins pour la communion qu’elle favorise avec le public que parce qu’elle est le seul à offrir les conditions nécessaires pour percevoir le hors champ, figure déterminante de toute mise en scène.
En dédiant, en novembre 2016 un numéro entier à à la création vidéo et internet, les Cahiers du cinéma prennent acte de cette créativité spécifique au support numérique et au déploiement des réseaux sociaux. L’œuvre critique est appelée à continuer son œuvre dans ce nouveau contexte : trier, identifier, puis, au moyen des mots, caractériser et apprécier. Stéphane Delorme constate : « Les vidéos sont beaucoup « vues » sur Internet mais il y a très peu d’écrits sur elles. Le numéro est une invitation à s’attarder au-delà du clic, une invitation à découvrir des œuvres [27]. » Il s’agit donc, non pas de rompre avec une pratique de la critique, mais de l’appliquer à de nouveaux objets.
Ainsi, le regard du critique tend à se porter au-delà de l’unité du film. A la suite de Daney, il considère chaque nouvelle production comme « symptôme » d’un discours audiovisuel qui façonne nos représentations. Le cinéma intègre ce discours sans plus en avoir l’exclusivité. Il reste à défendre sa spécificité, à examiner en quoi il est à même de satisfaire notre besoin de sens.
Par Joël Danet, Vidéo Les Beaux Jours
[1] Pierre Ajame, Le procès des juges – les critiques de cinéma, Paris, 1967, p. 263
[2] François Truffaut, « André Bazin nous manque » dans Dudley Andrew, André Bazin, Paris 1983, p. 16.
[3] Michel Mardore, Pour une critique-fiction, Paris, 1973, p . 5
[4] Michel Mardore, ibid. p. 16
[5] Jean Douchet, L’art d’aimer, p. 17-18, déc. 1961
[6] Jean-Michel Frodon, La critique de cinéma, Paris, 2008, éd. Cahiers du cinéma – Scérèn-CNDP
[7] Antoine de Baecque et Pierre Guislain, Objectif cinéma, Paris, 2013, p. 315
[8] Jean-Louis Bory, Des yeux pour voir, Paris, 1971, p. 8
[9] La critique de cinéma, Paris, 2004, p.12
[10] Robert Desnos, Cinéma, 1966, p. 15
[11] Robert Desnos, Cinéma, p. 15
[12] Jean Cocteau, Du cinématographe, Paris, 2003 (1973), p. 139.
[13] Jean Mitry dans la revue Image et son, juil. 1954
[14] Denis Marion cité par Bernadette Plot, « La revue du cinéma et les mutations culturelles de l’entre-deux guerres » dans La revue des revues, n°20, 1995
[15] René Prédal, La critique de cinéma, 2004, p.38
[16] Des yeux pour voir, Paris, 1970, p. 9
[17] (Qu’est-ce que le cinéma, vol.1, p.14, nouvelle édition)
[18] (André Bazin, Paris, 1983, p.111)
[19] Serge Daney, L’exercice a été profitable, Monsieur, Paris, 1993, p. 20
[20] (Serge Daney, le cinéma et le monde de Serge Le Péron, 2012)
[21] Régis Debray, Vie et mort de l’image, Paris, 1992.
[22] François Truffaut, « André Bazin nous manque » dans André Bazin par Dudley Andrew, p. 14
[23] Serge Daney, L’exercice…, p. 29. Voir aussi les articles contemporains de Charles Tesson sur la mise en scène du sport à la télévision dans Les cahiers du cinéma
[24] dir. Gilles Lyon-Caen, Pologne, 2014
[25] « Arrière-plans : un monde d’images », dans La critique de cinéma à l’épreuve d’Internet, p. 71
[26] « Arrière-plans… », p. 73
[27] « Création vidéo » par Stéphane Delorme dans les Cahiers du cinéma, nov. 2016, n°127.