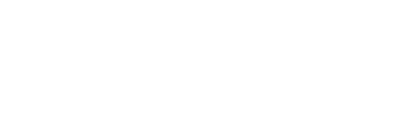De l’éducation populaire à la pratique amateur en passant par la télévision scolaire, panorama des étapes et enjeux marquants de l’éducation à l’image.
Publié le 27/02/2015, Mis à jour le 28/02/2023
L’association Vidéo Les beaux Jours a été sollicité en 2014 par le Département des arts du spectacle de l’Université de Strasbourg pour mettre en place un TD « éducation à l’image » adressé aux étudiants en niveau L2. Sous la responsabilité de Joël Danet, ce TD s’est efforcé d’en exposer les principes et d’en rappeler les fondements. Sa mise en œuvre a mobilisé des réflexions théoriques et des témoignages d’expériences puisés dans des publications de référence (revues, actes de colloques, études réalisées sur la question de la transmission du cinéma, de la pratique éducative du film, de la culture audiovisuelle du jeune public).
Les textes présentés ici sont les notes préparatoires des différentes séances du TD.
Introduction : les objectifs de l’éducation à l’image
Il s’agit d’initiatives isolées, au sein de la communauté associative ou éducative, ou bien de mesures politiques réunies par les mêmes objectifs :
– Rendre le spectateur actif et conscient de ses choix
– Initier à une pratique artistique
– Former une sensibilité critique capable de décrypter l’information
– Offrir un dépassement des inhibitions face à l’écrit
Donc dimensions citoyenne, esthétique, éducative se mêlent.
Catherine Tasca, ministre de la culture en 2001 : « Dans le domaine du cinéma, de l’audiovisuel et plus généralement des images, de nouvelles politiques publiques s’affirment ; elles se proposent d’offrir à tous les jeunes les moyens de découvrir, de pratiquer, d’aimer d’autres images que celles que leur proposent les industries de loisirs. »
Il s’agit de s’adresser au jeune public pour l’inciter à acquérir une culture indépendante de la culture dominante, consistant en une offre de divertissements et un nivellement des esthétiques, diffusés par la TV et le net. Dès lors, le cinéma est considéré comme une culture, un lieu de résistance intellectuelle à l’environnement médiatique et la pratique de l’image comme moyen de s’approprier l’expérience du film.
La problématique : nous appartenons à une civilisation de l’image, nous sommes entrés dans la « vidéosphère » (Debray : succède à la logosphère et à la graphosphère. Elle désigne la phase de la civilisation qui démarre à partir de l’invention de la télévision en couleurs. Dans la vidéosphère, le livre descend de « son piédestal symbolique. Le visible y fait autorité »). Nous sommes constamment sollicités par la séduction de l’image, son impact qui tend à primer sur notre environnement réel. Devons-nous nous résoudre à subir les sollicitations de notre environnement médiatique ? Ne devons-nous pas lui opposer un contre discours qui passe par l’analyse et la culture artistique ? Ne devons-nous pas devenir producteurs d’images pour les opposer à celles qui nous sont imposées ?
Par ailleurs, le film fait lien. Il constitue une expression évocatrice, qui allie la parole et les images, permettant d’attirer l’attention sur des situations données, provoquant le débat. Le film est un agent de dialogue :
– C’est un média qui permet de relier des personnes qui ne sont pas dans le même espace
– C’est un tiers-référent dans une confrontation entre deux partis, les réunissant autour des mêmes représentations
I. Le fondement idéologique : l’éducation populaire
Cf. Benigno Cacérès, Histoire de l’éducation populaire, 1964
1. Un premier élan, l’université populaire
L’éducation à l’image découle de l’éducation populaire comme effort de diffuser les savoirs et les pratiques culturelles auprès du plus grand nombre en privilégiant les classes défavorisées qui y ont le plus difficilement accès, notamment les ouvriers :
– Situation géographique
– Environnement éducatif
– Astreintes du travail : journées dix heures, pénibilité des tâches, aliénation mentale de leur répétitivité
Des Universités populaires sont fondées à la fin du XIXe siècle en France, à Nîmes, Toulon, Lisieux, Epernay. Avec la Troisième république naissante, les hommes de savoir s’impliquent dans cette mission, politiciens, historiens, écrivains et aussi des groupes d’enseignants œuvrant dans le hors temps scolaire. Tous agissent comme des intellectuels de fibre démocrate. Cours, causeries, conférences, lectures : ce sont les activités d’éducation populaire de tout le XXe siècle. Pour rendre le public plus attentif, usage de projections avec la lanterne magique.
Que retenir de ces premières expériences, souvent maquées par l’échec ?
– La rencontre entre intellectuels et ouvriers
– La culture, revendication ouvrière au même titre que les conditions de travail. En 1919, la loi des trois huit leur donne accès à huit heures de liberté. En 1936, c’est le temps des loisirs permis par les congés payés (accords de Matignon, Blum-Salengro). Dans les années soixante, résurgence de la revendication ouvrière au nom de la dignité qui passe par la culture.
2. Fondation des ciné-clubs
Initiative en janvier 1920 au cinéma La Pépinière du cinéaste Louis Delluc et du critique-théoricien Riccioto Canudo pour défendre le cinéma comme art. Diffusion en 1922 du cabinet du Dr. Caligari de Robert Wiene. Il s’agit de « favoriser les enthousiasmes, les efforts de tous les jeunes, et organiser des manifestations de tous ordres pour le développement de la cinématographie française. » (Delluc). L’idée est de montrer les films d’avant-garde au public le plus large.
Le ciné-club inspire l’idée que le cinéma est un moyen de diffusion de savoir, peut-être plus efficace que la lecture. Premier congrès du cinéma éducatif en 1922. Développement du cinéma éducateur. Le cinéma éducateur bien que le plus souvent projeté dans l’école est diffusé hors temps scolaire peut être le fait d’un instituteur ou de conférenciers spécialisés (agriculture, santé, etc.). Ces séances, jusqu’au début des années trente, étaient majoritairement organisées à des fins d’éducation populaire, soit en vue d’un enseignement post-scolaire, destiné aux adultes (étant alors considéré comme adulte, l’enfant sortant de l’école primaire).
3. Léo Lagrange et le Front populaire
Devenu secrétaire Jeunesse et sports sous le gouvernement Blum. Il s’agit de favoriser l’éducation des masses, devenues plus disponibles, détourner du cabaret, encourager la pratique du sport, réconcilier avec la nature. En même temps, volonté de collaborer avec les Beaux-Arts et l’éducation nationale :
– Idée de concilier les différents temps de la jeunesse dans un même programme éducatif
– Idée de mobiliser les institutions culturelles pour l’éveil artistique du plus grand nombre avec la mise en œuvre d’une politique tarifaire
– L’éducation populaire s’ouvre à la jeunesse
4. Après 1945, porter la culture dans l’environnement du citoyen
Création des bibliobus. Ce n’est plus aux lecteurs d’aller au livre, le bibliobus conduit le livre aux lecteurs. Avec les CREPS, développement des structures sportives dans tout le territoire. Promotion de l’éducation populaire, sous la charge de Jean Guéhenno : il s’agit de « coordonner les activités périscolaires, promouvoir, dans la nation, la pensée, la culture et la conscience. » Cette notion d’éducation populaire est vivace pour les structures culturelles d’éducation à l’image : la culture est un souci égalitaire, considérée d’un point de vue citoyen. L’effort pour privilégier les quartiers périphériques pour atteindre les populations isolées l’atteste. Il s’agit aussi d’une offre complémentaire à l’enseignement de l’éducation nationale, plus éducative que pédagogique.
Le théâtre populaire : expériences de pièces montées dans les usines, cf Jean Dasté à Grenoble. Formation de jeunes comédiens par Jean-Louis Barrault ou Vilar. André Bazin participe à la diffusion de la culture cinématographique en écrivant dans des bulletins de culture populaire comme le Sou de l’éducation populaire. Création de la Fédération des MJC en 1944 : un interlocuteur privilégié de l’éducation à l’image comme les CSC, structurant l’offre culturelle et de loisirs à la jeunesse.
Les nouveaux enjeux :
– tenir compte de la fatigue quotidienne, du besoin de délassement
– tenir compte, avec le progrès technique incessant, de la fin de la tranquillité culturelle : nécessité pour l’adulte de se former tout au long de son existence
– réduire les antagonismes sociaux par la diffusion de la culture
– trouver un langage commun entre l’animateur et les usagers de la culture
Un des nouveaux outils envisagés, à côté de la lecture, du théâtre, du cinéma, est la TV ; Cacérès en 1964 :
« La télévision peut devenir l’instrument de culture de tout un peuple. Elle est déjà un moyen de communication entre les hommes. Mais elle peut être utilisée d’une manière plus ou moins complète et efficace selon les moyens matériels mis à sa disposition et selon la politique culturelle que les responsables directs ou indirects désirent ou sont chargés d’appliquer. » (p. 183)
Dans ses premiers âges, la télévision inspire l’utopie d’une diffusion démocratique du savoir et de la culture. Elle est mobilisée par l’Éducation Nationale comme moyen de produire des contenus qui intègrent le programme des cours.
II. De l’éducation par l’image à l’éducation à l’image
1. Les premiers pas du cinéma d’enseignement
L’expérience de la production du CNDP est annoncé par des initiatives isolées de professeurs ou instituteurs qui, dès les années trente, ont employé le cinéma dès les années trente comme média pédagogique. Ils ont favorisé le développement du cinéma d’enseignement, c’est-à-dire un cinéma destiné à la classe, montré par l’instituteur, qui accompagne la leçon, l’illustre en quelque sorte.
– Marc Cantagrel, auteur de films techniques et scientifiques diffusés dans les écoles, met au point des techniques de schémas animés
– Jean Brérault, instituteur qui a réalisé des films pédagogiques pendant ses vacances pour améliorer la qualité de ses leçons.
Dès ses débuts, le cinéma a été identifié comme un outil pédagogique innovant et complémentaire de l’enseignement classique :
– Le cinéma grossit les dimensions du sujet
– Le cinéma par le ralenti et l’accéléré permet d’ajuster la vitesse d’observation d’un phénomène
– Le cinéma permet de voir ce phénomène plusieurs fois
– Le schéma animé met en évidence les éléments importants, soulignant les lignes forces d’une forme, ajoutant des légendes à certains endroits de l’image.
Dès les années vingt, des scientifiques comme Pierre Thévenard et Jean Painlevé ont défendu le cinéma comme outil d’observation et d’apprentissage.
L’émergence du film parlant, qui a réellement mis fin au cinéma d’enseignement et d’éducation en raison de l’augmentation de ses coûts et parce qu’il venait occulter la parole du conférencier, maître ou éducateur, a favorisé l’émergence du film-fixe.
C’est alors qu’émerge la production télévisuelle, mettant à profit l’équipement en postes d’un nombre de plus en plus grand d’établissements.
2. La télévision scolaire au temps d’une télévision éducatrice
En 1951, la Télévision Scolaire est créée au sein du CNDP. Il n’existe alors qu’une seule chaîne de télévision. Les émissions (au tout début, deux par semaine d’une durée d’une demi-heure en direction de Paris et sa région) sont proposées aux élèves de l’enseignement primaire, secondaire et technique. Elles sont conçues par des auteurs rémunérés par le Ministère de l’Education Nationale et réalisées en direct dans les studios de la rue Cognacq-Jay par les personnels de la Radio Télévision Française (RTF). D’abord constituées de débats en « plateau », elles vont, peu à peu, intégrer des séquences déjà filmées par le biais du « télécinéma ». Georges Folgoas, Pierre Tchernia et Serge Grave comptent parmi ces réalisateurs RTF. Ces émissions totalisent une demi heure et comprennent différentes séries de longueur variable.
Le CNDP se développant, les émissions totalisent 1 h30 par semaine en 1952 ; 2 h en 1954 ; 4 h en 1960 ; une vingtaine d’heures en 1967-1968. Placé sous l’autorité du Ministère de l’éducation nationale, qui favorise l’équipement des établissements scolaires en postes télévisuels, malgré les réticences pressenties dans la profession enseignante (par peur que la télévision se substitue au professeur). La diffusion des émissions est accompagnée d’un bulletin, le bulletin de la RTS, comportant la grille des programmes et de fiches pédagogiques à l’usage des enseignants. Ce bulletin comporte aussi des articles théoriques sur la place de l’audiovisuel dans la classe : il ne s’agit pas de substituer les films à l’enseignement du professeur mais de le suppléer en puisant dans les ressources expressives du cinéma. Par ailleurs, certaines émissions permettent d’ouvrir le jeune public à la diversité de la société, son environnement professionnel, ses institutions. Le jeune public en difficulté scolaire est particulièrement visé : l’idée est qu’il est davantage sensible au monde extérieur, qui n’obéit pas à la logique scolaire. Des fiches critiques sont adressées à un échantillon d’enseignants pour connaître leurs opinions sur les contenus des programmes. A partir de 1968, avec l’introduction de la publicité, puis la multiplication des chaînes (création de FR3 en 1972), l’ORTF considère la programmation indépendante du CNDP à la télévision comme une ingérence. Elle est accusée de mal s’intégrer à la programmation générale, provoquant des “ruptures d’écoutes” jugées trop conséquentes. C’est la fin de l’utopie énoncée par Bénigno Cacérès.
La télévision est devenue un média essentiellement dédié au divertissement, propageant l’uniformisation des esprits. De ses trois missions initiales, culture- information-divertissement, c’est la dernière qui prédomine. Désormais, il revient à l’éducation à l’image de proposer des alternatives de diffusion à la télévision, et, de ce fait, d’en favoriser la critique. Cette dimension analytique de son propre support la différencie de l’éducation par l’image menée jusqu’alors. Un autre facteur est la pratique du film qui devient de plus en plus abordable pour le public mateur. Le matériel de tournage et de montage se démocratise : coûts moindres de la pellicule 16 mm, de la vidéo, du numérique et allégement progressif du matériel. Désormais, l’audiovisuel dans le cadre éducatif combine le voir et le faire.
III. Eduquer au cinéma à l’école : les fondements et les applications
Un enjeu : insérer la transmission du cinéma à l’école
Pendant ses années de ministre de la culture (2000-2002), Jacques Lang est désireux d’introduire le cinéma dans l’enseignement. Son passage au ministère de l’éducation nationale lui donne l’occasion de réaliser son souhait. Il créé un groupe de réflexion, « les arts à l’école », avec Alain Bergala pour le cinéma. La première grande décision a été de ne pas instituer le cinéma comme une matière scolaire. « Je persiste à penser que la solution n’est pas que les diplômés universitaires en cinéma enseignent cette discipline toute leur vie comme une matière comme les autres en occupant les rares postes d’enseignants de cinéma qui existent. L’art ne doit pas être traité comme une discipline. (…) L’art doit rentrer dans l’école en gardant une altérité, comme une rencontre qui secoue ». (cf. « Apprendre à aimer le cinéma » dans 24 images, n° 115). Bergala attribue ce principe à Jack Lang, lequel, d’abord homme de culture, pense l’éducation depuis la formation esthétique individuelle.
Le rapport sensible contre le décryptage
En conséquence, il s’agit d’impliquer des intervenants issus du secteur professionnel du cinéma et de l’audiovisuel dans les différentes actions d’éducation à l’image. La mise en œuvre d’une éducation au cinéma s’appuie sur plusieurs principes :
– Eviter de limiter le film montré comme simple illustration d’une leçon d’histoire ou de français (ex : Gandhi de Richard Attenborough, Octobre d’Eisenstein…)
– Préserver le rapport sensible et poétique à l’art cinématographique, respecter l’individu-spectateur qui part à la rencontre de sa personnalité esthétique et la finalité de toute œuvre cinématographique qui est l’art par le cinéma : selon Bergala, il faut « penser le film comme trace d’un geste de création. Pas comme un objet de lecture, décodable, mais chaque plan comme la touche du peintre par laquelle on peut comprendre son processus de création. »
– Tenir compte d’une génération qui estime ne pas avoir besoin de s’inscrire dans l’histoire culturelle de l’art auquel elle s’intéresse, qu’on a suffisamment de ressources en soi pour créer. Inciter à voir des films puisés dans l’histoire du cinéma. (leçon inaugurale des Masters à finalité didactique et de l’agrégation, l’Erg et l’ESA-Saint-Luc ont invité Alain Bergala le jeudi22 septembre 2011).
L’essentiel : il est possible d’initier à l’art, il n’est pas possible de l’enseigner. Il faut sortir de la logique déductive, analytique. Il faut ne pas étouffer le film par le savoir préalable, privilégier les films qui résistent, gardent une énigme.
– l’admiration contre le décryptage : il s’agit d’une part de préserver le cinéma d’une analyse trop poussée de ses ressorts qui tuerait le plaisir de spectateur. Cette prévention est en réaction à l’école de sémiologie (science qui étudie les systèmes de signe), puissante dans les années soixante-dix, qui s’est emparée du cinéma, par les articles critiques et par l’enseignement. D’autre part, Bergala lutte contre l’idée de dénoncer un mauvais cinéma auprès de l’enfant, préférant le principe de l’inviter à aimer un autre cinéma, plus confidentiel, plus secret, en le lui rendant accessible et en accompagnant son approche. « La meilleure riposte n’est pas d’apprendre à décrypter mais de donner de belles choses à voir (…) puis d’apprendre aux enfants à les approcher et à les aimer. » Il ne s’agit pas de déconstruire le cinéma dominant mais de « reconstituer un goût pour le cinéma ». (24 images, p. 13)
– ne pas confondre le cinéma avec l’audiovisuel : Bergala est hostile à l’idée que le cinéma permet d’armer les enfants contre la télévision. « L’enseignant chargé du cinéma aurait comme mission première de développer l’esprit critique et l’urgence des urgences serait de développer cet esprit critique à l’égard de la télévision. » Pour Bergala, l’enseignement du cinéma comme art suppose de le séparer de l’approche critique de la télévision en faisant appel à des intervenants différents. Il ne suffit pas de savoir « analyser l’Image pour analyser toutes les images ». Enfin, il est vain de convaincre un enfant que l’émission qui lui a procuré du plaisir est nulle ; une intervention pédagogique ne suffit pas à changer le regard. Bergala en revient à « la formation patiente et permanente du goût. » (L’Hypothèse cinéma, pp. 34-35-36).
– Le plan comme unité d’appréhension du cinéma : le plan « considéré comme la plus petite cellule vivante, animée, douée de temporalité, jouissant d’une autonomie relative, constitutive du grand corps du cinéma. » (hc, p. 80). Le choix d’un plan de film permet de parler de l’art d’un cinéaste et d’un moment de l’histoire du cinéma. L’intérêt est autant d’isoler un plan (comme moment de cinéma, témoin d’un style de réalisateur) que de le confronter à d’autres plans (pour mettre en évidence une figure de mise en scène ou une situation récurrente d’un film à l’autre). Cette approche par le plan détermine les contenus des outils pédagogiques que Bergala a mis au point.
Les applications pédagogiques
Plusieurs outils d’analyse ont été mis au point pour répondre à cette approche de la transmission. Ils ont demandé un investissement ambitieux de l’Education Nationale et des structures culturelles liées au cinéma pour les concevoir et les diffuser.
– « Cinéma, une histoire de plans », 1998-1999, Agat Films et Les enfants du cinéma : recueil de plans de films analysés comme s’ils se trouvaient sur une table de montage, soumis à des vitesses différentes, avec des zooms dans l’image, selon le cours de la réflexion. Le texte est dit par deux comédiens qui jouent un dialogue que le plan inspire.
– « Collection L’Eden cinéma », à partir de 2001, production du Scérèn-CNDP pour accompagner le plan de cinq ans dans le domaine du cinéma. Le principe est de proposer une collection de DVD de deux ordres : rencontre d’un film et langage du cinéma. La première catégorie concerne des œuvres majeures, accompagnées de programmation thématique d’extraits, de jeux pédagogiques, et de portfolio montrant des œuvres d’art en rapport avec l’imaginaire du film. L’autre catégorie concerne des figures importantes du cinéma (le point de vue, le plan, le montage, le raccord…) en proposant des confrontations de plans avec leur analyse par une voix off.
Chez Bergala, la collection de DVD permet « une instance de désignation » présente physiquement dans l’enceinte scolaire. « Quand tu as tout, tu n’as rien. (…) Ce n’est parce qu’il y aura tout sur internet qu’un instituteur saura quoi en faire. Alors que s’il y a cent DVD, physiquement présents dans la classe, et que cet outil d’approche a été désigné, il se sentira soutenu. » (24 images, n° 115, p. 14). Bergala redoute que l’emporte un comportement de consommateur qui ne mène à aucune relation durable aux œuvres : « Tout laisse à craindre que l’impatience ne continue de galoper et que circuler librement dans une cinémathèque virtuelle illimitée devienne un champ de l’exercice de l’inattention. » (hc, p. 70). Il faut donc resserrer l’enseignement sur un choix de films qui devrait à la fois amorcer une culture et susciter la curiosité pour l’enjeu de la réalisation, et pour cela, matérialiser l’approche au film par un objet tangible qui comporte un propos pédagogique en rapport. « Il n’y a pas d’approche de l’art sans attention » à mettre en rapport avec « Il n’y a pas d’amour de l’art sans choix d’objet. »
À remarquer qu’aucun DVD n’est associé à un niveau scolaire, une tranche d’âge définie. Le cinéma est l’affaire d’une vie, on revient aux mêmes films pour en faire des expériences différentes, dont chacune a sa valeur.
– Livre Mais où je suis ?, Actes Sud – Cinémathèque française, 2007. Avec la mention « à partir de 10 ans », tentative de s’adresser directement au jeune public en portant son attention sur des mise en scène qui restituent des situations d’enfance : le sentiment d’être perdu, d’avoir quitté son monde familier pour se trouver dans un monde inconnu où tous les repères sont bouleversés. En s’appuyant sur des extraits de Alice au pays des merveilles de Svankmajer, Où est la maison de mon ami ? de Kiarostami, Le Petit Fugitif de Morris Engel et Ray Ashley, Un monde parfait de Clint Eastwood, Bergala réfléchit à la mise en scène de ces moments de vertige et de confrontation de l’enfant à la réalité du monde : le départ obligé ou bien le départ volontaire, le passage (sur un chemin, à travers un tunnel, dans un trou), l’épreuve de la solitude, la confrontation à un personnage adulte qui fait grandir. Cette initiative vise sans doute à affirmer que l’enfant peut analyser les films qu’il regarde, mettre plusieurs films en présence autour de thèmes communs, être sensible à la mise en scène au-delà de l’histoire racontée.
IV. Un lieu pour l’éducation à l’image : la salle de cinéma
Le lieu premier du rapport au cinéma
Au cœur des débats sur l’éducation à l’image est l’usage de la salle de cinéma. Il ne s’agit pas uniquement d’un outil mais d’un élément jugé nécessaire dans tout dispositif qui promeut le rapport à l’art cinématographique.
– la salle de cinéma est le foyer de la cinéphilie : ce mouvement qui s’est développé dans les années cinquante a fréquenté avec ardeur la Cinémathèque et les cinémas du Quartier Latin pour se constituer une culture cinématographique en allant regarder des films, également pour se retrouver entre adeptes de la même passion. La salle, lieu de découverte et de rencontre, terminal de tout rapport avec le cinéma, au-delà même de la lecture des revues.
– La projection en salle est considérée comme le meilleur dispositif de diffusion du spectacle cinématographique : le cinéma est une invention des Lumière qui propose une découverte collective du film montré dans une durée limitée (au contraire des systèmes mis au point par Edison qui invitaient à une découverte individuelle d’images mis en boucle), la fusion avec un public devant les mêmes images, la fascination des sens par une sensation qui les submerge, la captivité du corps pendant la durée infragmentable du film. Cf. la réflexion de Jean-Louis Comolli sur le hors champ : tout ce que suggère le film en dehors du champ de ses images ne peut s’éprouver que dans l’ombre qui baigne la salle. Il s’agit d’une obscurité magique, aura de l’image à laquelle le spectateur s’adonne. En regardant un film chez lui, le spectateur est distrait par son cadre familier, tout ce qui se trouve autour de l’image est d’avance identifiée, la rencontre avec l’œuvre ne peut s’accomplir. Jean-Louis Comolli a beaucoup réfléchi le cinéma depuis la place du spectateur, voire depuis sa condition corporelle au moment où il envisage l’œuvre filmique, condition qui détermine la réception qu’il en fait. « La séance de cinéma met en place les conditions pratiques d’un apprentissage, écrit Comolli. Coupé de tout ce qui n’est pas la surface de projection (c’est-à-dire du reste du monde), le cinéspectateur est, on le sait, conduit à (….) accepter la contrainte d’une certaine paralysie corporelle, motricité et mobilité ne jouant plus que par procuration (le corps filmé comme délégué du spectateur) ; à suspendre ou censurer, encore,l’essentiel de ses relations à ces autres qui ne sont pas filmés, ni, d’ailleurs, visibles dans le sombre de la salle, les spectateurs qui l’entourent (…) Il s’agit donc d’apprendre à apprendre. Le suel laboratoire de cet apprentissage reste la salle obscure, la séance ritualisée, la projection publique, le cocon d’obscurité, le faisceau de lumière provenant de derrière nos têtes. » (« Suspension du spectacle » dans ID, n° 39, p. 91).
– La salle est le temple du cinéma, c’est aussi un lieu d’enfance au même titre que la foire ou le cirque : une réputation magique lui est attachée, elle est le lieu de la découverte sensationnelle, de l’émerveillement en dehors des normes habituelles de transmission imposées par l’école ou le cadre familial. Le rapport d’un enfant est de l’ordre de la fascination, entrainant un mélange d’excitation et de crainte devant un spectacle aux ressorts cachés et dont le déroulement est imprévisible.
Jean-Michel Frodon résume : « Ce qui se joue en nous, adultes et enfants, dans la salle – dans le noir, devant ces images tellement plus grandes, dans la présence d’une collectivité autour de soi, dans le dispositif de lumière projetée et réfractée ( pas du tout la même chose que devant un écran d’ordinateur, de télévision ou de portable), ce qui se joue là est unique et précieux. Une magie impure… » (« Dans le cinéma, l’enfant spectateur » – L’Alhambra Marseille – Tendance Floue, 2011).
L’action des exploitants d’art et essais
Pour les exploitants de cinéma, en particulier du circuit d’art et essai, l’éducation à l’image représente un enjeu : compte tenu de la baisse de fréquentation progressive des salles, il devient urgent de compter avec le public captif que constituent les élèves des écoles. Ceci engage une conception du projet culturel des salles davantage orienté vers l’accueil du jeune public et la pédagogie du cinéma.
Un marqueur de cette évolution : la création de l’Alhambra en 1989 à Marseille. Cette commande de la municipalité est confiée à Jean-Pierre Daniel, cinéaste, alors conseiller d’Education populaire et de Jeunesse. Il s’agit d’ancrer un nouveau cinéma dans le quartier Nord de la ville, populaire, sujet à tensions sociales, pour favoriser l’éducation cinématographique en son sein. Le projet consiste d’abord à ressuciter un ancien cinéma populaire dont il rafraîchit la façade, s’inscrivant de cette façon dans la continuité de l’histoire de la diffusion cinématographique inscrite dans l’espace urbain. L’aménagement de l’intérieur requiert un décor exotique et luxuriant qui enchante l’espace, référence à la civilisation méditerranéenne qui porte l’histoire de la vile, mais aussi au registre du merveilleux consubstantiel au plaisir du cinéma. (cf. J. P. Daniel, « Eloge du partenariat entre création cinématographique et enseignement » dans Images documentaires autour du thème Cinéma et école, 3e et 4e trimestre 2000, p. 17).
D’autres initiatives naissent au Havre, avec les « Rencontres du cinéma et de la petite enfance » de Ginette Dislaire, ou à Paris avec le « Cinéma du côté des enfants » de Gérard Lefèvre, puis le dispositif « École et cinéma, les enfants du deuxième siècle » mis en œuvre par les Enfants de cinéma qu’ Eugène Andréanszky dirige depuis 2000. À chaque fois, il s’agit, à partir d’une économie restreinte, d’un partenariat avec des salles d’art et essai et les écoles, d’imaginer une programmation orientée vers l’enfance susceptible de la réconcilier, en quelque sorte, par-delà les générations et la fracture de la vidéo, avec le cinéma en salles. J. P. Daniel : « Nous attachons une importance extrême à cette découverte par les enfants des films dans une ‘vraie salle de cinéma’. Ce qui se construit, dans l’obscurité peuplée de silhouettes des spectateurs et des sons de leurs réactions est unique. II s’agit d’un spectacle et d’émotions vécues dont le souvenir nous accompagne plus ou moins longtemps selon la force des films. Et l’on sait aujourd’hui l’importance de ces émotions dans la construction même de notre intelligence. » (ibid., p. 18). L’attitude des enfants, trahissant les émotions qui le submergent, comme un gage de réussite de l’action pédagogique par le cinéma : L’Alhambra publie dix ans plus tard un livre, Dans le cinéma, l’enfant spectateur, recueil de portraits par le photographe Meyer d’enfants spectateurs. Nous les voyons tour à tour, remplis d’appréhension, livrés à l’émerveillement, pris d’étonnement. De cette façon les adultes accompagnateurs, parents ou responsables éducatifs, saisissent l’enjeu de la projection en salle, montrée comme le lieu d’un apprentissage émotionnel sans équivalent. « Une galerie de portraits qui révèle à quel point pendant une séance de cinéma, ces enfants vivent une expérience forte et pleine d’émotions. Et que sûrement, accompagnés par ces œuvres, ils grandissent avec une conscience accrue de leur rapport au monde. »
Les dispositifs scolaires : un didactisme de passionnés
Les initiatives d’actions éducatives dans les salles sont une réponse à une contradiction que porte l’éducation au cinéma. Elle est portée par des passionnés qui ont approché le cinéma de façon buissonnière, voire clandestine, à l’image des enfants des 400 coups ou de Mes petites amoureuses. Cette dimension d’interdit, cette démarche personnelle ne cadrent pas avec l’institution scolaire sollicitée dans la mise en place des séances. C’est sans doute pourquoi les dispositifs qui éclosent dans les années quatre-vingt dix, Ecole et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens au cinéma, vont plus loin dans le didactisme, assumant l’environnement scolaire où ils sont mis en œuvre. Les séances supposent une implication de l’enseignant qui les prépare et revient dessus avec les enfants. Ils sont assistés par deux éléments :
– un livret pédagogique qui propose des pistes d’analyse, décomposent le film,concentrent toute l’information nécessaire à son sujet du point de vue de l’histoire du cinéma et plus largement.
– Une formation de 3 h destinée à les éclairer sur les enjeux de mise en scène, la personnalité artistique du cinéaste, la place du film dans l’histoire du cinéma. Cette formation est assurée par un spécialiste : exploitant passionné, chercheur en cinéma, critique…
Les différents éléments de chaque dispositif visent à enrichir la culture cinématographique de l’élève autant qu’à l’inviter à affuter sa sensibilité. Nous sommes loin des expériences directes, incidentes, sans filet dont témoignaient Truffaut, Eustache ou Bergala, ou Daney (qui se souvient des sorties au cinéma avec sa mère, décidées à la dernière minute, comme un coup de tête libérateur). Il n’en reste pas moins qu’ils impliquent des spécialistes passionnés de la transmission de la culture cinématographique, qui interviennent volontiers dans la sphère publique, à l’image de Carole Desbarats, qui a été directrice des études de la FEMIS, a écrit sur Jean-Luc Godard et Eric Rohmer, est intervenu à France Culture ou dans une revue comme Tous urbains.
La place de l’enseignant
Autre marque d’institutionnalisation des dispositifs, la manière dont il prévoit l’inscription de l’enseignant. Une de leurs priorités est de ne pas approcher les enfants sans eux, en passant par-dessus leurs responsabilités de pédagogie et de transmission. C’est sans doute un enseignement de l’expérience de la télévision scolaire qui a déstabilisé nombre d’entre eux, au point de provoquer leur hostilité. Il reste que le principe des dispositifs, d’essence culturelle, positionne différemment le rapport de l’enseignant aux élèves. Nicole Turpin, directrice d’école primaire, qui a promu le dispositif Ecole et cinéma dans son département, en témoigne : « je me rappellerai toujours d’un gamin particulièrement rebelle dans une classe, alors que j’étais très jeune, qui un jour me dit : ‘ Mais pourquoi tu me poses la question alors que tu connais la réponse ? ‘ Et c’est vrai que c’est la situation de l’enseignant. Dans une aventure culturelle, on n’est jamais dans cette situation-là, parce que si je pose une question à une enfant, je n’ai pas la réponse, j’ai une partie de la réponse qui est ma réponse, mais j’attends aussi des enfants d’autres réponses. » (« Deux ou trois choses que nous savons du cinéma, de l’école et des enfants » par Ginette Dislaire et Nicole Turpin dans dans Images documentaires autour du thème Cinéma et école, 3e et 4e trimestre 2000, p. 42). Dans ce nouveau positionnement de l’enseignant, la salle joue son rôle : la séquence pédagogique ne se déroule plus exclusivement en classe mais chez un tiers, l’exploitant, qui participe à sa conception et son déroulement. Toute parole de l’enseignant ou de l’élève résonne autrement dans cette enceinte où ils ont été accueillis, qui les accueille habituellement, l’un comme l’autre, en dehors du temps de l’école. L’enseignant doit accepter de construire un discours avec les élèves en intégrant leurs interventions qui ne sont plus de simples réponses à ses interrogations.
L’enseignant est également sollicité par les dispositifs en tant que responsable éducatif, garant d’une transmission respectant les valeurs républicaines. A ce titre, il interpelle régulièrement les responsables de l’éducation à l’image sur les contenus des films diffusés. Quelles valeurs charrient-ils, sont-elles cohérentes avec la démarche éducative qui porte leur diffusion? Comment les cadres scolaires peuvent-ils les assumer en même temps que leurs responsabilités ? En témoigne la récente projection-rencontre en mars 2014 à l’Alhambra autour du film Tomboy, réalisé par Céline Sciamma en 2011 et récemment inscrit dans le dispositif Ecole et cinéma. Cette séance, organisée en amont des séances scolaires, réunissait parents, professeurs et le pédopsychiatre Marcel Rufo, « afin d’antciper toutes les questions et appréhensions… » (William Benedetto « Quand Rufo rencontre Tomboy » dans Le fil des images, https://www.lefildesimages.fr, consulté en septembre 2014.) Constat de William Benedetto, directeur de L’Alhambra : « Suite à ce pré-visionnement, les séances scolaires se sont succédées à l’Alhambra. Elles furent toutes un succès, ponctuées par des salves d’applaudissements spontanés. Preuve que pour les enfants les choses sont bien plus simples ou alors qu’ils sont des êtres complexes que les adultes ne comprendront jamais… Et preuve que Tomboy est surtout un film qui raconte l’enfance et quelques uns des enjeux qui vont avec. » (William Benedetto, ibid.). Est-ce à dire que l’enseignement scolaire manque à ces enjeux ? L’expérience témoigne tout du moins que les dispositifs sont toujours exposés aux tensions et aux malentendus avec les enseignants, considérés tour à tour comme des acteurs ou des empêcheurs de leur mise en œuvre.
V. Approches du jeune spectateur et faiseur d’images
Pour accomplir leur œuvre de sensibilisation, les acteurs de l’éducation à l’image ont approché le jeune public sous différents angles :
– sa capacité d’émerveillement
– sa vulnérabilité devant les contenus de violence
– son ingénuité créative
Ceci engage une réflexion qui s’étend à la pratique des images : derrière la caméra, le jeune spectateur est susceptible de révéler sa créativité, les influences qu’il porte, les codes qu’il a acquis, l’enseignement qui lui a été transmis.
Accompagner son rapport aux images, les préserver de leur violence
Les séances buissonnières, à l’initiative de l’enfant, à l’insu des adultes, en particulier de ceux qui sont responsables de son éducation, l’exposaient, l’affranchissaient à toutes les réalités de l’imaginaire propre à l’âge adulte. Dans le cadre de l’école, le cinéma devient un interlocuteur responsable, supposé accompagner l’enfant dans sa confrontation à la réalité du monde et ses représentations. Sa diffusion à l’école s’accompagne d’une réflexion éducative sur les effets psychiques de la proliféation d’images violentes, sans contrôle préalable de diffusion.
– Le constat d’un changement dans l’environnement d’images du jeune public
Accompagnant la mise en place des dispositifs, une réflexion sur la violence des images dans se développe dans les instances éducatives et culturelles concernées. Elle s’appuie notamment sur les études de Sophie Jehel chargée au sein du CSA d’étudier la place qu’elle occupe dans les programmes de télévision. Avec Divina Frau-Meigs, elle a écrit Les écrans de la violence dès 1997. Le livre fait état de ses études sur la prolifération et la banalisation de contenus violents dans l’environnement audiovisuel des enfants. Elle interroge : « Quels effets doit-on redouter pour les enfants et les adolescents ? Quels modèles et quels stéréotypes leur sont transmis à travers les représentations d’une violence à répétition ? L’abondance de ces images s’explique-t-elle par le goût du grand public et par celui des jeunes en particulier ? » Pour faire face à cet enjeu éducatif inédit, elle souhaite la mobilisation des « acteurs sociaux concernés, citoyens, parents, producteurs, créateurs, diffuseurs, chercheurs, législateurs prennent la mesure de leurs responsabilités afin que les histoires qu’on nous raconte ne se transforment pas toujours en cauchemar. » Sophie Jehel évoque une jeunesse placée sous « la coupe médiatique ». Elle pose une rivalité entre deux tutelles : la tutelle identifiée et responsable de l’institution, la tutelle anonyme et irresponsable de l’industrie des médias. L’enjeu devient de mettre à profit les instances de contrôle des médias, en particulier la télévision, pour reconquérir le terrain perdu vis-à-vis du jeune public.
– Les réponses du psychologue
Il reste à définir la capacité d’influence des contenus audiovisuels violents et les moyens de riposte. Les signalétiques mises en place sur les limites d’âges ne sont utiles que si les adultes responsables consentent à les prendre en compte et à accompagner les enfants spectateurs dans leur parcours parmi les propositions filmiques qu’ils rencontrent. Dans un ouvrage paru en 1998, Y-a-t-il un pilote dans l’image ?, le psychanalyste Serge Tisseron montre que les enfants, qui nouent un rapport physique, sans recul avec les images auxquelles ils sont confrontés, ont surtout besoin de verbaliser leurs émotions. En 2003, il délivre plusieurs constats :
– Les images violentes ne poussent pas à la violence à elles seules. Ce n’est parce qu’on voit des gens méchants au cinéma qu’on a envie de le devenir, pas plus que ce n’est parce qu’on voit des gens gentils qu’on a envie de le devenir ;
– Pourquoi regarder des images violentes :
§ donner des images qui correspondent aux peurs que nous engrangeons depuis l’enfance : peur d’être mangé, peur des monstres
§ se défouler, se libérer mentalement des pressions exercées par l’autorité des parents, des professeurs, jugées humiliantes ou injustes ;
– Les images violentes peuvent favoriser des comportements agressifs, machistes, si les enfants qui les regardent ne leur donnent pas de sens. Nous le leur donnons grâce à notre esprit critique, mais aussi grâce à la possibilité d’en parler ou à l’école, de ne pas céder à un désir de ne pas montrer ses émotions pour donner l’impression qu’on les domine.
Il indique plusieurs pistes :
– Il faut donner un sens aux images en analysant leur mise en scène
– Il faut les mettre en mots auprès de son entourage
– Il peut être bénéfique de faire un film à son tour où l’on parodie les images d’horreur ou les images de violence vues au JT. (Serge Tisseron, « Images violentes, violence des images » dans Tripodos, n° 15, 2003).
Analyse des films, verbalisation des impressions, rôle de la pratique du film dans l’appréhension de l’audiovisuel… autant d’orientations qui place la prévention contre la violence des images dans le champ de l’éducation à l’image.
La réponse du ciné-club
Il reste que les débats à propos de la diffusion des images ne sont pas uniquement nourries par la violence dont elles peuvent être le véhicule. Celui dont William Benedetto fait part, lancé à l’initiative des enseignants et des parents à propos de la diffusion de Tomboy dans un cadre scolaire, témoigne d’un autre type de préventions. La diffusion de Mes petites amoureuses de Jean Eustache dans le même cadre a suscité des plaintes similaires. À chaque fois, ce sont les codes de comportements dans les rapports hommes-femmes qui sont en jeu. Ces polémiques ont en quelque sorte annoncé celles liées à la réflexion sur le genre que le ministère de l’Éducation Nationale a cherché à promouvoir au sein des écoles. D’un point de vue éthique, l’éducation à l’image n’est pas uniquement concernée par la prévention contre les incitations à la violence par le film. Selon les films programmés dans ses dispositifs, elle risque d’être interpellée sur d’autres terrains moins facilement assumés comme la morale sexuelle et les normes des genres. Or l’art cinématographique ne se conçoit pas dans la perspective de l’éducation des jeunes générations. Il s’agit, d’un film à l’autre, de savoir jusqu’où l’adulte accompagnateur peut assumer ce qui leur en est montré. Ces questions motivent de nombreux échanges dans les séances où se réunissent les instances nationales des différents dispositifs. Au cœur de tout ceci, la représentation que chaque adulte se fait de l’enfant ou l’adolescent spectateur : quelles sont ses pratiques ? Quels spectacles privilégie-t-il ? Est-il encore disposé à se prêter au jeu de la découverte culturelle guidée par le public adulte ?
Ceci rejoint des interrogations propres à l’enseignement artistique. Le réalisateur Jean-Pierre Thorn observe en 1999 : « Les jeunes ne sont confrontés qu’à l’image de la télévision. On se demande où sont les ciné-clubs, lieux d’éducation populaire et d’échanges. Comment les jeunes peuvent-ils se confronter à des écritures alors qu’il en existe si peu à la télévision ? » (dans les actes des Rencontres européennes des jeunes et de l’image mises en place par Kyrnéa International à L’Alhambra de Marseille du 12 au 15 février 1999). Le ciné-club, comme le retour des programmations dans la salle, est encore une réponse d’hier à l’évolution des comportements de spectateurs. Très tôt, il a permis de mettre à jour les potentialités de l’enfant comme spectateur : lui montrer des images et l’inviter à les verbaliser permet d’en faire l’épreuve. Dès 1956, un pédagogue le formule avec enthousiasme en rapportant son expérience de ciné-club dans un internat réservé à des élèves en grande difficulté d’insertion :
« Au début, ceux qui menaient le travail n’avaient pas d’intentions ou d’idées précises, quand à la place exacte du cinéma dans la vie de ces enfants. J’affirme, en toute modestie, que ce sont les réactions des enfants qui nous ont montré la voie, qui nous ont donné la vérité. (…) J’ai vu des garçons frustes, abrutis par une enfance dont la peinture semblerait exagérée s’il fallait la conformer à la réalité, avoir des réactions extraordinaires de simplicité, de valeur après la projection d’un film. (…) Très souvent, il s’agissait de jugements esthétiques sur l’intérêt global, la valeur des images, le rythme du film, tout cela exprimé confusément, naïvement, mais avec franchise et justesse. » (« Le cinéma au pays des mauvais garçons » par H. Kleger dans Image et son – revue de l’UFOLEIS, juillet 1956, n) 94).
Ce témoignage met en évidence, d’une part la capacité d’analyse du jeune spectateur (qu’il faut rappeler à tout interlocuteur aîné qui s’en tient au stéréotype d’une jeunesse passivement consumériste), d’autre part l’efficacité du dispositif du ciné-club pour la mettre en évidence, y compris auprès du jeune lui-même.
Il reste à tenir compte de l’évolution de l’environnement médiatique dans lequel évolue chaque nouvelle génération. Attentive aux évolutions des contenus médiatiques depuis les années quatre-vingt dix, en particulier ceux de la télévision, Sophie Jehel rappelle en 2009 :
« Jusque dans les années quatre-vingt dix, le paysage médiatique français destiné aux enfants reste contrôlé par les pouvoirs publics et relativement limité. A partir des années 90, l’offre de médias jeunes explose dans une logique de plus en plus commerciale : jeux vidéo, radios, programme TV, chaines spécifiques, services de messagerie sur internet… ». Un éducateur, Jacques Delorme, avoue son désarroi devant cette évolution à laquelle les jeunes se sont adaptés plus vite que lui : « Sommes –nous en mesure de suivre correctement la mutation des usages des images par les jeunes ? (…) Quand nous organisions des ateliers en pellicule argentique, nous avions un apprentissage à proposer pour le groupe. A présent, ce sont les jeunes qui nous enseignent. Quelle va être notre place en tant qu’éducateurs ? » (dans « Les jeunes et l’éducation à l’image en questions » – actes du regroupement national des réseaux d’éducation à l’image Jeunesse et sports / un été au ciné – cinéville, Bourges, septembre 2006).
Pour conserver cette place, faut-il reconduire les modes de transmission éducative des décennies passées sans tenir compte de l’évolution dans le rapport aux supports d’images ? Faut-il au contraire chercher à s’adapter à tout prix à cette évolution, quitte à perdre de vue le sens des actions ?
Développer la personnalité créative
Un enjeu sous-tend l’action culturelle qui implique le jeune public : la préservation de son expression, non seulement de son propos aussi sa propre puissance créative. La valeur insondable de celle-ci a été révélée par un artiste comme Picasso, qui souhaitait arriver à peindre comme un enfant, ou encore Fernando Pessoa qui défendait l’idée que les enfants « sont de grands littérateurs car ils parlent comme ils sentent et non pas comme on doit sentir lorsqu’on sent d’après quelqu’un d’autre. » L’écrivain en veut pour preuve qu’il a entendu un enfant dire pour « suggérer qu’il était sur le point de pleurer, non pas ‘j’ai envie de pleurer’ comme l’eût dit un adulte, c’est-à-dire un imbécile, mais : ‘J’ai envie de larmes’. (…) Cette phrase se rapporte directement à la chaude présence des larmes jaillissant sous les paupières, conscientes de cette amertume liquide. » (Le Livre de l’intranquillité, p. 259)
Faire émerger la personnalité intellectuelle et esthétique de l’enfant ou de l’adolescent est une attente qui motive la plupart des pratiques de l’image, l’autre attente étant d’initier une critique des images des autres par la fabrication de ses propres images. Pour l’intervenant Julien Garric, « s’il y a un enjeu esthétique dans ses œuvres imparfaites que nous aidons à faire naître, c’est dans cette expression de l’enfance, ou de l’adolescence, dans cette fragilité en devenir dont le cinéma ne nous parle qu’à partir de son point de vue adulte. » (dans les actes des premières rencontres nationales pour l’éducation au cinéma et à l’audiovisuel, Orléans, mars 1999, p. 30). Autrement dit, la participation des jeunes à la fabrication d’un film est la chance de faire émerger au sein des images la fraîcheur qui caractérise leur regard, et de renouveler le cinéma de cette façon. La tâche de l’intervenant est de réunir les conditions de cette émergence. Selon quel degré d’implication ?
VI. La place de la pratique : une expression, un apprentissage
L’atelier vidéo est l’aboutissement d’une réflexion au long cours sur la place de la pratique dans la démarche éducative. Celle-ci correspond à un objectif double : un éveil esthétique (faire des images rend plus sensibles à leur langage plastique), une curiosité pour l’environnement immédiat (faire des images de cet environnement pousse à le redécouvrir, valoriser son aspect, chercher les ressorts de son activité et de sa sociabilité.) Dès 1976, c’est dans un même souci d’enquête et de d’éducation du regard que la revue Scouts invite les jeunes à pratiquer le reportage photographique :
« La photographie vous force à regarder la vie avec un regard neuf, vous force à prêter attention aux mille détails qui vous entourent, qui vous plaisent ou vous dégoûtent (…) Vous ferez alors ce que font tous les photographes, montrer ce que l’on a vu et ressenti, pendant une fraction de seconde devant tel paysage ou tel personnage… un petit peu de vous sera à l’image (…) Vous passerez alors du domaine du consommateur d’images, impuissant et obèse, à celui de producteurs exprimant et ayant quelque chose à dire. » (« Club des inventeurs » dans Scouts, nouvelle série n° 1, jan. 1976).
Monique Martineau témoigne de tentatives pionnières d’ateliers vidéo (“Des jeunes à la caméra”, fév. 1985, CinémAction n° 74) réalisées dans les années soixante-dix. Ils sont l’objet d’expérimentations isolées, menées au lycée de Vitry, dans les réseaux d’éducation populaire, avec le concours de l’INA. Il faut aussi compter sur l’initiative de professeurs isolés, comme Christian Rouaud, professeur de lettres, passionné par le cinéma autant que par la transmission, qui a fait quelques tentatives de films collectifs avant de devenir réalisateur pour le compte du CNDP puis documentariste à part entière (cf. ses films sur Lip et le Larzac). Selon Monique Martineau, l’atelier mis en place dans les années soixante-dix et quatre-vingt représente une expérience impulsée « par l’idéologie de la création collective qui, dans les milieux sociaux, exerce une véritable hégémonie depuis mai 68. » Elle cite Zarifian, comédien qui appartient au théâtre du Soleil, troupe fondée en 1964 sur l’idée de mettre les idées et les énergies en commun sans souci de distinguer une vedette ou un auteur : « Le travail collectif, c’est quand une idée émise par l’un des participants est prise en charge complètement par les autres, devient motrice, mobilisatrice. » En cinéma, c’est l’œuvre sans réalisateur, à laquelle ne s’associe nul égo. Monique Martineau ajoute que la pratique de l’image doit s’associer à une « approche réflexive : elle suppose une liaison vivante avec les œuvres et généralement le patrimoine audiovisuel, et passe par l’acquisition de connaissances sur les aspects historiques, sociologiques, économiques du cinéma et de l’audiovisuel, ainsi que par l’analyse de leur langage en termes techniques, sémantiques et esthétiques. ». Elle pose de cette façon deux enjeux constants de l’atelier vidéo : son appropriation par les jeunes, la possibilité d’y trouver un espace de transmission. La place de la technique y est toujours secondaire : il ne s’agit pas de devenir cinéaste ou de maîtriser un poste de la chaîne de création audiovisuelle (au son, au cadre, à la lumière,etc.) L’éducation à l’image ne propose pas de pré-formation professionnalisante, sa priorité étant le rapport collectif à l’expression filmique, la sensibilisation par la pratique à l’art cinématographique, l’emploi du film comme vecteur d’expression de la jeunesse dans un contexte éducatif.
Une réalisation accompagnée
Un film réalisé dans une école ou une MJC suppose une collectivité de jeunes encadrés par un intervenant audiovisuel, le plus souvent réalisateur professionnel, et un personnel éducatif. Deux activités sont corollaires à la réalisation proprement dite : la prise en main du groupe et l’apprentissage technique. L’expression du jeune est dès lors une expression plurielle et encadrée, elle rencontre les limites que posent les impératifs pédagogiques et la multiplication des acteurs. En outre, le processus créatif n’est pas à sa seule charge, il induit la participation de l’intervenant qui doit mener le projet du film à bien.
Ceci pose une problématique au cœur de la finalité pédagogique de l’atelier. Comment faire en sorte que le projet aboutisse et que le film demeure une création des jeunes ? À cette question, pas de réponse unique : il faut examiner les différentes options prises sur le terrain. Car si l’intervenant s’efforce de favoriser l’appropriation de ce projet par les jeunes, ses suggestions, ses initiatives, mettant en jeu son savoir et sa sensibilité, vont donner à ce projet des orientations décisives. Autant que des apports des jeunes, les contenus d’un film vont dépendre des modalités d’implication de l’intervenant, lequel a été pressenti pour sa personnalité artistique et son expérience de réalisation. À lui de dynamiser la créativité du groupe, de traduire ses idées en langage audiovisuel, de veiller à leur possibilité de mise en œuvre. À lui cependant de ne pas s’imposer, de ne pas confisquer le projet au profit de ses propres ambitions, ou même de ses attentes a priori vis-à-vis des jeunes.
Ghislain Honoré, intervenant audiovisuel en atelier, décrit ainsi la problématique liée à son rôle: « Est-ce que l’artiste a à s’exprimer avec les jeunes ? Est-ce que c’est son film ? De quelle façon il peut prendre les jeunes en otage pour réaliser ses idées ? » Plus loin, Philippe Buiatti, autre intervenant, ajoute que « lors de la rencontre entre amateurs d’images et professionnels, il existe toujours un moment où une partie du projet peut échapper au jeune. » (dans les actes des Rencontres européennes des jeunes et de l’image organisées par l’association Kyrnéa en 1999 ).
Tout film d’atelier se ressent de cette confrontation / collaboration entre adultes et jeunes, et c’est l’expression de cette dialectique qu’il s’agit de lire dans les images.
Comparons Je suis d’ici, réalisé dans le lycée Cressot à Thionville, et Tout le monde est occupé réalisé à la MJC de Fécamp, lesquels évoquent l’un comme l’autre le rapport des jeunes avec la ville qu’ils habitent. Alors que le premier semble un pêle-mêle confus de séquences mal cadrées, au son souvent inintelligible, le second obéit à un scénario précis, et si l’image tangue quelquefois, il reste soigneusement filmé de bout en bout, et monté avec le même soin. Il est évident que le film de Fécamp a bénéficié d’un suivi intense de la part de l’intervenant : il s’agit d’Ariane Doublet, documentariste qui a réalisé des œuvres marquantes comme Les Terriens et La Maison neuve (ces deux films tournés dans les zones rurales de Normandie se distinguent par leur approche sensible, tendre et humoristique de ses personnages paysans aux prises avec la modernisation du cadre de vie rural qui bouleverse les repères acquis). À voir les films d’atelier qu’elle encadre, il est tentant de lui attribuer l’initiative des plans de coupe qui le rythment, de deviner un regard de cinéaste derrière cette manière d’articuler ses différentes séquences. Le résultat en est une enquête passionnante menée sous la forme d’un micro trottoir : au gré des questions que les jeunes vont poser aux passants, se succèdent des échanges qui tour à tour amènent à méditer sur l’emploi que l’on fait de son temps au jour le jour, voire sur la distance de la vie entière, expriment les malentendus et les bonheurs qui caractérisent les relations entre les jeunes et leurs aînés. Dans le film réalisé à Thionville, en revanche, il ne s’agit plus de méditer, mais de se laisser déstabiliser par ses images hirsutes, indécises, qui montrent des bouts de jambes dans l’allée d’un square à la nuit tombée, des panneaux de circulation tagués, des pans d’une réalité rapportée telle quelle, par les jeunes qui la vivent, au moyen de la caméra qui leur a été confiée.
Analyser ce type de films ne consiste pas à écarter une démarche au profit de l’autre dans une vaine quête d’authenticité, mais à préciser, chez chacune, en quoi la jeunesse fait image. L’une a suscité des images brutes qui présentent la richesse d’un regard immédiat. C’est la richesse de ces images « sauvages » qu’évoque François Campana, lesquelles permettent d’atteindre directement l’intériorité du jeune public : « Il est remarquable que les jeunes se sont emparés des outils et inventent des images « sauvages »(…), nés de leur besoin d’exister, d’être entendus. » (dans les actes des Rencontres européennes des jeunes et de l’image organisée par l’association Kyrnéa en 1999). L’autre est le fruit exceptionnel d’un dialogue adultes – jeunes, aussi bien sur le plan du contenu du film que sur sa réalisation, qui engage davantage l’intervenant. Ces deux exemples reflètent la diversité des projets d’ateliers et des priorités qui les sous-tendent, entre expression libre et pédagogie, selon qu’on veut privilégier chez les jeunes la parole et la créativité, ou bien l’échange et l’apprentissage avec les adultes qui les accompagnent.
Les thèmes et les styles
Par-delà la diversité des contextes et des origines géographiques, il est possible de pointer des récurrences pointées dans la forme et l’inspiration. Elles témoignent d’une culture d’images et de préoccupations commune. Les thèmes qui se sont affirmés, s’ils ne sont pas donnés à l’avance, sont souvent biographiques, liés à l’environnement social et aux relations affectives. Aboutissement d’une pratique, les films d’ateliers sont aussi à considérer en tant que tels, reflets de choix esthétiques et porteurs de discours. À ce titre, ils deviennent susceptibles interpeller un public plus large que l’entourage immédiat des participants, en particulier quand ces ateliers ont impliqué des adolescents : comme le rappelle Odette Mitterrand, « entre fusion et rébellion, force et vulnérabilité, fusion et rejet d’affection, espoir et angoisse, les adolescents ingèrent ou rejettent des particularités parentales, des impacts collectifs, des singularités sociales. » (« À ricochets entre famille et société » dans Zéro de conduite – revue de l’union française du film pour l’enfance et la jeunesse, hiver 2007-200, n° 67). C’est en considérant les films d’atelier comme un potentiel d’expression propre à la jeunesse, à même de refléter sa condition, que l’équipe de la Maison de l’image de la Ville de Strasbourg en a fait une programmation thématique : la Quinzaine du Regard Jeune. Durant quatre ans (2002-2005), elle a sollicité les différentes structures en jeu, en temps scolaire ou hors temps scolaire, pour découvrir leurs productions et invité les jeunes réalisateurs aux séances où leurs films étaient programmés. Cette expérience de confrontation des regards a mis à jour quelques préoccupations communes.
De la sitcom à la poésie
En même temps que l’autoportrait satisfait leur désir de se raconter, c’est une manière pour les jeunes de s’approprier facilement les éléments de réalisation : le scénario s’appuie sur leur vécu, les dialogues se nourrissent de leur langage, les acteurs sont souvent amenés à jouer leur propre rôle, qu’il s’agisse d’eux-mêmes ou des personnes de leur entourage. Les lieux de tournage reproduisent la géographie du quotidien, depuis la chambre avec ses posters, ses peluches et son ordinateur, jusqu’au bar en face du lycée avec son baby foot, en passant par les bancs des arrêts de bus désertés, les marches de béton au bord des cours de récréation.
Toutefois, cette même réalité leur inspire des traitements très divers qui s’observent d’un film à l’autre. Il y a la mise en scène réaliste revendicative : ainsi le morne Blues du bac (CSC Le Lierre, Thionville), montage cut d’images prises sur le vif au sein d’une classe de terminale, qui montrent les élèves affaissés sur les pupitres, les yeux vides, répétant le mot « Bac », d’une voix atone, le mâchonnant comme un chewing-gum qui a perdu son sucre. Il y a aussi la voie parodique, à l’image de Sitcone (Lycée Lambert, Mulhouse, 2002) qui reconstitue des dialogues entre copines en empruntant les codes de la sitcom télévisuelle : une manière d’auto – caricature, née de l’observation sur soi d’une intégration précoce des codes sociaux et des enjeux du paraître. Le recours à la poésie n’est pas exclu, tel l’étrange, Puzzle (Lycée Lambert, Mulhouse) réalisé par Emilie Vigano, dans lequel une lycéenne, pour faire le portrait de sa camarade fraîchement arrivée de Nouvelle Zélande, part de son intériorité même, par une suite de dessins tirant vers l’abstrait, aux couleurs et aux formes qui varient selon l’humeur ou l’événement lié à la découverte de son nouveau milieu, se rapprochant ainsi d’une représentation de nos images mentales.
Les sentiments à l’écran
La prédilection des jeunes pour le clip nous donne un accès privilégié à leur monde. Cette forme leur permet de citer les musiques qu’ils apprécient, d’imiter la gestuelle et l’apparence des vedettes qu’ils admirent. Ils y voient aussi, par le saut d’une séquence à l’autre sans transition narrative, le moyen de témoigner d’un quotidien fragmentaire, caractérisé par des ruptures de registres, entre la banalité identifiée de l’environnement dans lequel ils évoluent, et le glamour du monde médiatique dans lequel ils se projettent. Un élément de mise en scène y ajoute une dimension plus intime : dans les dernières images, voire celles du générique, ils se filment souvent en groupe, leurs visages se pressent dans le champ pour y tenir le plus nombreux possible, à l’unisson dans le fou rire, histoire de montrer que c’est ensemble qu’ils envisagent rêve et réalité, et que c’est l’amitié qui reste.
La question des rapports garçons – filles est abordée plus tard. Les films qui s’en emparent font souvent preuve de délicatesse, mettant en scène un désir de dialogue, de construction d’une parole à deux, par-delà les stéréotypes mutuels, la pression du groupe qui influe sur le cours des sentiments, comme en témoignent des productions lycéennes, à Wissembourg, Mulhouse, Bischheim.
La démarche documentaire : aller chez les autres, le sens de l’Histoire
L’atelier vidéo qui emprunte les méthodes documentaires implique davantage les encadrants dans sa conception. Le jeune public, de façon générale, est spontanément séduit par la possibilité de raconter des histoires, de faire vivre des personnages comme ceux qu’ils apprécient de voir lorsqu’ils vont voir des films. Le registre documentaire les invite à s’extraire de leur imaginaire et de leurs codes culturels pour se tourner vers les autres et leur environnement. Il est davantage question d’enquête, de témoignage, de rapport à un réel partagé par d’autres qu’eux. L’apport pédagogique d’un atelier documentaire set double :
– Apport réflexif : interroger sa place dans le monde, mettre en relation sa propre situation avec celles des autres, renouveler le regard que l’on porte sur soi et son environnement au moment où il s’agit, par le projet du film, de lui donner une forme transmissible,
– Apport de sociabilisation : mettre à profit le dispositif de tournage pour aller au-devant des autres, ouvrir un dialogue avec les personnes de rencontre que l’anonymat rend difficile au quotidien.
Le microtrottoir, la possibilité d’un dialogue
À ce titre, il est à noter que l’expérience du microtrottoir plait beaucoup à la plupart des jeunes participants. Leur enthousiasme pour cette expérience montre qu’ils sont très désireux, au quotidien, de rencontrer et dialoguer avec les inconnus qui les entourent, qui font partie de leur paysage, et qu’ils voudraient mieux connaitre. Le dispositif de tournage a, à cet égard, une vertu désinhibante. Ceci est bien illustré par le film réalisé à Fécamp, Tout le monde est occupé, accompagné par Ariane Doublet : sur le thème de l’ennui, les jeunes vont interroger les passants dans la rue. C’est l’occasion de confronter des considérations sur le temps qui passe, les âges qui se succèdent, le sens qu’il est possible ou non de donner à l’existence. Certes, le film met à jour les stéréotypes que les adultes nourrissent souvent à l’endroit des jeunes, mécontents de les voir désœuvrés, inconscients de l’ennui qu’ils traînent eux-mêmes au quotidien. Il montre aussi des beaux moments de dialogue entre les adultes et les enfants, comme ce monsieur qui les invite à « continuer d’être eux-mêmes et surtout, de rester peinards ! » Conseil humble, voix de l’expérience.
De même dans L’envol, film d’atelier que la Maison de l’image de Strasbourg a mis en place avec le Théâtre Jeune Public, au moment de la préparation d’un spectacle mis en scène par Alice Laloy sur le thème de la passion amoureuse, les séquences de répétition alternent avec un microtrottoir sur le thème de l’amour. Les réponses des passants interrogés sont souvent étonnantes de sincérité, touchantes par la façon dont ils mettent les jeunes interviewers au niveau de leurs interrogations intimes. À l’image, le micro-trottoir montre des jeunes qui vont à la rencontre des adultes, les stoppent dans leur démarche pour les solliciter, courent le risque du refus, tendent le micro et écoutent ceux qui veulent bien jouer le jeu.
Le monde professionnel en question
Faisant écho aux productions anciennes de la télévision scolaire qui s’adressaient aux classes de transition, certains ateliers proposent des portraits de métier. Ils poursuivent la même démarche qui consiste à mettre un visage sur un profil de métier, ceci à un moment où l’échéance de l’orientation professionnelle s’impose. Il peut s’y ajouter une lecture genrée comme le propose ce film d’atelier du Centre Vidéo de Bruxelles où les jeunes participants s’adressent à des femmes exerçant un métier habituellement associé au sexe masculin : agent de police, chauffeur de taxi… Là encore, c’est l’occasion de mettre en question les stéréotypes que la norme sociale inculque aux nouvelles générations.
Dans la chronique qu’il tenait sur le cinéma amateur pour Image et son, Jean-Louis Cros défendait l’idée que le réel offrait une source inépuisable de sujets de films à toute personne en quête d’inspiration : « Déroulement familier d’un jour, cycle des saisons, « rythme » d’une ville, d’un village, d’un métier ; chronique fraternelle des hommes dans leurs maisons, dans leurs amitiés, dans leurs peines, voilà ce qui s’offre aux caméras des amateurs, si ces derniers veulent bien abandonner leurs idées toutes faites et aller au réel avec un peu d’humilité. (…) Ici, les notions de documentaire, de film d’action s’effacent pour laisser place à une sorte de synthèse en laquelle beaucoup voient l’une de richesses fondamentales de l’avenir. » (« À la recherche du sujet » dans Image et son – revue de l’UFOLEIS, n° 92, mai 1956, p. 11). Sans doute ce réel de proximité reste un contexte privilégié pour les ateliers vidéo, convoquant, au moment de son élaboration, des références fondamentales comme les courts métrages de Georges Rouquier ou les Portraits d’Alain Cavalier, évocation sensibles et profondément originales d’un réel à portée de main.
VII. L’atelier en prison
L’enjeu de la culture en prison
Un des domaines privilégiés de l’éducation à l’image adressée au public adulte est le milieu pénitentiaire. Elle s’inscrit dans un souci de développement culturel en milieu fermé afin de favoriser le maintien du lien des détenus avec le dehors et de préparer leur réinsertion. La première secrétaire d’État à la condition pénitentiaire, nommée en 1974, évoque le « devoir de la société de ramener le délinquant sur nos rivages difficiles pour y retrouver une chance d’exister. » (Thierry Dumanoir, De leurs cellules, le bleu du ciel, Paris, 1994). Symétriquement, un besoin se manifeste de rendre l’organisation pénitentiaire plus transparente pour opérer un contrôle de l’opinion publique sur la politique sécuritaire exercée vis-à-vis des détenus. Durant ces mêmes années soixante-dix, le philosophe Michel Foucault a attiré l’attention de l’opinion sur les zones d’ombre de l’espace social comme les prisons. Avec Pierre Vidal-Naquet et Jean-Marie Domenach, il fonde le Groupe d’Information sur les Prisons (GIP) avec l’intention de développer l’étude du système carcéral et de relayer la parole critique des détenus. Ceci eut pour effet l’entrée des médias, presse et radio, dans l’enceinte des milieux pénitentiaires. Le manifeste du GIP affirme : « Peu d’informations se publient sur les prisons ; c’est l’une des régions cachées de notre système social, l’une des cases noires de notre vie. Nous avons le droit de savoir, nous voulons savoir. »
La mise en place d’une activité culturelle en prison se situe donc à l’intersection de deux besoins : maintenir le lien des détenus avec l’extérieur, faire en sorte qu’ils ne s’abîment pas dans la solitude pénitentiaire et la désespérance sociale, et rendre accessible le milieu pénitentiaire aux citoyens qui coexistent avec lui. Quand il s’agit de film, un enjeu s’ajoute : l’introduction de l’image dans la prison enregistrant la réalité des lieux témoigne de ses conditions de séjour ; par ailleurs, la nécessité de préserver l’anonymat des détenus en masquant leurs visages prive toute réalisation d’un lieu privilégié d’expression, d’un élément cinégénique qui permet la rencontre du personnage avec le spectateur.
Un effort de développement culturel en prison se poursuit depuis el début des années quatre-vingt. Quelques jalons :
– Depuis la création d’un service des bibliothèques en 1963, une collaboration avec les bibliothèques municipales est initiée avec la mise en place concomitante des ateliers d’écriture
– expériences théâtrales (Armand Gatti) et musicales (Nicolas Frize)
Premières initiatives audiovisuelles
Le processus de l’insertion de l’audiovisuel, par la diffusion et la production de films en prison, est marqué par plusieurs étapes :
– premiers projets de réalisation vidéo en collaboration avec des détenus de Lyon : l’association « Comme une image » réalise six films à partir d’une sélection opérée sur 40 scénarios adressés par des détenus ; à la Santé de Paris, mise en place par Alain Moreau de l’ENSAD de réalisation de vidéolettres entre des détenus et les personnes avec lesquelles ils avaient choisi de correspondre. Un magazine vidéo est créé dans la même prison de la Santé par une association, « Fenêtre sur cour », un documentaire est réalisé dans la même dynamique sur les rapports des habitants du quartier avec la prison : La Santé, une prison dans la ville d’Isabelle Martin (1985). Dès ces premières expériences se pose la question de montrer les visages des détenus dans images, surtout celles diffusées à la télévision. La chancellerie s’y oppose pour trois raisons : 1. Ne pas choquer les victimes qui seraient amenées à les voir 2. Ne pas gêner la famille ou les proches 3. Eviter que les détenus qui ont consenti à cette captation et diffusion de leurs visages puissent en être victimes au moment de leur réinsertion. (Thierry Dumanoir, De leurs cellules, le bleu du ciel – le développement culturel en milieu pénitentiaire, Paris, 1994, p. 58)
– Les réalisations documentaires sur la prison se multiplient comme celui de Renaud Victor, (De jour comme de nuit, en 1990), Carole Roussopoulos (Les clés de Mauzac, 1987), ou Jean-Michel Carré (Femmes de Fleury, 1990). À propos du film de Renaud Victor, tourné dans les Baumettes, Véronique Barondeau écrit : « Un des reproches qu’on faisait au film, c’est de donner la part belle aux détenus ; c’est de présenter des criminels sans porter de jugement. Or c’est justement ce que Renaud Victor ne voulait pas faire : porter un jugement » (dans « Rétroviseur », n° 1, jan-fév 1993, p. 17). Dépasser le jugement, impliquer les détenus dans la réalisation : deux principes qui préparent le dispositif de l’atelier en prison.
– Introduction en 1985 des premiers postes de télévision à titre individuel, en cellules. Pierre Bongiovanni, directeur du CICV de Belfort interroge : le succès est immédiat mais les interrogations émergent sur le sens de leur usage : est-elle vouée à ne fonctionner que « comme anxiolytique électronique » ? (dans « Rétroviseur », n° 1, jan-fév 1993, p. 5). En réponse, des premières télévisions de proximité en prsion voient le jour comme TVB en 1987 (Télévision Baumettes) ou « TV contact » à Strasbourg.
Dans ce contexte, de plus en plus de dispositifs intégrant les détenus sont imaginés, impliquant chaque fois des intervenants :
– correspondance vidéo avec des personnes libres, « Télérencontres » (à la Santé), animé par Alain Moreau en 1992, d’abord limité aux familles des détenus, puis à des volontaires de la société civile. Alain Moreau estime que les lettres filmées des détenus sont les plus intéressantes : « Les détenus, eux parlent ! Soit qu’ils se campent devant la caméra pour conter leur histoire, soit qu’ils commentent des images de leur vécu quotidien pour bien nous faire entendre ’qu’en prison, il n’y a rien à voir’ » (dans « Rétroviseur », n° 12-3, avril-sept. 1993, p. 14.)
– création d’un journal hebdomadaire, diffusé deux fois par semaine dans le canal interne aux Baumettes, coordonné par TVB. C’est l’émission « Coursive ». Gilbert Reilhac décrit l’un de ses contenus les plus forts : « Le journal a permis d’ouvrir des échanges entre détenus et personnes de l’extérieur invitées. Ainsi, des juges d’application des peines ont été interrogés par des détenus, qui mènent le plus souvent leur entretien. Leur manière de conduire ces interviews fait qu’ils abordent très rapidement ces problèmes concrets. » (dans « Rétroviseur », n° 4, déc. 1994, p. 14). Cette démarche de médiation audiovisuelle entre une autorité et les personnes dont elle dépend, combinant doléances et débats, devient le principe de Moderniser sans exclure de Bertrand Schwartz, qui l’appliquera à d’autres champs sociaux.
L’émission « Coursive » a également donné lieu à des reportages, réalisés par des professionnels, dont le sujet a été inspiré par des détenus.
La gestion du parc matériel et des locaux est souvent partagée par des détenus. Un pas supplémentaire est fait quand ils réalisent eux-mêmes leurs films. Jean-pul Fargier remarque que la vision de la prison par les personnes qui y sont enfermées diffère de celle qu’en rapportent les réalisateurs qui viennent du dehors. Il observe par exemple que ces derniers filment les portes qui s’ouvrent et se referment avec un bruit solennel. Dans les films réalisés par les détenus, cette mise en scène est absente puisqu’on filme directement du dedans. Le spectateur découvre une vision portée par celui qui vit le lieu. « Les murs tombent. Les mur qui nous empêchent de voir la prison et qiu empêchaient que se regardent ceux qui s’y trouvent (…) Se voyant à travers le viseur d’une caméra, à travers la fenêtre d’un petit écran, ils s’aperçoivent enfin » (Jean-paul Fargier, « Y mettre les formes » dans « Rétroviseur », n° 1, fév.-mars. 1993, p. 3). Participer à un atelier, voir le film qui en résulte permet une double reconnaissance : reconnaissance de soi et des autres. Le contexte de la prison ne fait-il pas loupe sur une réalité plus générale ?
Comment continuer le travail d’éducation à l’image en prison ? Comment se situer éthiquement dans le contexte carcéral ? Alain Moreau, intervenant pour les lettres-vidéo de la Santé répond avec sincérité :
– « Pendant les années soixante-dix où, comme beaucoup de ma génération, je participais tous les combats contre l’oppression j’ai contourné la cause des prisonniers : je n’ai alors absolument pas compris ni suivi le mouvement intellectuel réuni autour de Michel Foucault dans le Comité d’Action Prison (…) Je n’ai vraiment aucune fascination pour le crime ; je n’ai pas lu un seul roman policier et n’accorde aux films noirs qu’un intérêt cinéphilique. Enfin je n’ai que de la colère pour ceux qui dealent à la porte du lycée de mes filles, pour ceux qui m’ont volé mon vélo, et m’obligent à payer une serrure à cinq points pour protéger ma caméra. Et pourtant, ce sont bine les mêmes personnes à qui je serre chaleureusement les mains quand ils arrivent un à un dans cette fameuse salle du centre de détention. Alors pourquoi suis-je là avec eux ? Je crois pouvoir affirmer maintenant mon intuition du début : c’est pour être au centre de mon métier de cinéaste et y tenir ma place, de façon entière et radicale. » (dans « Rétroviseur », n° 12-3, avril-sept. 1993, p. 13).
Plus loin, il explique comment il interprète son rôle de réalisateur-intervenant :
Dans cet échange de vidéo-lettres, ma place est celle d’un facteur, d’un passeur, et, auprès des détenus, d’un « cinéaste public ». Je suis dans ce paradoxe de la présence-absence, dans cet entre-deux qui est justement le propre de tout médiateur. En somme, la radicalité du carcéral m’a remis à ma place : être un artiste qui exerce pleinement l’essence de son métier d’intermédiaire. » (dans « Rétroviseur », n° 12-3, avril-sept. 1993, p. 15).
L’héritage : nouvelles démarches, nouvelles réflexions
Les premiers actes fondateurs de l’activité audiovisuelle en prison connaissent aujourd’hui des prolongements. Il s’agit toujours d’inviter les détenus à participer à la mise en œuvre d’un film dont le sujet a trait à leur quotidien ou leur identité. Ce film a pour seconde vocation de mobiliser l’attention de l’ensemble des citoyens, de donner à voir les conditions de détention, de créer un lien avec les détenus impliqués. Enfin, un tel film reconduit les problématiques de représentation des détenus : comment manifester leur présence physique ? Comment faire face à l’enjeu du visage dans son impossibilité de représentation ?
– 9 m2; chronique d’une expérience cinématographique en prison de Jimmy Glasberg et Joseph Césarini : les réalisateurs construisent différents sujets en collaboration étroite avec dix détenus des Baumettes d’avril 2002 à janvier 2003. Cette expérience est le prolongement de celles qui sont poursuivies depuis 1987, notamment avec l’implication de Joseph Césarini. Le principe de 9 m2 est le suivant : « Les réalisateurs avaient mis en place un dispositif pour cette expérience : dans un décor de cellule, des couples de détenus partageant le même espace d’enfermement se filmeraient et dévoileraient un pan de leur intimité. » (Clément Dorival, 9 m2 – chronique d’une expérience cinématographique en prison, p. 25) Le tournage a duré neuf mois. Il y est question du « jeu du je », d’une personnalité qui se révélerait par l’usage de la caméra. Comolli écrit sur l’expérience : « Les données du tournage elles-mêmes font récit, elles deviennent matière dramatique. La participation active des détenus, corps filmant et corps filmé, la fragile maîtrise de leurs gestes, de leurs jeux, la prévalence de l’expérience cinématographique sur le « vécu » judiciaire et carcéral, tout cela nourrit une narration insolite, telle que la réalité du tournage qui nous est représentée se substitue en partie à la réalité référentielle de la détention. » (ibid.. p. 20)
– JE / Deux mains, 2011 : avec le soutien de Kyrnéa International, coordonné par Adil Essolh, éducateur du STEMO de Koenigshoffen. La démarche est inspirée du film Les mains de Christophe Loizillon : c’est en effet les mains, le sujet essentiel des images de détenus auxquelles sont associées leurs témoignages de parcours. Les mains, comme substitut de visage, réservoir inouï d’expressivité.
– Fort intérieur de Chris Pellerin, 2014. Cette fois l’interdiction de filmer les visages mène à inviter les participant, trois femmes incarcérées, à réaliser un autoportrait par le dessin. « Mon désir, explique Chris Pellerin, était de ne pas être dans un rapport frontal, le « face à face » de l’interview, mais plutôt dans un côte à côte, de ceux qui expérimentent ensemble, et être dans un rapport d’apprivoisement mutuel ». Le film s’inscrit dans une trilogie : les deux autres volets concernent des personnes vivant en hôpital psychiatrique ou en maison de repos. Le laboratoire de création avec les femmes incarcérées a duré deux ans. Les objets de l’espace d’atelier sont détournés, table ou lavabo devenant supports de dessins. « Ce sont les représentations multiples de soi que le dessin permet qui m’intéressent, faire émerger en quelque sorte du caché, de l’invisible, des images qui affleurent à la surface, incontrôlées, avec leurs hésitations et leurs affirmations, leurs repentirs. (« Dessins du réel : paroles de réalisateurs » dans Bref n° 113, 2014, vol. 4). Ce qui fait film, c’est le dessin entrain de se faire et le commentaire qu’il suscite au moment où il se fait. Ceci implique une participation intense des détenus, quoiqu’ele ne s’opère pas derrière la caméra.
La réalisatrice et productrice Caroline Caccavale, coordinatrice de plusieurs ateliers au Centre Pénitentiaire de Marseille pour l’association Lieux Fictifs, propose de renouveler l’approche éducative en milieu carcéral en interrogeant la valeur spécifique de l’expérience de détention : « L’expérience du temps carcéral habité par un travail de création et de reconstruction nous interroge à l’extérieur, nous qui n’avons plus le temps de faire l’expérience des choses. Qu’est-ce que la prison et les prisonniers peuvent nous apprendre sur nous-mêmes ? Que peuvent-ils nous révéler de notre monde que nous ne sommes plus capables de percevoir ? » En quelque sorte il s’agit de retourner l’interrogation habituelle : que pouvons-nous leur apporter ? Par ailleurs, Caroline Cacavale insiste sur la dynamique que génère l’atelier dans un lieu voué à l’immobilité. Dynamique physique bien sûr, celle que requiert la mise en eouvre du film, y compris dans un espace contrait, dynamique mentale également, puisque « chaque expérience cinématographique est une expérience commune qui doit permettre à chacun de se transformer (…) de se décaler par rapport à ses habitudes mentales et affectives ». (« Lieux fictifs, les ateliers du cinéma en milieu carcéral » dans La lettre des pôles n° 10 printemps-été 2009).
VIII. Images d’archives, images de remploi
Depuis le début des années 2000, de nombreuses initiatives éducatives ont mobilisé les images d’hier. L’enjeu est double :
– d’une part, inviter le jeune public à faire œuvre de mémoire en découvrant ces images, en les manipulant et en les associant pour leur donner sens ?
– d’autre part, rendre sensible ce jeune public aux démarches esthétiques qu’inspire le remploi des images trouvées, façonnant notre imaginer en puisant dans des réservoirs d’images déjà-là.
L’image d’archives, passage de mémoire
Le premier objectif correspond avant tout à un souci de transmission : il s’agit, pour sensibiliser à l’expérience des générations passées, aux enseignements de l’Histoire, de miser sur l’attractivité des images, la fascination qu’elles exercent par l’énigme qu’elles renferment, l’écho qu’elles donnent aux choses du présent. Les images d’archives constituent de plus un tiers référent entre générations : il devient possible, à partir des représentations concrètes, triviales, qu’elles proposent de provoquer le témoignage de leurs contemporains. De nombreux documentaires se sont appuyés sur le dispositif de la projection des archives devant un témoin pour recueillir « à chaud » ses réactions. Il est tout à fait applicable en atelier. L’association Kyrnéa est allé plus loin avec le DVD « Je de mémoire » qu’elle a conçue en 2003. Proposant des ateliers autour de la mémoire de l’immigration, mobilisant des films d’archives, des objets culturels, des photographies de famille, l’association a cherché à promouvoir un dialogue intergénérationnel, un travail de mémoire qui concerne l’ensemble d’une collectivité, en s’appuyant sur les images. Pour François Campana, elles sont à mêmes d’aviver notre rapport collectif au passé :
Pour ne pas occulter une partie de l’histoire, il faut travailler sur la mémoire du présent. Dans cette dynamique, l’image a une place prépondérante. La dynamique de reconnaissance de l’apport de ces cultures de l’immigration ne peut s’envisager que dans la mesure où cette mémoire est captée. Il ne faut pas attendre plusieurs générations pour retranscrire, même si tout le monde sait qu’il est plus facile d’avoir une pensée quand le temps a calmé les passions. Si nous prenons les images de notre passé, celle de la guerre de 39-45 par exemple, aurions-nous gardé les mêmes souvenirs sans les images ? (Passeursd’images.fr consulté le 26 nov 2014)
Une production régulière d’ateliers qui mobilisent les images d’archives est orchestrée par Cinémémoire à Marseille. Depuis 2007, cette cinémathèque de films amateurs met en place des ateliers dont l’archive cinématographique servant de fil conducteur et de support à l’imaginaire. La finalité est documentaire :
Ces ateliers sont l’occasion de rencontres intergénérationnelles, permettant ainsi un échange entre petits et grands sur l’expérience concrète du temps, les évolutions techniques du cinéma et les changements urbains. (Cinememoire.net)
Certains films d’ateliers mis en ligne sur le site de Cinémémoire constituent de beaux exemples de ces rencontres intergénérationnelles suscitées par l’atelier. Bruits de chantier, film d’atelier de 2014 propose une sonorisation imaginée par les enfants, à partir de matériaux percussifs mis à leur disposition, d’un film de Gaston Vialis tourné en 1959 dans les chantiers navals de Marseille : imaginer des sons à associer aux images, c’est étudier les gestes de l’ouvrier, l’espace des ateliers dans lesquels il évolue. Un autre atelier, mis en place par Agnès O’ Martins et Claude Bossion dans le cadre des ateliers « Cinéma et Histoire », a invité des collégiens de 3e de La Ciotat à réaliser un film dédié à la mémoire de l’industrie naval de la ville, combinant images d’archives, entretiens avec d’anciens ouvrier, prises de vues sur le site des chantiers. Il en résulte un mini-documentaire intense, à même de transmettre aux habitants une mémoire à un espace urbain qui consiste en une immense zone laissée en friche. Selon Claude Bossion, l’étape de tournage intégrée dans l’atelier permet de dynamiser le rapport à l’archive, de ne pas en rester à une approche muséale qui risque de lasser les jeunes spectateurs.
Un partenariat avec les lieux de collecte et de valorisation
Travailler avec les images d’archives suppose de bénéficier de leur mise à disposition par des lieux de collecte et de conservation agréés. Selon Robert Poupard des Archives françaises du film, « l’éducation artistique s’inscrit dans la mission de valorisation du patrimoine cinématographique. (…) Depuis une quinzaine d’années, l’éducation à l’image a été un peu pratiquée au coup par coup : des visites de classe avec une présentation sommaire des lieux et des collections, et depuis peu, des ateliers pédagogiques. J’imagine mettre en place des ateliers d’écriture à partir de films qui ne seraient pas montés et des reconstitutions d’histoire avec des film qui seraient à l’état de rushes. » (dans La Lettre des pôles n° 14, printemps-été 2010-2011.
Depuis lors, plusieurs initiatives d’ateliers s’inscrivent dans ce même type de démarches, aidé par la constitution du réseau des Inédits d’Europe, centralisé à Bruxelles, un travail de collecte des images amateures ou institutionnelles locales sont rassemblés et numérisés. Dans certaines régions de France, un travail d’éducation à l’image est mis en œuvre autour des images qui peuvent être mises à disposition. Quelques exemples : en Poitou-Charentes, un atelier pour les écoliers mis en œuvre par le FAR (fonds audiovisuel de recherches) en 2013 : il s’agit d’écrire une fiction à partir d’images d’archives amateurs. La collaboration avec le FAR se fait par la mise à disposition d’un intervenant et une visite préalable dans son musée. En région Centre, l’atelier « Les images intimes : Prisonnière des souvenirs » mis en œuvre par CICLIC, avec l’intervenante Hélène Abram, est centré sur les images d’archives. Il s’agit de films de familles, images supposées rester au sein du cercle familial, qui sont ici détournées pour inventer une histoire. Les intervenants ont proposé aux participants de mêler à ces images des vues filmées au téléphone portable afin de confronter les traitements d’images amateures d’hier et aujourd’hui. A remarquer que les ateliers du FAR et de CICLIC ont commencé par une visite au centre d’images d’archives local.
Le remploi aujourd’hui : la créativité à partir des images déjà là
Avec le développement des outils numériques, l’éducation à l’image a accès à une multitude d’images dont elle peut faire le matériau d’ateliers. Le film de montage est un genre qui s’est imposé dans le cinéma d’avant-garde ou expérimental. Dans les années 1960 aux États-Unis émerge le courant du found footage, réalisation à partir de « métrage trouvé ». Dans les années quatre-vingt dix, le sampling s’était imposé dans les pratiques musicales courantes. Il s’applique de plus en plus couramment aux images. En tenir compte dans un contexte éducatif suppose de s’adapter à des formes de création propres aux générations nouvelles. Si le travail à partir de l’image d’archive se présente comme un passage de témoin, favorisant la transmission des plus anciens aux plus jeunes, la technique du Mash up, l’échantillonnage d’images libres de droit, ces pratiques inédites sont peut-être l’occasion d’un renversement pédagogique, les plus jeunes initiant les plus anciens, en tous cas, d’un partage éducatif.
La question centrale demeure : quel regard porter sur l’image ? À quel usage la destinons-nous ? Une pratique plastique change la perspective, privilégiant l’aspect de l’image (texture, couleur, composition…), comme en témoignent les ateliers mis en place par l’association Ad Libitum à Grenoble à partir d’archives de films amateurs : selon le critique Marcos Uzals, « sans exclure la narration, il s’agit surtout de créer à partir de la matière et de la texture même des images. Nous sommes alors plus près d’une démarche expérimentale où les images sont moins considérées pour leur sens que pour leur dimension plastique. » (« Archives cinématographiques et pratique artistique » dans La lettre des pôles n° 14, printemps-été 2010-2011).
Cette mise à distance du sens devrait interroger les acteurs de l’éducation à l’image, laquelle est supposée réinvestir de sens les dites images.
La nouvelle donne qu’offre le contexte de la toile numérique permet d’ouvrir de nouvelles pistes de création. Mais la problématique du regard et de la maîtrise du discours demeure, quel que soit l’environnement technologique et son degré d’accessibilité. Bernard Mathonnat, à propos de l’usage éducatif de la vidéo, réagissait par une mise en garde :
« Contrairement à certains mythes qui ont pu circuler dans les pratiques socioculturelles et d’animation dans le paysage culturel des années 70/80, ces avancées techniques n’ont pas permis une réelle démocratisation de la création ni un élargissement des publics. (…) Les nouvelles techniques vont améliorer le montage, les problèmes de conversion entre supports numériques et offrir de nouvelles libertés aux créateurs. Mais seuls de véritables poètes sauront nous étonner et nous faire rêver. » (« L’image à corps perdu » dans Zéro de conduite – revue de l’union française du film pour l’enfance et la jeunesse, jan. 2004, n° 52, p. 13).
Par Joël Danet – Vidéo Les beaux Jours (2014)