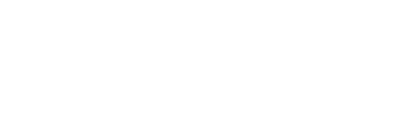Alors que souvent tel acteur ou telle actrice peut être la raison même pour laquelle on se rend au cinéma, l’acteur est longtemps resté un oublié de l’analyse filmique.
Publié le 15/12/2020, Mis à jour le 01/05/2023
A part quelques adjectifs (« formidable », « émouvant », « impressionnant ») peu évocateurs, on peine souvent à mettre des mots sur ce que concrètement fait l’acteur 1, sur la manière dont cela révèle un personnage et sur l’effet que cela produit sur nous. Par Hélène Valmary, enseignante en études cinématographiques.
Le critique Michel Chion affirmait que :
« L’acteur est (…) le remords du critique, celui qui lui fait sentir les limites de sa compréhension et le ramène à la sensibilité commune, diffuse, intuitive, du spectateur courant. Les références, les échelles de valeurs dont disposent les critiques spécialisés les rendent peu capables, sinon d’apprécier, en tout cas de décrire et d’analyser la création – souvent nommée par eux, avec une certaine pointe de dédain, “performance” – d’un Christopher Walken ou d’une Dianne Wiest. Ils se bornent donc à la solution à laquelle comme les autres j’ai souvent recouru, de l’adjectif entre parenthèses : “Robert De Niro (formidable)” ; “Cher (remarquable)”, etc… » 2.
Ainsi, le critique saurait décrire et analyser comment un film fonctionne, mais pas comment un acteur y joue et un personnage s’y crée. Au mieux peut-il noter que quelque chose se passe qui le touche ou l’agace sans qu’il en maîtrise la raison, quelque chose qui vaudra à l’acteur un adjectif qualificatif entre parenthèses.
Diverses raisons à cela : la principale est peut-être celle de la subjectivité. L’acteur, objet d’amour, a pu sembler échapper à l’objectivité scientifique. On a pu également objecter parfois à l’analyse de l’acteur l’impossibilité de faire la distinction entre la part créatrice revenant à l’acteur lui-même, celle appartenant à la direction du metteur en scène, ou encore au montage. Ou encore l’impossibilité de vérifier que ce que l’on voit dans tel ou tel aspect de son jeu est bien ce que l’acteur a voulu y mettre. Comme pour toute analyse, ce qui importe est d’arriver à s’emparer de ce qui, à l’écran, nous interroge, nous touche, voire nous met mal à l’aise ; de comprendre ce que l’image produit comme effet et comme sens pour nous qui regardons. Savoir de qui précisément proviendrait telle ou telle trouvaille visuelle ou narrative est souvent impossible : le cinéma, un film, est une aventure collective. Néanmoins, l’analyse du travail d’un acteur de film en film peut (comme pour tout autre technicien du film) permettre de mettre en lumière des thématiques, des gestes qui lui sont propres. Ainsi Luc Moullet, dans le premier ouvrage français défendant une approche du cinéma par les acteurs, pouvait-il montrer la récurrence du jeu avec ses mains de James Stewart et affirmer, exemples de films à l’appui, la ligne directrice de l’ensemble de ses personnages : « Stewart, c’est l’homme ordinaire qui tente de rejoindre le mythe, mais n’y parviendra jamais » 3. Ou encore Fabien Gaffez a-t-il pu écrire de manière très éclairante que « L’art de Johnny Depp est d’abord un art du décentrement. Cette idée s’applique aussi bien à sa place dans l’économie hollywoodienne, qu’à ses choix de personnages ou à sa manière insolite de les incarner » 4.
Enfin, on peut se sentir freiné dans l’analyse en voulant et ne sachant pas comment faire la part des choses entre ce qui tient de l’acteur et ce qui appartient au personnage, soutenu dans cet empêchement par la croyance que, si on voit ou regarde l’acteur dans un film, c’est forcément au détriment du personnage. Une certitude persiste que l’acteur doit s’effacer, disparaître derrière le personnage. En réalité, les deux se confondent et se nourrissent, que l’on parle des stars de cinéma, des comédiens professionnels ou des amateurs et de personnages issus de la littérature ou de scénarios originaux. L’acteur et le personnage s’emboîtent différemment selon le statut de l’acteur, la pré-connaissance du personnage par le spectateur, parfois se déboîtent, mais en aucun cas l’analyse de l’acteur ne se fait au détriment ou à l’exclusion du personnage.
Nous nous proposons ici, à travers quelques exemples, de voir comment l’acteur peut être un objet et un outil d’analyse. Dans un premier temps, nous parlerons du physique de l’acteur, puis de la manière dont un acteur ne joue jamais seul mais avec des partenaires, des accessoires, pour enfin nous pencher sur la manière dont un acteur joue un personnage et dont son interprétation l’éclaire. Ces approches, bien que séparées ici, ne sont à la fois ni exhaustives ni exclusives les unes des autres.
L’acteur et le type
Un acteur ou une actrice apparaissant à l’écran produit aussitôt un effet chez le spectateur. Star ou acteur amateur, l’acteur dégage quelque chose par son physique, son apparence, et le film travaille parfois à partir de cette impression de départ. Jouer peut-être ainsi jouer de ou avec son apparence et ce qu’elle induit pour le spectateur. Jouer de son visage, de son physique et de ce qu’il draine comme sens.
Le réalisateur russe Serguei Eisenstein (1898-1948), dans un texte intitulé « L’art de la mise en scène » qui semble par endroits poser les bases de l’art du casting, explique la nécessité pour le metteur en scène d’arriver à formuler, en amont de la recherche de son/ses acteur(s), ce que l’apparence physique de son interprète pourra porter du personnage :
« Il faut sentir quelle apparence extérieure sera la plus apte à soutenir la tâche émotionnelle dévolue au personnage. Et là, comme toujours et partout, il est très important d’entrevoir cette image avant de la fixer. L’image du personnage doit garder une certaine élasticité. C’est dans ces conditions que le choix de l’acteur se déroulera avec le maximum de justesse – en processus double. D’une part, vous commencerez à entrevoir dans l’œuvre et dans votre manière de la traiter une série de modifications, de transformations des personnages. D’autre part, vous verrez défiler devant vous une série d’êtres humains concrets, vivants – les acteurs. C’est de la rencontre, de l’interpénétration réciproque de ces deux séries d’images que naîtra la solution définitive » 5.
Eisenstein travaillait de deux manières à partir de cette apparence de l’acteur, ce qu’il appelait le « type » dont relèveraient ou auquel renverraient certains acteurs. Ce « type » peut selon lui exister sous deux formes. D’abord, sous la forme de l’apparition, rapide, fugace, par laquelle l’amateur incarne, le temps d’un gros plan, un type social : l’ouvrier, le patron, le paysan, la mère etc. On retrouve cet usage du visage typé chez Eisenstein et Laurent Cantet : dans La Grève (Eisenstein, 1924) et dans Ressources humaines (Cantet, 1999), les cheveux lissés, les petits yeux, les joues rebondies marquent le visage du patron là où les ouvriers possèdent des traits plus émaciés, des cheveux en bataille et un grand front plissé. Cette apparence physique induit déjà pour le spectateur du sens : le patron est celui qui mange bien, a le temps de se faire beau là où l’ouvrier est celui qui a moins le temps de manger ou de se coiffer (voire le patron est celui qui s’engraisse au détriment de l’ouvrier qui, lui, se tue à la tâche).

Le « type » du patron et celui de l’ouvrier dans La Grève (Eisenstein, 1925) et Ressources humaines (Laurent Cantet, 1999)
Mais le « type » de départ auquel peut sembler renvoyer un acteur peut aussi se déliter par un travail d’effacement progressif : ce que l’on pensait savoir ou croire du type dont semblait relever ce visage, ce corps, va s’estomper pour laisser place à la complexité d’un personnage qui ne sera pas que ce qu’il avait l’air d’être au premier abord. Cet effacement progressif du type s’opère par le jeu qui vient, entre autres, révéler une nouvelle expression du visage. Lorsque au début de L’Esquive (2004) Abdelatif Kechiche filme, caméra à l’épaule, un groupe de jeunes maghrébins dans une cité de banlieue en train de s’alpaguer et de se chauffer pour aller en découdre avec une bande d’une cité voisine, il part d’un type de jeunes, un cliché de la jeunesse de banlieue véhiculé à l’époque par les journaux télévisées. Faisant arriver, nonchalant, le jeune Krimo, moins véhément, moins violent que les autres, un physique un peu plus poupin qui, à la fin de la séquence, ne part pas avec le groupe mais bifurque pour aller appeler une fille à sa fenêtre, il nous annonce ce que cette fiction va proposer, ce que le cinéma peut proposer : quitter les clichés vus à la télévision pour donner à voir d’autres corps, d’autres visages, d’autres histoires de jeunes maghrébins dans une cité de banlieue, pour donner à voir des personnages et non pas des « types ».
Interviewé avec sa compagne pour parler de son film Samia, Philippe Faucon ne dit pas autre chose à propos de la manière dont sont mis en scène les personnages de types maghrébins au cinéma. Parce qu’ils sont rarement représentés au cinéma, on fait forcément des personnages issus de minorités peu montrées des représentants de leur communauté, « des images de leur communauté ». Le défi pour certains films, notamment des films mettant en scène des acteurs amateurs, serait dès lors de leur faire échapper à ce statut pour les faire exister comme de « vrais personnages » avec leurs contradictions et ambigüités, « tout ce qui fait une personne humaine » 6.
Le début de Samia (Philippe Faucon, 2000) semble ainsi proposer à l’actrice et à son personnage de rentrer dans des cases. Face à une assistante d’éducation, la jeune maghrébine écoute les possibilités de métiers qu’elle devrait cocher dans un document, les types sociaux qu’elle pourrait incarner : secrétaire, vendeuse, femme de ménage…. Dans un plan quasi frontal qui pourrait rappeler un dispositif de casting, on peut aussi avoir l’impression que la jeune actrice amatrice écoute les rôles que lui propose l’actrice professionnelle (Marie Rivière), les rôles auxquels en tant que maghrébine au sein du cinéma français elle pourrait prétendre.

« Tu pourrais être employée de collectivité…. » « J’ai bien compris : ça veut dire femme de ménage »
(Lynda Benahouda et Marie Rivière dans Samia)
Elle les refuse tous ; elle ne reconduira pas ces clichés. Au cinéma, comme dans la vie, on n’est pas obligé de rentrer dans des cases. Le film racontera le trajet de cette jeune fille tiraillée entre l’Algérie et la France, et les derniers plans la montreront souriante, cheveux détachés, à l’avant d’un bateau qui part au bled, réconciliée d’une certaine manière avec sa double origine. Le trajet du film aura été de suivre ce personnage dans les étapes qui l’éloigneront du cliché de départ qu’elle pouvait sembler reconduire.
Analyser l’acteur c’est ainsi s’intéresser à son apparence, à son physique et à ce qu’il véhicule du personnage qu’il incarne (le patron qui s’engraisse sur le dos de ses employés) et se demander ce que la fiction fait à partir de ce type (souvent social) que semble être l’acteur au début du film : est-ce que cette apparence permet de manière efficace de caractériser un corps ou est-ce que le film cherche à aller voir au-delà de cette apparence de départ, de ce ressenti de départ ? Est-ce que le cinéma, ce n’est pas cela : voir au-delà des apparences ?
L’acteur ne joue jamais seul
Une des grandes tendances à la fois dans la théorie et dans l’analyse de l’acteur de cinéma consiste à considérer l’acteur avant tout comme un corps dont il doit maîtriser tous les possibles, l’effet produit par les mimiques, la mécanique des gestes, la manière dont il prend la lumière sur un plateau. L’acteur de cinéma n’a alors pas à être doué de qualité expressive, son corps, sa silhouette en tant que puissance graphique d’inscription sur l’écran importe et produit du sens, la question de savoir s’il joue bien ou mal ne se pose pas. De même la question de la psychologie du personnage, voire du personnage tout court, n’est alors pas importante : ces gestes et déplacements produisent un effet sur le spectateur sans que l’on puisse absolument l’attacher à un état intérieur du personnage. Les gestes et les postures de l’acteur, ses mimiques, ne sont alors pas nécessairement la reproduction de postures que nous pouvons avoir les uns et les autres dans la vie de tous les jours : l’acteur de cinéma transforme le corps en un potentiel plastique et ne se préoccupe pas de mimésis. Il n’est pas vecteur identificatoire d’un personnage pris dans une fiction : il est engendrement de sens à partir de son apparence corporelle, de ses interactions avec le décor, de son rapport aux objets.
Dans une séquence de Charlot Soldat (Charlie Chaplin, 1918), Charlot est au front, dans les tranchées et s’essuie les pieds avant de rentrer dans la kasbah inondée où lui et ses camarades soldats dorment. Observons ses gestes une fois à l’intérieur : il prépare son oreiller, se couche en mettant la couverture ; il est gêné par des ronflements, demande à son voisin d’arrêter ; il veut éteindre la bougie (pour dormir on éteint la lumière) alors il essaie de souffler sur elle mais la pousse vers son voisin ; elle manque de le brûler ; il se couche finalement sous l’eau, prenant le haut-parleur d’un gramophone pour tuba.
Quels sens produisent ou révèlent ce rapport de Charlot avec le décor et les différents objets qui l’entourent ? Avec ces gestes :
- l’anormal (dormir dans l’eau) apparait comme normal
- les gestes normaux (s’essuyer les pieds, préparer son oreiller, mettre sa couette, être agacé par les ronflements, éteindre la lumière avant le coucher) perdent leur sens : pourquoi s’essuyer les pieds pour rentrer dans un endroit trempé, pourquoi préparer son oreiller ou mettre sa couette pour dormir dans l’eau, comment peut-on être agacé par des ronflements alors qu’on dort dans l’eau, pourquoi insister pour éteindre la lumière alors que noir ou pas, on ne pourra dormir ?)
- les actions « normales » sont annulées (il ne sert à rien de s’essuyer les pieds ou de mettre une couette) ou détournées, avec un effet contraire : en soufflant vers une bougie sur l’eau, on la déplace et on manque de brûler quelqu’un.
- les objets sont détournés de leur fonction : le haut-parleur sert de tuba.
Ainsi, tout ce jeu avec les accessoires et dans ce décor donne à voir l’univers de la guerre comme un univers absurde. Autour des gestes de l’acteur, l’absurdité de l’environnement des soldats nous est révélée.
Mais l’acteur joue aussi avec des partenaires et la relation entre les uns et les autres permet également de définir l’évolution des personnages. A la fin du troisième opus de la trilogie Pirates des Caraïbes, Elizabeth Swann (Keira Knightley), la fille du gouverneur, devient capitaine d’un vaisseau pirate. Cette transformation, ce trajet du personnage se construit de film en film par la manière dont le jeu de l’actrice va, petit à petit, incorporer des gestes et mimiques du capitaine pirate Jack Sparrow (Johnny Depp).
Lors de leur première rencontre (Pirates des Caraïbes : la malédiction du Black Pearl, Gore Verbinski, 2004, 15’49-19’38), au cours de laquelle Sparrow sauve la jeune femme de la noyade, beaucoup d’éléments peuvent sembler, dans un premier temps, les opposer : il la déshabille / elle le rhabille ; il est sur-maquillé / elle est presque nue (cheveux mouillés, pas de maquillage) ; symboliquement il est libre / elle est enfermée (dans son corset, dans la veste de son père) ; et leurs noms peuvent sembler les opposer : elle est Swann / le cygne, un oiseau noble et délicat ; lui est Sparrow, le moineau, un petit oiseau qui se nourrit de miettes. Dans le même temps, on voit bien ce qui les rapproche : ils se sauvent mutuellement (il la sauve de la noyade, elle veut l’empêcher d’être fusillé et grâce à elle, il réussit à s’enfuir). Ils demandent tous deux le respect de leur nom : il demande à être appelé « Capitaine Jack Sparrow » ; elle insiste pour être appelée « Miss Swann ». Ils ont tous deux un rapport contrarié à la piraterie : elle, fille de gouverneur, porte un médaillon pirate caché dans son corsage ; lui est un pirate mais possédant un pistolet sans munition et une boussole qui ne marche pas (ainsi qu’une apparence peu commune pour un pirate tel que le cinéma a pu nous en donner à voir).

Il la déshabille, elle le rhabille

Il tient à être appelé « Capitaine » Jack Sparrow, elle tient à être « Miss » Swann
Dans le deuxième opus de la trilogie (Pirates des Caraïbes : Dead Man’s Chest, Gore Verbinski, 2006), une scène (1h35’ 17-1h38’13) voit les deux personnages réunis sur le ponton d’un bateau. Sparrow et Swann se retrouvent sur le même bateau après qu’elle ait navigué en secret, se faisant passer pour un jeune matelot, sur un autre. Le costume de la jeune femme ressemble désormais à celui de Sparrow, des vêtements masculins au chapeau sur la longue chevelure. Son attitude également, puisqu’elle boit à même la bouteille de rhum que lui tend son partenaire. Enfin, si elle insiste sur leurs différences dans un premier temps, elle affirme finalement : « You and I are alike », animés par une même curiosité (pour elle de la liberté ; pour lui d’être admiré). Cette ressemblance s’affirme au-delà de ces costumes similaires et répliques qui s’échangent par le jeu autour de la bouche qui revient chez l’un comme chez l’autre et caractérisait principalement Depp dans le premier extrait.
La ressemblance entre les deux s’affirment :

Dans le costume

Par le dialogue

Et avec le jeu (autour de la bouche)

Enfin, dans le troisième film de la série (Pirates des Caraïbes : jusqu’au bout du monde, Gore Verbinski, 2007), une des premières scènes (4’32- 9’15) la voit arriver en Chine sur une barque (rappelant l’arrivée de Sparrow sur son bateau coulant au début du premier), tenir par derrière, par la gorge, un homme qui l’agresse (rappelant la manière dont Sparrow la tenait dans le premier), elle recherche un vaisseau comme Sparrow lors de son arrivée dans le premier. Arrivant chez le capitaine Cheng, on la déshabille et tout son jeu dans ce passage rappelle celui de Johnny Depp : elle dresse son index comme lui, fait des gestes amples et grandiloquents, exagère ses mimiques.

C’est maintenant Elizabeth qui tient un homme par la gorge

Son jeu rappelle celui de Sparrow (index dressé)
Se met également en place un humour autour des accessoires qui semblent impossible à contenir pour ce frêle corps féminin, comme ceux de Sparrow semblaient factices pour un capitaine pirate : elle joue ainsi sur le même registre que l’acteur (décalage entre son identité et les accessoires qu’elle possède) mais autrement (non pas sur le caractère factice des accessoires mais sur leur quantité et leur taille). Ainsi, dans cette scène où Sparrow n’est pas là, la manière dont sa gestuelle, ses mimiques, sa ligne de jeu ont été incorporées par l’actrice, nous prépare à accepter que ce personnage féminin, cette jeune femme frêle devienne un capitaine de bateau pirate. Nous l’acceptons d’autant plus que Jack Sparrow avec son maquillage, ses manières, n’avait rien d’un pirate ordinaire (ou d’un type de pirate auquel on est habitué), avait déjà quelque chose de féminin dans sa manière d’être capitaine.
Ainsi, analyser un film en s’intéressant à l’acteur, c’est analyser ce qui passe par lui, par son jeu avec les accessoires, le décor et ses partenaires : ce qu’il fait avec tel ou tel objet, la relation qu’il entretient avec ses partenaires à l’écran, la circulation des gestes entre l’un et l’autre, peut permettre de rendre lisible le propos d’un film mais aussi de comprendre la manière dont se construit l’évolution d’un personnage.
Jeu de l’acteur et intériorité du personnage
La question de l’intériorité du personnage, du rendu de l’intériorité du personnage par le jeu de l’acteur, sera au coeur de ce que l’on a appelé la Méthode, développée aux Etats-Unis au milieu des années 1950 et inspirée par les travaux du metteur en scène et théoricien russe Constantin Stanislavski au début du XXème siècle. Stanislavski s’interroge, dans un souci de vérité du personnage, sur le lien entre l’intérieur et l’extérieur du corps, tout en cherchant des techniques pour permettre à l’acteur de théâtre de retrouver, de représentation en représentation, une même qualité et intensité de jeu. Cela passe par une réflexion sur la motivation psychologique de chaque comportement des personnages, la vérification de la cohérence des actions du personnage avec son passé, l’utilisation de la mémoire affective de l’acteur afin d’exprimer une émotion authentique, le travail à partir de la propre personnalité de l’acteur, une observation minutieuse du monde, l’utilisation de l’improvisation à partir du texte écrit. En terme de jeu à la scène ou à l’écran, cela va s’incarner par une rupture avec un certain nombre de codes ou conventions qui prévalaient jusqu’alors. L’acteur de la Méthode joue de dos, marmonne7, se gratte ou enlève des poussières invisibles de son costume (Marlon Brando en était le spécialiste), autant de gestes « parasites » dont l’acteur classique se méfiait, qui visent ici à un plus grand naturel dans le jeu. Ces techniques vont engendrer des changements dans les manières de filmer l’acteur : en effet, tout le corps joue et l’acteur improvise, il faut donc filmer l’acteur dans son entier et non plus en s’attardant sur les parties importantes à la narration : un gros plan sur les mains quand elles produisent un geste significatif, sur le visage dans un moment de tension… Ces méthodes sont aussi au service d’un nouveau type de personnages, éloignés des héros droits et forts du cinéma classique. Elles servent un type de personnages qui émerge au théâtre et dans la littérature avec succès dans les années 1950 et que le cinéma va adapter (certains acteurs reprennent leurs rôles du théâtre). Au sortir de la 2nde Guerre mondiale, la plupart des cinématographies s’intéressent aux gens du peuple, aux personnages traumatisés, abîmés. Le cinéma, le théâtre et la littérature américaine n’y échappent pas, et c’est une technique de préparation de rôle qui s’appuie entre autres sur le travail sur l’inconscient (et des propres souvenirs et traumatismes de l’acteur) qui va permettre aux acteurs et actrices de travailler ces rôles de héros traumatisés, aux désirs refoulés, à la violence réprimée.
A l’Est d’Eden de Elia Kazan (metteur en scène de théâtre et cinéma, fondateur de l’Actors Studio où la Méthode était enseignée par Lee Strasberg) est une adaptation d’un roman de John Steinbeck. C’est le premier rôle de James Dean, acteur assez représentatif de ce que peut être la Méthode à la fois dans son naturel et son maniérisme, dans le recours à un jeu animal, dans la manière dont les mouvements de caméra se plient à ceux des acteurs.
Le film raconte l’histoire de Cal (James Dean) et son frère Aaron qui vivent avec leur père, persuadés que la mère est morte. Mais Cal découvre que leur mère est vivante et la patronne d’une maison close. Il garde le secret pour lui. Les relations familiales sont compliquées : Cal s’est notamment fâché avec son père qui, au moment de la guerre, a mis tout son argent dans un projet de train frigorifique qui a capoté. Il est ruiné. Cal, en secret, a gagné de l’argent en faisant du profit sur une affaire de haricots. Il s’est rapproché de Abra (Julie Harris) l’amoureuse de son frère. Dans un extrait assez célèbre (1h28’40-1h35’43), moment de bascule du film, Cal a préparé un anniversaire surprise pour son père auquel il essaie désespérément de plaire.
L’extrait se déroule en deux temps ; et c’est le jeu de l’acteur qui impulse le passage de l’un à l’autre. Dans un premier temps de la séquence, Cal apparait comme un enfant impatient et heureux de faire plaisir à son père : il tient ses mains dans ses poches ou ballantes, inutiles, les épaules voûtées comme quelqu’un qui ne sait pas ou n’ose pas se comporter d’une certaine manière ; il bafouille et en même temps laisse échapper des rires excités.
Face à lui le père se tient droit, strict, la posture allant de pair avec les propos qui donnent à voir un homme attaché à ses principes. Un autre personnage masculin habite la scène, Aaron. Il est le frère ennemi, on le voit bien de la manière haineuse dont il regarde son frère mais également dans la manière dont la mise en scène peut les opposer : d’abord Aaron est seul alors que le trio Abra, père, Cal est lié puis, après l’annonce des fiançailles, une inversion se fait qui isole Cal. Mais les deux hommes se voient aussi liés par le personnage d’Abra, qu’ils aiment tous deux et par une tenue similaire : costume marron, chemise blanche. Dans la scène du jardin qui suit, on retrouvera dans la mise en scène ce lien entre les deux personnages quand, côte à côte, Aaron sera dos à nous et Cal de face, comme nous donnant à voir en même temps le recto et le verso d’une même personne.

Cal et Aaron, le recto et le verso d’un même personnage
Face à la rigidité du père, le fils s’effondre, bascule sur la table : le corps se met en boule, se tourne et la caméra en épouse l’angle improbable, comme contaminée. Dean se redresse alors et s’approche vers son père dans un geste ambigu : on peut penser dans un premier temps qu’il va agresser cet homme qu’il saisit par le col, mais ses mains enlacent en fait le vieil homme en même temps qu’il lâche « I hate you ». Le geste, dans la difficulté que l’on a à en appréhender le sens, dit le trouble intérieur du jeune homme qui, dans le même temps, aime et déteste son père, veut le frapper et veut un câlin. La gestuelle de l’acteur fait ainsi passer les contradictions qui habitent le personnage en même temps que le moment de bascule pour le personnage est signifié à la fois par le mouvement de son corps et celui de la caméra.
Dans le jardin, un autre Cal va surgir. Sous les branches de l’arbre se met en place le retour à l’état sauvage, la remontée des bas instincts. Quand il sort de sous cet arbre, lentement, accompagné par une musique de tambours graves, il est un animal sortant de la jungle. Affirmant « Je veux te montrer quelque chose » en même temps qu’il ferme les yeux, il nous laisse deviner que ce qu’il veut montrer n’est pas beau à voir. La transformation animale s’achève dans le plan d’ensemble qui nous permet de le voir, tel un prédateur entourant sa proie, tourner autour de son frère avant de l’entraîner.
Tout dans cet extrait est au service du basculement du personnage : le jeu, les costumes, la lumière, la caméra. On passe ainsi d’un jeu naturel, à un jeu plus maniéré lors de l’explication au père (clignement des yeux, haussements des sourcils), à la métamorphose/révélation d’un jeu beaucoup plus lent et pernicieux en même temps que l’on passe de l’intérieur éclairé au jardin sombre. Le jeu est au service des contradictions du personnage, non seulement différent mais similaire à son frère, d’abord enfant puis prédateur, mais également, dans un même geste, entre envie de meurtre et désir d’amour.
Ainsi, analyser l’acteur peut être à la fois parler de son apparence, de ce qu’elle dégage et de la manière dont elle nourrit un personnage ou dont le film travaille à partir d’elle. C’est aussi parler d’un corps, de sa place dans le cadre, de son jeu avec les objets ou avec son/sa partenaire et de la manière dont sa position éclaire non seulement le personnage mais aussi le propos même du film (l’absurdité de la guerre dans Charlot Soldat ; la transformation en pirate d’Elisabeth Swann dans Pirates des Caraïbes) ou encore parler des gestes qu’il invente (ou qui passent par lui) pour dire le personnage dans toutes ses contradictions. Il y a presque autant de manière de parler de l’acteur que d’acteurs et de rôles : ce qui importe toujours, comme dans toute analyse, est d’arriver à formuler ce qui, avec l’acteur, dans un film ou une scène, pose problème et d’interroger ce qu’il fait et ce(ux) qui l’entoure(nt) pour en tirer une analyse qui pourra éclairer le personnage et donc le film.
Par Hélène Valmary enseigne l’analyse du jeu de l’acteur de cinéma dans les Universités de Paris III, Paris VII et Nanterre, membre du GRAC (Groupe de réflexion sur l’Acteur de Cinéma).
[1] Nous utiliserons ici le masculin par commodité mais bien sûr nous parlons des acteurs et des actrices.
[2] Michel Chion, « Forme humaine », Cahiers du cinéma n° 407-408 (mai 1988), p. 100.
[3] Luc Moullet, Politique des acteurs, Paris, Editions de l’Etoile/Cahiers du cinéma, 1993, p. 140.
[4] Fabien Gaffez, Johnny Depp. Le singe et la statue, Paris, Editions Scope, 2010, p.8.
[5] Serguei Eisenstein, « L’art de la mise en scène », Cahiers du cinéma n° 225, nov.-déc. 1970, p. 38
[6] Entretien de Philippe Faucon et Soraya Nini, Bonus DVD Samia, Editions Montparnasse, 2002
[7] D’autres acteurs, dans d’autres pays, ont pu le faire avant eux (Jean Gabin par exemple pouvait jouer de dos et marmonner) mais dans les années 1950 aux Etats-Unis, cela se systématise chez les adeptes de la Méthode.
Bibliographie
- AMIEL Vincent, NACACHE Jacqueline, SELLIER Geneviève, VIVIANI Christian (dir.), L’acteur de cinéma : approches plurielles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007.
- BOURGET Jean-Loup et ZAMOUR Françoise (dir.), Jouer l’actrice. De Katharine Hepburn à Juliette Binoche, Paris, Editions Rue d’Ulm, 2017.
- DAMOUR Christophe, Jeu d’acteurs. Corps et gestes au cinéma, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2016.
- DAMOUR Christophe, GUTLEBEN Christian, VALMARY Hélène, VIVIANI Christian, Généalogies de l’acteur au cinéma. Echos, influences, migrations, revue Cycnos, volume 27, n°2, Paris, L’Harmattan, 2011.
- GAFFEZ Fabien, Johnny Depp. Le singe et la statue, Paris, Scope éditions, 2010.
- NACACHE Jacqueline, L’acteur de cinéma, Paris, Nathan, 2003.
- NAREMORE James, Acteurs. Le jeu de l’acteur au cinéma, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014.
- SOJCHER Frédéric (coord.), La direction d’acteur, Paris, éditions du Rocher, 2008.
- VIVIANI Christian, Le magique et le vrai : l’acteur de cinéma, sujet et objet, Pertuis, Rouge Profond, 2015.