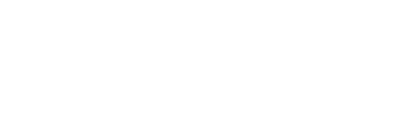L’autoportrait filmé, histoire et enjeux esthétiques, à l’heure des réseaux sociaux.
Publié le 23/07/2015, Mis à jour le 27/02/2023
Le développement des réseaux sociaux et les nouveaux usages concentrés sur le téléphone mobile ont banalisé l’enjeu social de la représentation de soi. L’acte de diffuser sa propre image intègre les pratiques courantes de sociabilité, voire les modes de communication professionnelle. Il est intéressant de mettre en perspective cette évolution, qui suppose la conscientisation de son apparence et la maîtrise de sa mise en scène, en explorant en amont les premiers exemples d’autoportrait audiovisuel.
Ils ont été le fait d’artistes et de documentaristes qui ont poursuivi par le film une approche depuis longtemps cultivée par l’écriture ou les arts plastiques. Mettant à profit les innovations techniques dans l’équipement de tournage, ces femmes et hommes d’images ont cherché à faire œuvre filmique, à capter l’attention du public en tournant vers eux-mêmes l’objectif de la caméra. Or, si les représentations en jeu sur nos réseaux contemporains visent à la valorisation de soi pour le rendre aimable et digne de confiance, les autoportraits filmés qui les ont précédées ont davantage cherché à montrer un soi fragile, vulnérable, changeant, quitte à le saisir frontalement en situation de maladie, voire aux confins de la mort.
Loin des portraits souriants, au teint frais, au regard pétillant, qui ornent les pages personnelles du net ou nourrissent la mémoire des portables, les vues des autoportraits documentaires sont habitées de corps blessés, immobilisés, reclus, de visages anxieux, bouleversés, fatigués. Image de soi résolument déceptive d’un film l’autre, que rehaussent néanmoins des aperçus, des anecdotes qui visent à célébrer la poésie du quotidien. C’est en témoignant d’une vie devenue fragile que ces films en atteignent les beautés persistantes.

Les glaneurs et la glaneuse
Généalogie de l’autoportrait filmé
Le courant autobiographique au cinéma, tardif dans son histoire, correspond à la coïncidence d’un désir latent de cinéaste avec une succession d’innovations matérielles à mêmes de le satisfaire. Il a cependant résonné avec des tendances contemporaines, aussi bien dans la création que dans les média, qui consistaient à mettre en le corps anonyme en scène et promouvoir le récit de soi. Dans une conjoncture qui, sous l’empire de la télévision, mêle volontiers les types de représentations, l’autoportrait filmé a peiné à s’imposer comme démarche cinématographique.
Des innovations techniques décisives
Dès la fin de la Seconde Guerre Mondiale s’est manifesté le désir, au sein de la profession cinématographique, de rompre avec la logique de la production en studio. Il s’agissait de retrouver un réel non aménagé pour le tournage, comme au temps des tout premiers films, de s’y mouvoir à l’aise au gré des rencontres, des incidents. Les professionnels de l’équipement audiovisuel ont conçu leurs nouveaux produits en conséquence. Dès les années soixante sont apparues des caméras portables, puis des dispositifs permettant d’enregistrer le son sur le lieu même du tournage. Avec le matériel vidéo apparu dans les années soixante-dix, le temps d’enregistrement s’est considérablement étendu. Enfin, les années quatre-vingt dix ont vu les premiers modèles de caméras ultra légères et tout aussi fonctionnelles que les précédentes. Orson Welles se plaignait de la lourdeur du matériel cinématographique qui bridait l’immédiateté de l’expression, contrairement à la littérature qui ne nécessite qu’un crayon et un bout de papier. Désormais, caméra et micro permettent de saisir au vol une idée ou une impression, avec la même réactivité et la même discrétion que le matériel d’écriture.
« Ce qui a changé avec ces mini-caméras, écrit Alain Bergala en 1999, c’est la possibilité de faire un plan avec l’économie de geste et d’espace qui est celle d’ouvrir un calepin sur ses genoux, dans un bus, pour y noter quelques mots, avec la même impression d’accomplir un acte minuscule et privé, aussi peu visible et dérangeant pour les autres.» [1]
En ne nécessitant plus d’aménagements préliminaires, le tournage a perdu son caractère solennel. Par sa discrétion, le réalisateur est à même d’instaurer un rapport au réel analogue à celui que les Frères Lumière avaient connu aux premiers temps du cinéma, ayant volontiers tourné dans l’anonymat impétueux de l’espace public. En devenant autonome, le filmeur rompt avec le processus traditionnel qui requérait un espace dédié et une chaîne de compétences complémentaires. Cette évolution a très vite rejailli sur les contenus des films. Selon Chris Marker, elle a permis l’émergence d’un « un cinéma de l’intimité, de la solitude, un cinéma élaboré dans le face-à-face avec soi-même, celui du peintre et de l’écrivain» [2]. Par de telles innovations, l’art cinématographique renoue finalement avec ses premières pratiques, faisant du réalisateur le premier artisan de son film. Pour Alain Cavalier, qui s’est vite senti prisonnier de la logique des productions classiques, il s’agit d’une véritable libération : « J’ai l’impression d’avoir récupéré mon outil, que d’autres manœuvraient à ma place » [3]. Plaçant l’usage de la caméra légère au cœur de son processus créatif, il tourne au quotidien et sans épargne, dissociant le moins possible le temps du tournage du fil de la vie. Le Filmeur en est un exemple significatif : diffusé en 2005, son film résulte d’un choix d’images opéré parmi celles qu’il a tournées de manière chronique depuis 1994.
Légèreté, maniabilité de l’équipement amènent à faire corps avec lui. Selon Pierre Perrault, la caméra prolonge les sens du réalisateur aussi bien qu’elle épouse sa gestuelle. Elle « bouge avec lui, elle suit, devance, rencontre, salue, s’empresse au rythme de l’homme lui-même. » [4] Par ailleurs, le réalisateur est devenu plus libre de suivre ses intuitions, n’ayant plus à en rendre compte aux intermédiaires que sont ses collaborateurs. Agnès Varda en témoigne à propos de son expérience du tournage en 2000 de Les Glaneurs et la glaneuse, documentaire qui comporte plusieurs séquences qu’elle a tournées seule avec une caméra DV. C’est grâce à celle-ci, en la conservant sur elle « au cas où », que la réalisatrice a spontanément satisfait son envie de filmer sa propre main, démarche qu’elle se serait interdit si elle avait dû demander l’assistance d’un opérateur [5]. Or les plans qui en résultent, nés de la possibilité de suivre son inspiration sans avoir à la formuler, tiennent une place centrale dans le film, conciliant subtilement le sujet du recyclage avec la hantise de vieillir qui l’a inspiré. Que le sujet de ces plans soit la réalisatrice elle-même n’est pas anodin. En faisant corps avec la caméra, le filmeur en vient, comme par un processus naturel, à se filmer lui-même. D’autant, précise Agnès Varda, qu’avec les écrans de contrôle dont ses récents modèles sont munis, il devient possible de « se filmer en voyant ce qu’on filme ». En faisant de « l’autofilmage », une opération aisée, la technique des caméras légères ajoute à l’enjeu de la réalisation un « effet de miroir, de cinéma immédiat ». De cette façon, le cinéma se donne les moyens de poursuivre une démarche séculaire entreprise par la littérature et les beaux arts : se raconter, se mettre en scène, faire de soi un personnage, énoncer un contenu depuis une intériorité affirmée.

Les glaneurs et la glaneuse – Attraper
La représentation de soi : une pratique courante dans les arts et les média
Plus largement, l’autoportrait filmé s’inscrit dans une conjoncture culturelle et médiatique qui promeut la représentation de soi, mettant en jeu, dans le pèle-mêle de la diffusion publique, aussi bien l’artiste, l’écrivain que la foule des anonymes. C’est la dynamique du cinéma expérimental des années soixante qui a favorisé les premières initiatives d’ « autofilmage ». Sa production met le corps de l’artiste en jeu au même titre que la performance et l’art corporel. À l’image ou sur scène, celui-ci se livre à des actions qui supposent habituellement un trucage, une reconstitution factice, ou encore la suggestion par hors champ : la mutilation, l’exhibition de ses sécrétions corporelles. S’exposer dans sa réalité physique, dans la crudité de son intimité, vise à pointer la facticité d’un environnement propre à la société de consommation qui a érigé des canons humains par la publicité, la télévision, le cinéma populaire. Aux normes du beau et du bien-être qu’ils incarnent, l’artiste oppose les affres de son identité physique, non conforme et sans retouche. Dans ces mêmes années, la littérature a intensément cultivé l’écriture de soi. Apparu à la fin des années soixante-dix, le genre de l’autofiction se situe au croisement de la vie réelle et de la fiction. S’inspirant de sa propre expérience, l’auteur opère des choix narratifs pour se raconter, quitte à ne pas se respecter strictement l’authenticité de ses souvenirs. Depuis longtemps, l’écrivain a employé sa propre expérience et ses affects comme une matière féconde, mais c’est dans les années quatre-vingt que la production de l’autofiction a pris son essor, accompagnant celui de l’autoportrait documentaire.
Cependant, ces mêmes années quatre-vingt ont vu naître un nouveau courant d’émissions télévisuelles qui place le témoignage privé au cœur de ses dispositifs. Dans Psy show ou Mœurs en direct, des personnes anonymes sont invitées par un journaliste à parler d’elles-mêmes, plus particulièrement de leurs expériences affectives. Les spectateurs sont massivement captivés par le récit d’un inconnu qui résonne avec leurs expériences. Observatrice de ce nouveau type de programmes, Marie-Françoise Lévy affirme :
« L’aspect nouveau de ces émissions réside moins dans les sujets eux-mêmes que dans la rupture de l’anonymat. Cette souffrance, portée par ceux qui la vivent, est dorénavant palpable, reconnaissable, visible. Sortie de l’ombre du confessionnal, du secret du cabinet médical, ce « je » douloureux ou triomphant, devient le sujet même de ces émissions et traduit une quête de soi et de reconnaissance de soi.» [6]
Pour alibi, la thérapie par l’exemple : le spectateur est supposé se nourrir de l’expérience de ses semblables pour revenir à lui-même et aux problèmes qu’il ne s’avouait pas. Il est bien sûr difficile de nier qu’un tel dispositif en fait également un voyeur. Bénéficiant de l’impact de la télévision, la réputation de ces programmes a rejailli sur toute démarche susceptible s’y apparenter, en premier lieu le documentaire à la première personne. Ne s’agit-il pas à chaque fois de privilégier le récit personnel et de faire de l’intimité du chez soi et des rites quotidiens la matière des images ? Dès lors, comment l’autoportrait filmé se distinguerait de la confession publique, comment s’imposerait-il comme démarche cinématographique à part entière ?
Les pièges du narcissisme et du voyeurisme
C’est à l’aune de ce contexte foisonnant que les discours critiques sur la production autobiographique se sont élaborés, souvent pour la mettre en question. Motivations nombrilistes, ressorts voyeuristes constituent ses deux écueils identifiés. Pour François Niney, il est difficile de l’inscrire dans la démarche du documentaire : « Le genre, par nature, est plutôt enclin à voir ailleurs, à aller chercher chez l’autre, pour ne pas dire l’Autre, comment ça se passe » [7]. Même réticence chez Philippe Pilard, lequel redoute par-dessus le marché que l’autoportrait fasse perdre de vue la fonction sociale du documentaire : « Le documentaire n’est plus la fenêtre ouverte sur le monde, c’est la fenêtre ouverte sur Moi. (…) Moi, moi et moi : faut-il croire à la disparition de la vocation sociale du film documentaire ? » [8] D’autres voix, cependant, s’élèvent pour mettre en garde contre ces jugements hâtifs. Alain Bergala, qui a très tôt théorisé les apports de la caméra DV à la création cinématographique, appelle à dépasser les idées reçues qu’inspire l’approche autobiographique. Redouter la dérive nombriliste, c’est « la façon la plus sûre de rater ce qui se joue de décisif, à ce tournant du siècle, du côté du filmage autobiographique comme nouvelle saisie politique possible du monde. Je (…) est de plus en plus documentaire . » [9] La préoccupation sociale, la tonalité sensible sont tout aussi susceptibles de se manifester dans les films que génère sa représentation.
Présentant en 2000 un cycle intitulé « L’Autre en ‘’je’’ », les organisateurs du festival Filmer à tout prix ont pointé les dérives auxquelles s’expose le film à la première personne :
– régler des comptes (par ex. avec un membre de sa famille) : la « caméra stylo » devient « caméra dague »
– s’exhiber : tentation narcissique qui flatte le voyeurisme du spectateur
– se complaire
Mais par sa programmation et son argumentaire, le même festival entend distinguer les films qui ont su mettre en tension le regard sur soi avec la conscience du monde :
« Pourquoi Demain et encore demain, ce journal filmé d’une dépression de Dominique Cabrera, ou encore La Pudeur ou l’impudeur d’Hervé Guibert sont-elles de œuvres qui nous touchent et nous préservent d’un sentiment de voyeurisme ? Tout simplement parce que le monde est dans ces films, parce qu’il vibre à travers ces moments d’intimité du cinéaste. (…) Ce n’est pas l’accepter comme tel mais y résister et se reconstruire à travers lui. » [10]
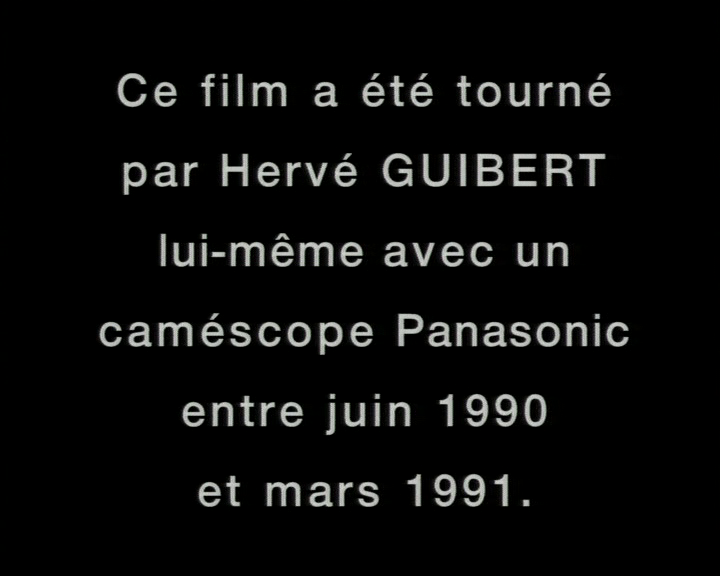
La pudeur ou l’impudeur de Herv+® Guibert(1991)
À noter que les deux films cités ici sont traversés par l’épreuve de la maladie. De manière générale, il est remarquable de constater que les films autobiographiques qui ont rencontré l’assentiment critique et connu une large diffusion publique portent l’empreinte de la souffrance, du mal-être, de la crise personnelle. Exil, vieillesse, dépression, cancer, SIDA… sont les événements dramatiques qui ont motivé leurs différents projets. Le fait de s’enregistrer au moment de les traverser revêt certes une fonction thérapeutique. En montrer le résultat au public donne aux images une seconde vocation : interpeller, mobiliser autour d’une réalité de notre condition. Au moment d’entreprendre une analyse, l’artiste Alain Baczynky a pris l’habitude de se prendre en photo en sortant de chaque séance, se mettant en scène selon les émotions qu’il venait d’éprouver. En exposant ces séries, il explique : « Je me suis demandé si je n’étais pas entrain de me déshabiller devant tout le monde. Mais je pense que beaucoup de gens qui ont fait ce chemin peuvent se reconnaître dans ces émotions. » [11] Sans doute les documentaristes qui sont devenus le sujet de leurs propres films pourraient tenir un propos voisin, au risque de s’apparenter aux témoins des émissions de confessions évoquées plus haut. S’ils ont su s’en distinguer, c’est en approchant leur sujet, comme n’importe quel autre, depuis leur savoir faire de cinéaste, à savoir : mettre à profit l’économie pauvre du tournage pour en tirer une esthétique fruste, et dynamique à ce titre, mettre en récit son expérience pour la rendre universelle, faire intervenir l’humour de loin en loin pour l’envisager avec la distance nécessaire, extraire des motifs du quotidien une poésie inattendue.
Se filmer dans l’épreuve, célébrer le quotidien
Parmi les films que motive un drame personnel, nous voyons s’esquisser des préoccupations récurrentes. D’ordre réflexif d’une part : dans la tourmente des événements, filmer pour faire le point, mettre la distance nécessaire, gagner en lucidité au spectacle de soi. D’ordre polémique d’autre part : mobiliser les consciences autour de la souffrance qu’on porte, montrer son cadre ordinaire (l’appartement, la rue, la boutique…) pour la rendre exemplaire, susceptible de partage. Acceptation, mobilisation et… réconciliation : il s’exprime ça et là un besoin de revenir à l’essentiel de l’existence. Le surprendre requiert un regard attentif à l’infra ordinaire, apte au ravissement pour des riens « qui pour moi sont des tout ». [12]
Prendre acte
Se filmer dans l’épreuve est un principe qui s’observe dès les réalisations de Jonas Mekas dans les années soixante. Walden, son journal filmé qui devait l’imposer comme une figure de premier plan de l’avant-garde new yorkaise, est d’abord la chronique d’un exil. Il l’a conçu au moment où les bouleversements de la Seconde Guerre Mondiale l’ont contraint de quitter la Lituanie où il est né pour rejoindre les États-Unis. Homme d’écriture, pétri de références littéraires romantiques du vieux continent, attaché au folklore de son pays d’origine, il s’est initié à la caméra pour mieux découvrir le nouveau monde dans lequel il venait d’échouer. New York, auquel son nom est aujourd’hui volontiers associé par les amateurs d’avant-garde, lui a d’abord inspiré un sentiment de désarroi. Il le décrit ainsi dans son journal, en 1954 :
« Tout était étrange et nouveau : fenêtres, portes, réverbères, boutiques, jusqu’aux visages. Il n’y avait presque rien que je puisse reconnaître, pas une seule rue, pas la moindre pierre. Et je restais planté là, au cœur de Brooklyn, perdu dans Grand Street (…) et j’étais seul, seul et perdu, comme jamais je ne l’avais été nulle part… et j’avais envie de hurler, comme un chien. » [13]

Walden de Jonas Mekas (1967)
En filmant son nouvel environnement, Mekas y a acquis les points de repère nécessaires pour le constituer en géographie personnelle. C’est aussi pour y chercher, éperdument, les échos de son pays natal, comme, au détour d’une séquence dans Hyde park, cette image de fleur isolée sur une aire de gazon. Le réalisateur est régulièrement à l’image pour ancrer sa présence dans les lieux qu’il enregistre, faire en sorte qu’ils gardent son empreinte. Un jeu s’opère avec le son : le bruit d’une rame de métro est associée à un plan qui le montre dans un appartement, étendu sur un lit – vision de prostration dans une ville qui ne repose jamais.
Enregistrer l’état des choses pour en prendre acte, c’est également ce qu’entreprend la réalisatrice Dominique Cabrera dans son journal filmé de l’année 1995, Demain et encore demain. Traversant une dépression, prise de crise de boulimie, elle filme d’une main son autre main trempant un bout de pain dans une assiette remplie d’huile : « Je veux le filmer parce que je veux le voir » dit-elle en commentaire. Sa voix douce, apparemment détachée, appuie la lucidité implacable des images. Plusieurs plans du film montrent la documentariste se reflétant dans un miroir de son appartement en train de se filmer, c’est-à-dire le visage à moitié dissimulé par la caméra. Par ce geste, Cabrera dénonce le dispositif auprès du spectateur, l’extrayant pour de bon de sa situation projective. En même temps, elle semble montrer que, dans le temps de son projet, la caméra fait de l’image de soi non pas une rencontre fortuite mais l’objet d’une recherche méthodique. Son film s’oppose au film amateur avec lequel il partage pourtant le même fond de quotidienneté et les mêmes choix techniques : il privilégie les temps morts aux temps forts, la solitude à la convivialité, soi aux siens, les circonstances discrètes où « la mort au travail » dans toute existence – pour reprendre le mot de Jean Cocteau – est à même d’être saisie.

Demain et encore demain de Dominique Cabrera (1996)
De même, quand Agnès Varda filme sa propre main dans Les Glaneurs et la glaneuse, c’est pour montrer ses rides et ses taches. Faisant part de son trouble devant ce spectacle d’elle-même, qu’elle dérobe à la continuité du quotidien, sa voix habituellement sereine s’infléchit : « C’est ça mon projet : filmer d’une main mon autre main. J’ai l’impression que je suis une bête. C’est pire : je suis une bête que je ne connais pas. » Ici, la démarche autobiographique est liée à la sourde inquiétude que provoque la vieillesse qui marque progressivement son corps, le faisant apparaître à ses yeux comme un objet étranger, source d’énigmes. Plus loin, Agnès Varda prend l’exemple de la série d’autoportraits de Rembrandt qui rend tangible le vieillissement d’un visage. Se saisir de loin en loin est une manière de piéger le reflet fugace d’un miroir, de vérifier par ses reproductions successives les changements intervenus dans son apparence. Son intention, finalement, est la même qu’au moment où elle s’était filmée enceinte en 1958 dans son court métrage Opéra mouffe : se raconter dans les interstices d’un film dédié à un autre sujet. Le plan inaugural de ce documentaire dédié au quotidien de la rue Mouffetard la montre nue de dos, avant de cadrer, de profil, son ventre arrondi. De nouveau, c’est un bouleversement intérieur qui motive l’image de soi, requérant la recherche d’un nouvel équilibre, d’une réconciliation avec son apparence transformée.
Au moment de réaliser La Pudeur ou l’impudeur en 1990 et 1991, Hervé Guibert a filmé une opération importante qu’il a subi à la gorge. Dans la séquence suivante, il se montre découvrant les images tournées au bloc opératoire, lesquelles restent hors champ. Le spectateur le regarde se regarder, découvre son expression fascinée sans accéder aux images qui la suscitent : « J’ai réalisé en voyant le film ce qu’on m’avait fait pour de vrai », dit-il en commentaire. Sa voix est égale, comme celles de Cabrera ou Varda. Comme chez elles, de telles images sont appelées à sanctionner la réalité auprès de celui qui la vit. Réalisées par ses soins, elles lui opposent un miroir qui discipline son désir de fuite.
Autre épisode chirurgical avec Le Filmeur d’Alain Cavalier. Une séquence nous le montre se confrontant à son reflet avant et après une opération qu’il doit subir au nez : « Dr. Jekyll et Mr Hyde ! » s’exclame-t-il, faisant rire malgré lui le spectateur. C’est la première fois, dit-il, qu’il trouve « le courage de montrer sa tête » dans un film. Justement quand celle-ci est blessée. Dans la même séquence, il explique qu’il doit se dissimuler sous une écharpe s’il sort chez lui : cette plaie qu’il dissimule au voisinage, il la révèle au public.

La pudeur ou l’impudeur de Herv+® Guibert(1993)
Résister
Auscultation de soi, de sa fragile enveloppe charnelle qui peut être poursuivie jusqu’au bout dans d’autres films. L’élément déclencheur est la maladie qui précipite l’échéance de la mort, précise de manière précoce la conscience de sa finitude. Photographe et écrivain, Hervé Guibert a expérimenté pour la première fois le film en 1990, quand il a été atteint du SIDA. Son premier objectif était d’enregistrer l’inexorable progrès de la maladie dont il souffrait, le jetant à part du reste du monde. Le résultat, La Pudeur ou l’impudeur, sera diffusée peu après sa mort. Se montrant faisant des exercices de gymnastique devant la glace, Guibert observe : « On découvre chaque jour un geste qu’on faisait la veille et qu’on ne peut plus faire. » Un sentiment de solitude pèse sur l’ensemble du film, non seulement parce qu’il montre, comme Cabrera, son isolement dans l’appartement qu’il occupe, mais aussi parce que l’image, par son rendu, trahit le fait qu’elle ait été tournée sans aide extérieure. Dans son article « Se montrer disparaître », Emmanuelle Pagano observe :
« Presque touts les plans – y compris ceux de la salle de bain et ceux de la salle d’opération – sont emplis jusqu’au tiers ou même la moitié d’une bande neutre, un espace le plus souvent blanc, résultat d’une contrainte technique : Guibert n’a pas d’opérateur, pas de trépied, il doit donc poser la caméra à même le sol ou sur une table, supports qui paraissent partiellement dans le champ. L’image du corps y fait défaut, mais elle est là comme une trace. Le corps ne se donne plus à l’image que par morceaux, par maigreur, et par intermittence. » [14]
Pour François Niney, l’entreprise de Guibert consiste à rappeler « le scandale d’un homme jeune dans un corps prématurément vieilli par le SIDA ». Elle lui inspire la question : « Le sujet qui s’autobiographie en caméra-je peut-il aller jusqu’à filmer sa propre mort ? » [15]. Réalisé en 1996, Silverlake Life de Tom Joslin et Mark Massis constitue une forme de réponse. Atteints du SIDA, ils filment leur confrontation quotidienne à la maladie, l’isolement social qu’elle provoque, le désarroi d’un corps médical impuissant à les prendre en charge. Tom Joslin et Mark Massis sont deux artistes, homosexuels militants, qui ont décidé de se filmer mutuellement quand ils ont appris qu’ils étaient tous les deux condamnés. Ils décrivent une géographie qui se rétrécit, les astreintes des soins de plus en plus intenses, les difficultés pour accomplir les tâches quotidiennes… mais aussi l’amour qui continue de les unir, les proches qui se manifestent avec délicatesse. C’est bien la mort qui est montrée à la fin du film quand l’un d’eux, succombant le premier, est filmé par le survivant. Alors que son corps est enveloppé pour être incinéré, la bande son fait retentir un chant d’amour par son compagnon éploré. A ce point, le documentaire nous éprouve doublement. Il nous rappelle à la trivialité du corps mort, ce que la fiction, pourtant profuse en cadavres, nous masque en sublimant l’agonie de ses personnages. D’autre part, Silverlake Life transcende la banalité implacable de ce qu’il montre en associant à ses images une voix qui clame son amour intact pour la personne dont il ne reste que l’enveloppe. Ici, filmer coûte que coûte trouve son sens auprès du public, saisi par le témoignage d’un amour qui survit à l’épreuve de la maladie qui ronge le corps avant de lui ôter sa vie.

Demain et encore demain de Dominique Cabrera (1995)
Célébrer
Beaucoup de lumière entre dans ces films, de façon subreptice souvent, entre deux séquences intenses. Apparaissant comme des pauses récréatives, elles s’avèrent des instants de poésie d’une importance cruciale. C’est la corneille blessée, que Cavalier a recueillie et soignée, qui prend son envol de la fenêtre de sa cuisine, encouragée par la voix du réalisateur. Ce sont, chez Cabrera, les rais de soleil qui apparaissent sur le tapis de son salon, lui faisant dire à mi-voix : « C’est beau ». C’est aussi, dans le même film, l’épanouissement persistant de la jacinthe qui orne son intérieur, dont elle salue « la force ». Il s’agit, au détour d’un quotidien qui pèse ou qui lasse, de célébrer la vie dans « ces secondes où nous existons vraiment » pour reprendre l’expression que Dominique Dubosc emploie dans son film Célébrations. Il lui a été inspiré par le déclenchement de la guerre du Golfe, événement que le réalisateur a vécu comme un cauchemar qui le menaçait de dépression. Le fil conducteur est son voyage vers New York pour retrouver son ami Jonas Mekas. Ses étapes lui donnent l’occasion de multiplier les plans sur des micro-événements comme la neige qui tombe en spirale sur les rues de New York. « J’ai su, d’évidence, affirme-t-il alors, que je devais témoigner pour la vie, en filmant simplement tout ce qu’il me serait donné à voir, que c’est la seule réponse que je pouvais faire à la guerre. » Il n’est pas anodin, par ailleurs, que ce soit auprès de la grande figure du film autobiographique qu’il soit allé chercher réconfort.
Une raison toute aussi impérieuse que la nouvelle d’une guerre désastreuse et infondée a poussé Johan van der Keuken à entreprendre à son tour, en 1997, un long voyage pendant lequel il va se filmer : le cancer dont il souffre, qui lui annonce le terme de son existence. Il décide, avec son épouse, d’employer le temps précieux qui lui reste pour regarder et écouter le monde, se rendant successivement à Bouthan en Afrique, puis à Rio et San Francisco. Le film qui en résulte, Vacances prolongées, tient lieu de dernier carnet de voyage. Ses images témoignent d’un regard sans cesse plus appuyé sur les détails du réel à sa portée. Confrontant ses points de vue successifs sur les continents qu’il a traversés, son « je » embrasse le monde entier, saluant « l’omniprésence de l’homme qui surmonte tous les obstacles grâce aux belles histoires qu’il se conte pour se réconforter face au néant. » En somme, il s’agit d’un discours à la mesure de l’Homme, depuis un homme.
Les documentaires autobiographiques qui ont rencontré un public sont justement ceux qui son allés le chercher. Le regard depuis soi et sur soi constitue la tentative de saisir par son exemplarité les sujets les plus vastes comme le sens de l’existence et le rapport de l’être au monde. Par ce biais, le réalisateur amène le spectateur à méditer sa propre vie, comme l’affirme Alain Bergala :
« La vie qu’il vit ou qu’il a vécue me concerne précisément en tant qu’elle n’est pas la mienne mais qu’elle est vécue à un niveau de perception, de conscience, de sentiment de contingence vraie, très proche de celui où je vis la mienne. Un autrui par rapport à qui je peux tenter de me repérer. » [16]
Il reste qu’une partie de soi continue d’échapper à l’objectif de la caméra. Revenant sur son expérience de journal filmé, Dominique Cabrera explique : « Il y a mille choses que je n’ai pas filmées, les désirs, les cauchemars, l’inconscient. » [17] À cette observation fait écho le regret formulé par Boris Lehmann, réalisateur solitaire qui a constamment cherché à se raconter de film en film :
« Je peux tout montrer / l’intérieur de mes armoires / mon linge sale, mes objets intimes/ je n’arriverai jamais à me dévoiler / à montrer l’intérieur de moi (…) / rien ne sort de tout ça / vaines tentatives de se décrire » [18]
Quelque chose de l’imaginaire, de la représentation mentale continue de se refuser à l’image. Alexandre Astruc, dès 1948, a rêvé d’une « caméra stylo », dont l’emploi rendrait possible l’élaboration d’un langage filmique exprimant les « obsessions » ou « les pensées les plus abstraites ». En serons-nous là un jour ?… De soi, tout peut-il être dit, tout peut-il faire image ?
Par Joël Danet – Vidéo Les Beaux Jours
Informations
- Ce texte a été rédigé dans le cadre des “Laboratoires de la plateforme” : initiée en 2010 en Alsace par des éducateurs, des animateurs et des professionnels de l’audiovisuel, la Plateforme audiovisuelle est un lieu d’échange sur le développement de projets audiovisuels à vocation socio-éducative. Ses séances sont coordonnées par Adil Essolh, éducateur au Service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Strasbourg, Alsace Cinémas et l’équipe de Vidéo Les Beaux Jours. Se déroulant à la Maison de l’image, elles permettent de se retrouver à intervalles réguliers pour discuter, recueillir et donner conseils et informations.
Prolongement de ces temps d’échange et de réflexion, Vidéo Les Beaux Jours propose des séances consacrées à la présentation de références documentaires ou de films d’ateliers visant à nourrir la réflexion des intervenants sur leurs projets d’éducation à l’image. Les programmations invitent à revenir sur des démarches qui croisent le regard documentaire avec les enjeux de l’éducation à l’image et de l’action sociale.
[1] Alain Bergala dans la revue l’image, le monde, n° 1, automne 1999.
[2] « Chris Marker reçu 5 sur 5 » par Gérard Lefort dans Libération, 19 février 1997
[3] « Le numérique entre immédiateté et solitude » table ronde dans Les cahiers du cinéma, juil-août 2001, p. 63
[4] François Niney, L’épreuve du réel à l’écran, essai sur le principe de réalité documentaire, Bruxelles, 2000, p.136
[5] Voir note 2, p. 62.
[6] « Télévision et réalités sociales » dans 25 images/seconde, Valence, 1994, p. 61
[7] Images Documentaires, n° 25, 2nd tri., 1996
[8] Philippe Pilard, ‘Documentaire, les règles du je’ dans Positif, mars 2001, n° 481, p. 80
[9] Alain Bergala dans la revue l’image, le monde, n° 1, automne 1999.
[10] « L’Autre en ‘’je’’ » dans le catalogue Filmer à tout prix – Cinémas des réalités, nov. 2000, coord. Serge Meurant, Pierre-Yves Vandeweerd, Javier Packer-Comyn, p. 76.
[11] Claire Guillot, ‘La thérapie du photomaton’ dans Le Monde du mardi 3 avril 2012, cf. Alain Baczynsky, Regardez, il va peut-être se passer quelque chose, éd. Textuel, 2012.
[12] Charles Trénet !
[13] Jonas Mekas, Je n’avais nulle part où aller – 1944-1955, Paris, 2004, p. 403.
[14] «Se Montrer disparaître», in Le génie Documentaire, Admiranda n° 10 – Cahiers d’Analyse du film et de l’Image – Aix-en-Provence, 1995, p. 107
[15] François Niney, « Ma vie ne tient plus qu’à un film » dans Images documentaires n° 25, 1996
[16] Dans Alain Bergala (dir.), Je est un film, Saint-Sulpice-sur-Loire,1998.
[17] Images Documentaires, n° 25, p. 53.
[18] Boris Lehman, Tentatives de se décrire, Crisnée, 2006, p. 26