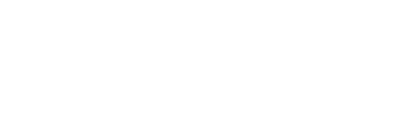Les ateliers de pratique filmique sont un temps privilégié pour combiner l’éducation à l’image et la sensibilisation à la citoyenneté de proximité. De nombreuses initiatives en témoignent.
Publié le 22/08/2018, Mis à jour le 24/07/2023
L’association Le Lieu documentaire (ex Vidéo Les Beaux Jours) a initié à Strasbourg une « ligne » d’ateliers vidéo intitulée « Le quartier par mes yeux ». Leur principe est de combiner l’éducation à l’image et la sensibilisation à la citoyenneté de proximité. Chaque film qui en résulte consiste en un portrait de quartier réalisé par ses jeunes habitants. Par l’enquête qu’ils ont menée, ils ont approché leur environnement comme un paysage intime, une aire de voisinage, un espace d’activités et de décision. Dans les lignes qui suivent, nous proposons de reprendre les contenus de la formation qui a accompagné la mise en place de « Quartier par mes yeux ». En premier lieu, nous esquisserons une généalogie de ces ateliers-enquêtes en rappelant les différents contextes sociaux, éducatifs et techniques qui ont favorisé leur émergence. Nous insisterons ensuite sur l’intérêt d’examiner l’anthropologie filmée comme méthode pour « filmer l’autre » dans son cadre familier, hors des codes intégrés du reportage et du clip. Pour finir, nous aborderons la nécessité de montrer au sein même du film l’implication de ses participants au moment de son élaboration et sa mise en œuvre.
Un atelier qui consiste en une enquête menée par les jeunes sur leur quartier présente un double intérêt. D’une part, il les invite à exprimer leur rapport à leur environnement : comment le regardent-ils ? Quels agréments y ont-ils trouvé ? Quels sont leurs repères et leurs chemins, comment lisent-ils la configuration des lieux ? Quelle place s’y donnent-ils ? Les films qui en résultent sont marqués par une tension entre l’aspect générique des lieux (la chaussée, les places, les édifices…) et le regard personnel que les jeunes auront porté dessus (« ici, c’est le parc où on a l’habitude de se retrouver, là c’est le bureau de tabac où on va acheter des autocollants de joueurs … »). Avec leurs commentaires associés aux images, chargés d’affect et d’histoire, les éléments de l’espace public perdent leur neutralité, se chargent de sens selon ce qu’ils en disent.
Par ailleurs, le principe même de l’enquête les amène à s’éveiller aux réalités collectives qui façonnent cet environnement : l’activité professionnelle ou associative, la gestion municipale, le fonctionnement des services, les pratiques communautaires ou religieuses contribuent quotidiennement à l’organisation et l’animation d’un quartier. Là où je grandis, joue, rêve, m’ennuie, le politique et l’économique agissent (ou stagnent) ou manquent. A la richesse de la découverte se joint celle de l’interaction : comment un professionnel, un passant, un responsable associatif répondent–ils aux jeunes qui les interrogent ? Ou encore un élu de secteur ? Ont-ils les mots pour s’expliquer, rendre compte, dialoguer sans recourir à une technique de langage qui perdrait les jeunes auxquels ils répondent ? Pour que cette rencontre intergénérationnelle aboutisse, la situation filmique de l’atelier, avec le déploiement de matériel technique qu’elle suppose, est d’un grand secours. Il est difficile de refuser le dialogue avec des enfants ou adolescents qui la sollicitent, d’autant plus quand l’équipement dont ils sont munis leur donne la légitimité de reporters.
Une pratique liée aux mutations de l’environnement
Trouver dans le réel proche le sujet d’un film, en faire la matière d’une exploration poétique et citoyenne est une démarche pédagogique qui se répand dès les années de reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale. En témoigne la série d’articles intitulée « Cinéma d’amateurs » parue en 1956 dans Image et son. Son auteur, Jean-Louis Cros, appelle les apprentis-cinéastes à filmer « le déroulement familier d’un jour, le ‘rythme‘ d’une ville, d’un village, d’un métier », c’est-à-dire, saisir et mettre en scène la vie de tous les jours, dans ses espaces et ses activités caractéristiques, en l’approchant non pas comme un froid objet d’étude mais comme un sujet digne d’empathie. Avec leurs points de vue, les jeunes contribuent à raconter « la chronique fraternelle des hommes [1] » qui se poursuit par leurs œuvres et leurs collaborations. L’allègement du matériel de tournage et la baisse de son coût ont certes favorisé la mise en place de ces premiers ateliers filmiques. Mais plus encore les mutations urbaines consécutives à la longue période de conflits. La reconstruction impliquait, en plus de rendre les infrastructures à nouveau opérationnelles, de pourvoir aux urgences de logement. En multipliant les grands ensembles à la périphérie des villes, un nouveau cadre de vie a été imposé aux familles populaires. En 1961, L’amour existe, moyen métrage centré sur l’avenir de la banlieue, montre des enfants errer et se battre dans les cages d’escalier en verre et les caves bétonnées. Son réalisateur, Maurice Pialat, interroge en commentaire : « Quels seront leurs souvenirs ? ».
Inviter ces mêmes enfants à enquêter sur leur environnement avec des appareils enregistreurs est une manière de les aider construire cette « mémoire neuve » en l’alimentant d’informations et d’analyses. La revue Scouts encourage ses jeunes lecteurs à employer la photographie pour affûter leur regard sur les réalités de la vie quotidienne, plaisantes ou non : « La photographie vous force à regarder la vie avec un regard neuf, vous force à prêter attention aux mille détails qui vous entourent, qui vous plaisent ou vous dégoûtent [2]». Mettre la réalité en image permet de la considérer à distance, opération nécessaire pour s’y inscrire avec davantage de lucidité et moins de passivité.
En 1973, le livre de jeunesse Moi et la ville, parue chez la maison d’édition catholique Cerf-Desclée, propose aux jeunes habitants des cités d’entreprendre une enquête avec l’aide d’un magnétophone et d’appareils photos. L’objet : « rassembler une série de renseignements sur la ville ». La première étape consiste à mener des entretiens avec une infirmière de secteur, un facteur, le directeur de la Maison des jeunes et le maire. La seconde à aller à la rencontre des passants pour leur demander : « Vous êtes heureux dans la ville où vous habitez ? Qu’est-ce qu’il faudrait changer dans notre ville [3] ? ». Des interrogations qui font écho à celles de Chronique d’un été, documentaire réalisé dix ans plus tôt dans les rues parisiennes par Jean Rouch et Edgar Morin. L’intérêt ici est de les faire porter par les jeunes. Par les entretiens et micros-trottoirs qu’ils mènent, ils ne sont plus seulement observateurs du monde qui se déploie et se transforme autour d’eux. Allant au-devant des adultes, ils sollicitent leur point de vue sur un sujet d’intérêt commun : l’avenir de la ville qu’ils habitent. De cette façon, ils s’adressent à eux comme des pairs. Par cet échange avec la jeune génération, les aînés sont rappelés à leurs responsabilités à son égard. En retour, les jeunes sont invités à se projeter dans le monde où ils devront trouver leur place.

Moi et la ville de Jean-Louis Ducamp et Colette Rafalli (1973)
A l’ère de la vidéo dans les années 80 et 90, l’enquête par le film devient une pratique pédagogique accessible. Par ailleurs, la crise économique qui s’installe alors rend les cadres éducatifs davantage soucieux de préparer l’insertion des élèves dans le monde professionnel. Mieux que donner une leçon de choses, ou faire lire une fiche d’orientation, initier une enquête avec eux est un moyen de les affranchir aux réalités qui les attentent. Au début des années quatre-vingt, la professeure Anne-Marie Lilienthal, qui met en place des ateliers vidéo, affirme : « Chez nous, une activité qui a du succès consiste à faire réaliser aux élèves de courts reportages sur un sujet qu’ils choisissent, bien sûr, mais qui a cependant trait à la vie active et au monde du travail qu’ils auront à affronter bientôt [4]. » Son action est intimement adaptée à la logique de l’apprentissage en classe. Chaque film réalisé en atelier est ensuite montré et étudié en classe comme un document à étudier collectivement. « De cette façon, explique Anne-Marie Lilienthal, la vie de tous les jours peut enfin entrer dans la classe, dans un contexte vécu et authentique, avec une participation des élèves qui n’aura pas été un vain mot [5]. » Les réalisateurs de la télévision scolaire avaient déjà à cœur, par des séries comme « Les hommes dans leur temps », de faire écho, au sein même de l’école, à cette « vie de tous les jours » dont parle la professeure. Avec l’atelier qu’elle a initié, les élèves sont placés aux deux bouts de la chaîne : émetteurs et récepteurs. En plus d’observer, les participants doivent montrer à leurs camarades ce qu’ils auront vu et entendu : leur mise en scène est une transmission. Cette finalité, par le travail d’élaboration et de mise en forme qu’elle suppose, les amène à se pénétrer davantage de leurs découvertes.
A l’orée des années 2000, avec l’émergence des chaînes locales puis des blogs participatifs, de nouveaux canaux s’ouvrent au discours de proximité. C’est aussi le moment où la sensibilisation à l’écologie se généralise et où de plus en plus de municipalités s’efforcent de structurer la concertation avec les habitants. Cette nouvelle donne revitalise la pratique de l’enquête filmée. Il reste, pour qu’elle conserve son authenticité, à la distinguer des reportages courants que diffusent les médias généraux qui se déclinent alors sur l’ensemble du territoire, à toutes ses échelles.
Les ressources de l’anthropologie filmée
S’ils sont amenés à mettre en images les lieux qui les environnent, les jeunes participants ont tendance à obéir aux codes qu’ils ont assimilés du reportage et du clip. Plans courts surplombés d’un commentaire qui épuise le sens de l’image ; corps de chanteur ou de danseur qui s’impose et s’interpose ; musique continue dont le rythme métronomique détermine celui du montage… Tous ces tics de réalisation conduisent à des représentations souvent stéréotypées ou inabouties, qui ne permettent pas au spectateur de se projeter dans le réel des lieux montrés.

Chronique d’un été de Jean Rouch et Edgar Morin (1961)
Les enjeux de l’enquête filmée supposent une autre manière de voir et de faire voir : accueillir le réel, s’adapter aux situations, chercher l’anecdotique signifiant, interroger le statut du faiseur d’images. Ici intervient le dialogue fécond des documentaristes avec les ethnologues qui se sont intéressés au cinéma. Comme l’affirme Philippe Simon, « la télévision va vers l’autre avec une image préconçue alors que l’ethnologue y va avec une idée d’objet à filmer [6] ». Cette disposition amène à filmer cet objet selon la façon dont il se découvre à soi. Elle inspire des choix de réalisation spécifiques :
- « interagir » : pour Gérard Leblanc, le point de vue dans le film doit se situer entre subjectif et objectif. Il n’est pas souhaitable de prétendre à la neutralité, il ne faut pas non plus imposer ses affects au sujet traité. Il convient d’« interagir » avec l’événement filmé pour éclairer ses ressorts et son enjeu [7]. L’« observateur filmant », affirme Christian Lallier, loin de refouler ses impressions ou de masquer les effets de sa présence, doit « être réceptif non seulement à ce que vivent les personnes dans la situation, mais également à sa propre perception de la situation [8]». Ainsi l’entretien que mène Jean Rouch avec un garagiste et sa femme dans Chronique d’un été qu’il a réalisé en 1961 : c’est le garagiste qui parle, évoquant ses combines pour tenir son affaire, mais c’est son épouse que Rouch place au cœur du plan, avec ses expressions réprobatrices et les regards inquiets qu’elle jette à la caméra. Pour Gérard Leblanc, le filmeur doit également s’efforcer, par ses initiatives, de déjouer la mise en scène des faits par leurs instigateurs. Nous le constatons quand nous témoignons d’un spectacle sportif, un meeting politique, une cérémonie commémorative, une réunion d’entreprise… Les organisateurs de ce type d’événements à enjeux communicationnels suggèrent, par leur scénographie, une unique manière de les montrer. Dans Rêves de France à Marseille, que Jean-Louis Comolli réalise en 2001, la scène de meeting ne se limite pas au temps des discours tenus sur l’estrade, ni à l’espace même de cette estrade, comme c’est le cas dans un sujet ordinaire de JT. Une fois son intervention terminée, le cadre politique est suivi par un long travelling de la scène qu’il quitte jusqu’au parterre qu’il rejoint : le même plan joint lumières éclatantes du spectacle politique et ombres de ses coulisses, gestuelle théâtrale de l’orateur devant le public et conciliabule discret parmi ses rangs.

Femmes d’Aubervilliers de Claudine Bories (1975)
- « filmer avec le ventre » : Christian Lallier emploie cette expression pour décrire l’investissement physique que la situation d’interaction engage. Il appelle le filmeur à « imprimer organiquement à la caméra ce que suscite en lui la situation observée [9] ». Le tournage n’est pas le fait d’un agent anonyme mais d’un témoin actif qui manifeste ses réactions à ce qui lui est montré. Ainsi Claudine Bories quand elle filme en 1975 les habitantes d’une banlieue ouvrière dans Femmes d’Aubervilliers. Une nourrice qu’elle a rencontrée dans un square lui explique les contraintes économiques qui l’amènent à prendre en charge plus d’enfants qu’elle ne le désire. Au milieu de l’entretien, cependant, la femme s’interrompt et sourit avec gêne en désignant le hors champ du regard. La caméra qui pivote aussitôt saisit une jeune fille dans ses jeux : nous devinons que c’est l’un des enfants dont elle a la charge. Comment continuer de parler en sa présence ? Se sentant filmée, la jeune fille se fige puis se dérobe à notre regard, réaction d’enfant qui se sait l’objet d’une conversation d’adultes. Dans la continuité de la séquence, c’est comme un mouvement réflexe qui se produit, mû par l’intuition de la réalisatrice. Cette figure se retrouve au détour de Toboggan rouge d’un quartier populaire, film d’atelier tourné dans le quartier de Cronenbourg à Strasbourg [10]. L’apprenti « observateur filmant » mène des entretiens dans son parc avec les autres jeunes qu’il rencontre en chemin. L’un d’eux évoque le « city » comme endroit où il aime se rendre. En même temps qu’il lui répond : « Au city qui est là-bas ? », le filmer opère un panoramique express qui rejoint l’autre bout du parc. Cette figure qui escamote la continuité de l’espace et vrille le regard est proscrite par tout code de tournage. Ici, elle convient tout à fait puisqu’elle est inspirée par l’interaction du filmeur avec le lieu et ses acteurs.

Génération hip hop ou le mouv’ des zup de Jean-Pierre Thorn
- restituer « l’acte de parole » : au contraire des entretiens ordinaires de télévision, où les personnes sont invitées à répondre vite et net, au contraire des documentaires nourris d’extraits-éclairs d’entretiens qui consistent parfois en un extrait de phrase, la parole dans le film d’enquête se déploie et se résorbe autant que possible dans sa continuité. Silences, mots qui se cherchent, rires de gêne constituent une matière signifiante. Pour Jean Rouch, le tâtonnement vers l’expression est une expression en soi, et la parole utile perd à en être dépouillée. Evoquant un entretien laborieux où « quinze minutes d’hésitation » ont été nécessaires pour dire « quelque chose d’important », il ajoute : « Paradoxalement, en isolant cette chose essentielle de son contexte, en coupant les bafouillements qui la précédaient, elle devenait beaucoup moins importante, beaucoup moins significative que lorsqu’elle naissait peu à peu de cette espèce de bavardage [11]. » Saisir la parole de l’autre demande d’être attentif à ce qui se joue dans les interstices des phrases, requiert aussi de lui présenter des conditions favorables. Dans Générations hip-hop que Jean-Pierre Thorn réalise en 1995, le danseur Kader Attou explique comment il en est venu à faire de la danse un projet professionnel, mais aussi une manière de rebondir. L’entretien, qui se déroule sur un pont routier au-dessus d’un chemin de fer, revêt la forme d’un long monologue. Il prend toute sa portée par le temps long accordé à la parole de Kader et par le fréquent passage des trains qui l’entrecoupent, le submergent d’un fracas hors champ. Ce bruit intermittent enveloppant le propos, le protège au moment où le danseur s’enhardit à évoquer les épreuves de la toxicomanie qu’il a traversées. Dans la situation que Lallier nomme « l’acte de parole », ce ne sont pas uniquement les mots qui sont en jeu, ce sont aussi les gestes qui les accompagnent ou les suppléent, l’espace entre les différents locuteurs, le timbre des voix, leur confusion : on filme la parole « non pas tant pour ce qui est littéralement exprimé, mais pour ce qu’exprime cet acte de langage dans la relation entre les personnes [12]. » Dans Wonder mai 68, ce que Jacques Willemont et ses étudiants mettent en évidence par son plan séquence tourné sur le seuil de l’usine en grève, c’est le rapport de force que manifestent les échanges entre ses protagonistes : l’ouvrière murée dans sa colère, les syndicalistes qui l’arraisonnent pour la remettre dans les rangs, et l’étudiant qui s’en mêle pour la défendre. Nous ressentons la tension propre à cette configuration sociale par notre perception des signes périphériques aux dialogue engagé : des cris qui interrompent le discours, un regard rivé au sol et un autre qui surveille les alentours, des mains qui s’autorisent à peser sur l’épaule… Autre cas avec Sur les traces de Balint qu’Eric Duvivier a réalisé en 1976, film réservé au personnel médical qui restitue des séances de groupes de paroles réunissant des médecins généralistes. Au cours de la conversation, une femme médecin prend la parole, esquisse une phrase, s’interrompt, renonce. Aussitôt, son voisin se lance, parle à son tour, cette fois avec assurance, sans égard pour celle qui voulait s’exprimer. Par ce détail que saisit la caméra, sur lequel elle s’attarde avec méthode, le spectateur comprend que le groupe de parole ne consiste pas en une simple concertation entre pairs mais en leur confrontation par la prise de parole. Mettant en présence des profils psychologiques différents, et des hommes avec des femmes, la situation de groupe induit un rapport de forces spécifique. Il revient au filmeur de le mettre au jour par ce type de plans faussement anecdotiques.
Avoir ces différentes notions en tête aide à faire du tournage une vraie rencontre, et non la reproduction au rabais d’un reportage de grande écoute. Avant de l’entreprendre, il est bon de faire le point sur les clichés de représentations que chacun est susceptible d’avoir emmagasinés. Comme le rappelle Jorge Léon, « Il faut que je trouve comment réagir à cette inflation d’images que je porte en moi (…) C’est illusoire de dire qu’on fait des images hors de tout contexte. Il faut y penser. Nous sommes submergés par les images de l’autre et par notre propre image. La question est de savoir comment trouver sa place par rapport à l’autre et comment retrouver la place de l’autre dans ce que je fais [13]? » Pour rendre les jeunes participants attentifs à ces enjeux de réalisation, il est utile de réserver dans l’atelier un temps de découverte de films à même de les illustrer. Les analyser avec eux permet de se constituer ensemble un bagage de références auxquelles il est possible de revenir au moment de faire ses propres images. Le derushage collectif des premiers plans filmés est aussi un moment propice pour cette sensibilisation. Elle oriente leur examen, permet de révéler leur potentiel ou de constater leurs limites selon une attente précise.
Filmeurs et personnages : la place des jeunes dans le film d’enquête
Ces notions héritées du cinéma anthropologique permettent de se munir d’un regard critique et d’une disponibilité à l’autre. Pour autant, il ne s’agit pas de contraindre les participants à s’en tenir strictement à la posture d’« observateurs filmants » que décrit Christian Lallier. Le film qui résulte de l’atelier comporte un enjeu différent, d’ordre pédagogique, qui est de faire état de leur investissement pendant son déroulement. Est-ce que l’enquête qu’ils mènent les intéresse, les anime, les enrichit ? Comment s’approprient-ils des sujets dits d’intérêt général ? Comment s’inscrivent-ils dans les espaces qu’ils nous montrent ? Comment réagissent-ils aux propos de leurs interlocuteurs ? Se tiennent-ils en retrait, subissent-ils la situation, se contentent-ils de tendre le micro, ou bien font-ils preuve d’initiative et d’interaction ?
C’est leur présence régulière dans le champ qui témoigne à la fois de leur expérience et de ses enseignements. Ainsi dans « Los Marolles », sujet de Coup2pouce réalisé en 2008. Diffusée par la télévision bruxelloise, fabriquée dans le cadre d’un atelier vidéo « permanent » que met en place le Centre Vidéo de Bruxelles, cette émission propose notamment des enquêtes que des jeunes citoyens mènent dans un quartier particulier de la ville. Par cette approche, nous voyons comment ils sont à même de participer à l’élaboration d’une « critique urbaine nourrie par l’esprit de l’éducation permanente [14] », pour reprendre les termes des rédacteurs de la revue liégeoise Dérivation, également désireux d’animer le débat sur le vivre ensemble dans la ville. En effet, les jeunes impliqués dans l’émission « Los Marolles » sont montrés à l’image quand ils présentent leur sujet, mènent leurs entretiens, font part des analyses qu’ils en tirent. Certes, la parole des habitants y est importante : elle fait part de l’avant-après du quartier, des repères disparus qui ont fragilisé la sociabilité, de la dégradation des bâtiments. Mais l’intérêt du film tient autant à ces propos qu’à la manière dont la jeune intervieweuse les recueille et y réagit. Il n’est pas anodin, par exemple, que ce soit devant elle qu’un des habitants se plaigne de « la violence gratuite » à laquelle se livrent les jeunes de son quartier, c’est-à-dire des personnes de son âge. En fin d’émission, au moment où elle fait un retour sur ses différentes rencontres, l’intervieweuse avoue qu’elles l’ont amené à reconsidérer son image du quartier et se dit particulièrement touchée par les récits « des anciens ».
Autre enquête de quartier, autre échange citoyen entre jeunes et adultes avec Ceux d’en ville, film d’atelier réalisé en 2005 et encadré par Ariane Doublet. Les recherches que des jeunes de Fécamp mènent sur le quartier de Ramponneau, à la réputation difficile, les conduisent dans le bureau du maire de la ville. L’anecdote qui a motivé le rendez-vous : le maire a été lui-même instituteur dans l’école du quartier pendant les années soixante-dix. Le dialogue est facile : « Savez-vous ce que dit le mot ‘ramponneau’ ? » « Oui, coup de poing en argot. » « Avez-vous déjà reçu un coup de poing ? » « Oui, au point de tomber à la renverse. Mais voyez-vous, ce n’était pas à Ramponneau ! » Questions originales, réponses personnelles qui, incidemment, relativisent les stéréotypes associés au quartier.

Ceux d’en ville, atelier « Eté au ciné » 2005 à Fécamp, encadrement : Ariane Doublet.
Un des participants, jeune habitant du Ramponneau, adresse au maire une doléance personnelle : est-il possible d’éclairer son terrain de foot les soirs d’hiver ? Le maire évoque le coût important de l’éclairage public, estime cependant devoir étudier la question compte tenu que le succès récent du club suppose des investissements. Par cet échange sans manières, l’élu a rendu ses invités attentifs à la notion de gouvernance municipale. Comme dans « Los Marolles », le film s’achève par une séquence réflexive, avec un bilan des jeunes sur leur expérience du tournage. C’est l’occasion pour ceux qui n’habitent pas le quartier de corriger publiquement les a priori qu’il leur inspirait avant de participer à l’atelier.
Ces deux exemples de films retiennent l’attention par la qualité des échanges que leur mise en œuvre a suscité. Les jeunes s’y sont investis par la formulation des questions et leur réactivité. En retour, ils ont été pris au sérieux par leurs différents interlocuteurs. Au début des années soixante, les longs entretiens menés au fil de la rue dans les documentaires Chronique d’un été et Le joli mai ont révélé une envie de dialogue parmi la foule qui se déploie de manière anonyme dans l’espace public. A la présence d’une caméra et d’un micro, la sollicitation d’un interviewer, les passants se montrent étonnamment disponibles et disposés à traiter de questions d’intérêt collectif. Aujourd’hui, les ateliers vidéo d’enquête montrent que cette attente diffuse persiste, d’autant plus si le dialogue réunit des générations différentes. En conviant les jeunes à une expérience citoyenne de dialogue par le film, ce type d’atelier les sensibilise à un enjeu essentiel de l’art documentaire.
Par Joël Danet – Vidéo Les Beaux Jours
[1] « À la recherche du sujet » dans Image et son – revue de l’UFOLEIS, n° 92, mai 1956, p.11.
[2] « Club des inventeurs » dans Scouts, nouvelle série n° 1, jan. 1976.
[3] Jean-Louis Ducamp et Colette Rafalli, Moi et la ville, Paris 1973
[4] Anne-Marie LILIENTHAL, « A la sauce vidéo » dans Education 2000 – audiovisuel, communication, pédagogie ; n° 20 – nov. 1981, p. 72.
[5] Ibid.
[6] « L’autre là – autour d’une table avec Marilyn Watelet, Marc-Antoine Roudil, Philippe Simon, Patrick Leboutte » dans Filmer l’autre – Les carnets de Filmer à Tout Prix, oct. 2004, p.44
[7] Gérard LEBLANC, « Intéragir » dans La revue documentaire – engagement et écriture, 1er trim. 1994, pp 31-35
[8] Christian LALLIER, Pour une anthropologie filmée des interactions sociales, Paris 2013, p. 67
[9] Christian Lallier, p. 51
[10] Toboggan rouge d’un quartier populaire, film d’atelier « Le quartier par mes yeux » – intervenante Afsaneh Chehrehgosha
[11] Jean Rouch, « Gare du Nord » dans Les cahiers du cinéma, n°171, oct. 1965
[12] Christian Lallier, p.59
[13] « L’invention de l’autre – discussion autour d’une table avec Nina Tousaint, Massimo Iannetta, Jorge Leon, Philippe de Pierpont, Giovanni Cioni », dans Filmer l’autre – Les carnets de Filmer à Tout Prix, oct. 2004, p. 48
[14] Pierre Geurts, Caroline Lamarche et François Schreuer, éditorial de Dérivations – pour le débat urbain, n°1 sept. 2015