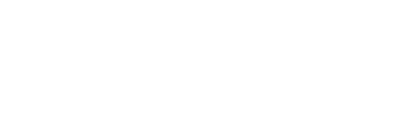Dans le cadre de notre dossier sur l’image en prison, nous avons relu, revu, cette expérience cinématographique hors du commun menée à la prison des Baumettes début des années 2000, connu sous le nom de « 9m2 pour deux ».
Publié le 31/01/2017, Mis à jour le 23/02/2023
Dans le cadre de notre dossier sur les ateliers de pratique artistique menés en prison, nous avons souhaité (re)valoriser le merveilleux travail mené par l’association Lieux fictifs à la prison des Baumettes, début des années 2000. D’abord diffusé sous la forme d’une série pour Arte fin 2004, puis sorti en salles début 2006, 9m² pour deux avait marqué les esprits en proposant une expérience humaine et cinématographique exigeante, risquée et en tous points admirable. Mue par le goût de l’expérimentation et une grande intelligence collective, cette aventure permet de reformuler les propositions en matière d’éducation à l’image dans les prisons en même temps qu’elle ouvre de nouveaux horizons quant à la représentation du milieu carcéral. Son récit par le réalisateur Clément Dorival, publié avec le DVD du film, nous immerge au cœur du mouvement de réflexion et de création mis en œuvre à l’intérieur de cet espace de contraintes. Passionnant.
Les invisibles
L’ouverture du récit de Clément Dorival passionne, dès les premières lignes. En premier lieu, car il donne vie à l’histoire (relativement récente) des actions culturelles menées en prison (voir l’article de Joël Danet). Plus indirectement, parce qu’il résonne avec d’autres gestes forts de l’histoire de cinéma : à l’instar de ces professionnels du cinéma, qui, en 1967, mirent leur matériel à la disposition des ouvriers en grève des usines Peugeot, qui créeront par la suite un collectif de cinéma, le groupe Medvedkine [1]. Le point commun entre ces deux expériences ? L’ouverture de professionnels du cinéma à des “invisibles”, à toute une tranche de la population isolée, voire stéréotypée, pour leur offrir la possibilité de s’approprier le cinéma. Dans ces deux cas, la caméra devient un moyen d’expression nouveau, porteur d’un regard, d’un discours, d’une forme inédits sur une réalité filmée de l’intérieur par ceux qui la vivent.
Tourné à la prison des Baumettes à Marseille, cet « Objet cinéma non identifié » (dixit le critique et réalisateur Frédéric Sabouraud qui signe le texte final), à mi-chemin entre la fiction et le documentaire, a réuni, d’avril 2002 à janvier 2003, huit détenus et une petite équipe de cinéma co-dirigée par les réalisateurs Jimmy Glasberg, Joseph Césarini et la productrice Caroline Caccavale. Ces deux derniers sont les fondateurs de Lieux fictifs, un « espace de recherche, d’éducation et de création collaborative ». L’édition DVD du film (2006) s’accompagne d’un livre qui prolonge et enrichit cette expérience en nous éclairant sur ses enjeux et ses étapes dans les moindres détails.
Assistant sur le tournage, Clément Dorival signe un journal de bord complété d’entretiens qui met à plat le processus de fabrication et de réflexion au cœur du projet. Le document qu’il livre est précieux à bien des égards. Même si le film témoigne en lui-même de sa propre genèse, comme le souligne Jean-Louis Comolli dans la préface, on ne saurait mesurer totalement à travers lui tout le travail mis en œuvre pour donner vie à un tel projet. En accédant à ce hors-champ, on réalise la grande fragilité de cette embarcation (pour reprendre la métaphore de la productrice, Caroline Caccavale) qu’un rien peut faire chavirer, en même temps qu’apparaissent la ténacité d’une équipe et la force des liens qui se tissent à mesure que cette entreprise avance et évolue.

Cohabitations
Parmi les atouts qui permirent à cette aventure d’arriver à terme, compte en premier lieu le temps « libéré » par l’Administration pénitencière. Disposer de presque une année était un temps indispensable pour que rencontres, apprentissages, recherches artistiques se fassent dans les règles de l’art et donner toute leur place aux acteurs de ces ateliers : les détenus. Ce temps miraculeusement ouvert a permis de gérer au mieux, dans la plus grande intelligence, les aléas, forcément incontournables, rencontrés à divers stades de cette expérience.
A ce premier contexte favorable s’ajoute la constitution d’une équipe forte, réunissant des professionnels pour la plupart déjà engagés dans l’action en milieu carcéral et habités par le souci à la fois pédagogique, artistique, politique et éthique, d’avancer main dans la main avec les participants. Ainsi, le projet est dès son origine une affaire de cohabitation : celle-ci se rattache autant à la relation qui se tisse entre professionnels et amateurs qu’à celle qui unit les détenus réunis dans une même cellule.
C’est en grande partie sur ce point-là que les stagiaires sont invités à réfléchir : traduire en images le rapport qu’ils ont à celui qui partage leur espace et leur temps d’incarcération. Joseph Césarini résume ainsi l’enjeu : « La prison c’est d’abord la contrainte par le corps. 9m², c’est à la fois le symbole de l’enfermement, l’espace intime du détenu et le lieu de cohabitation forcé. (…) Dans ce lieu, comment travaillent-ils leur imaginaire, leur perception de soi et de l’autre pour que cette cohabitation contrainte puisse être supportable ? ». D’emblée est posé comme une règle du jeu et du « je » incontournable, le refus de passer par une approche documentaire littérale, directe, pour retranscrire cette relation. Il faut à tout prix éviter le piège du voyeurisme et laisser aux filmeurs et filmés un espace de liberté : du jeu dans le « je ». C’est donc en jouant sur une autre forme de cohabitation, entre fiction et documentaire, entre jeu et réalité, que cette fenêtre peut s’ouvrir. De cette articulation une autre réalité peut jaillir, la vérité d’une expérience unique avec l’autre et avec la caméra.

Le symbolique et le sensible
Les différentes étapes qui jalonnent ce projet sont toutes aussi déterminantes et captivantes les unes que les autres. L’espace dans lequel nous entrons n’est évidemment pas neutre, il faut franchir toute une série de barrières, de sas qui matérialisent la première composante du projet : l’enfermement. Le casting des stagiaires, pré-déterminé par l’intérêt des détenus pour le projet mais aussi par leur parcours, constitue une première approche ou plutôt accroche qui permet aux réalisateurs de se présenter, d’exposer le projet, de commencer à identifier les personnalités et les capacités d’engagement des uns et des autres. Certains, comme Mohammed, semblent très bien saisir les enjeux du film : « C’est comme si je me retirais du monde carcéral et que je le regardais autrement. Une fois qu’on a la caméra à la main, on est en retrait, on peut analyser. On devient une autre personne, comme si on était à la fois acteur et filmeur ».
Plusieurs temps importants de découvertes prennent place une fois l’équipe constituée : découverte du matériel, du studio de cinéma aménagé pour l’occasion à l’intérieur de la prison. L’apprentissage s’appuie sur toute une série de rituels articulés autour des entrées et sorties dans l’espace de travail, de la répétition de gestes techniques, de séances de visionnages suivies d’échanges. Ces rituels permettent de créer un cadre symbolique à l’intérieur duquel l’expérience cinématographique peut commencer. Il était primordial de ne pas filmer dans une vraie cellule mais de passer par un faux décor – une cellule reconstituée à l’identique – pour qu’une distanciation soit possible. Sous la direction de Jimmy Glasberg, réalisateur venu du « cinéma direct », les participants sont initiés au training, une méthode d’apprentissage de la « caméra-poing » : celle-ci consiste à manipuler de petites caméras DV comme si elles étaient des prolongements de leur corps. Il faut pouvoir maîtriser parfaitement cet outil, travailler le rythme (via le plan-séquence) et la pulsion filmique. Le zoom est strictement interdit, les filmeurs doivent se déplacer. Cette approche sensible et même sensuelle s’affirme dès l’ouverture du film où la caméra glisse le long des murs, des objets de la cellule comme si elle effleurait un épiderme. « En fait, pour arriver à faire cet exercice, il faut savoir danser », résume avec justesse Philippe, l’un des détenus. Tout cela participe à un processus plus vaste qui consiste en une libération du corps devant et derrière l’objet caméra pour favoriser la création d’une image de soi et de l’autre émancipée de la représentation médiatique et de l’œil carcéral auquel elle est soumise.

Franchir les murs
Ce qui fascine dans la méthode décrite, c’est sa capacité à s’inventer, se construire au jour le jour : « le propos du film est né du dispositif, et non l’inverse comme dans la plupart des cas » écrit Clément Dorival. Il faut donc aussi composer avec les différents obstacles rencontrés en les prenant à bras le corps et en définissant sans cesse collectivement le sens du travail effectué. Aux départs imprévus de certains participants s’ajoutent des problèmes de cohabitation entre détenus qui entravent sérieusement le projet. A travers le récit des tensions qui éclatent, on touche au cœur des enjeux mêmes du film : aborder la cohabitation forcée avec un autre détenu et les conflits qu’elle génère est inévitable pour raconter la contrainte par le corps.
Mais comment faire quand la situation est à vif et qu’aucune distance ne semble possible ? Refusant d’instrumentaliser et d’infantiliser les détenus, la productrice Caroline Caccavale sait trouver les mots justes, à la fois respectueux et directs, pour que la crise trouve une résolution adulte et artistiquement féconde. Cet épisode synthétise bien l’intelligence avec laquelle ce projet a été mené de bout en bout : il s’agit de remettre entre les mains des détenus les décisions à prendre concernant le déroulement du tournage et la construction de leur propre image. Leur laisser la liberté de choisir – leur image, leur regard – dans un lieu se définissant uniquement à travers des contraintes, tel est donc le défi humain et cinématographique lancé et relevé à travers cette expérience. L’imaginaire au travail permet de franchir symboliquement les murs. Précis et exaltant, le récit de ce dépassement s’impose comme un ouvrage de référence.
Par Amélie Dubois
[1] En référence au cinéaste soviétique Alexandre Medvedkine qui créa en 1932 les ciné-trains, un projet qui lui permet de filmer les travailleurs des villes et de campagne et de monter dans la foulée les images tournées pour les montrer aux personnes filmées.
Pratique
- 9m² pour deux, chronique d’une expérience cinématographique en prison. Auteur Clément Dorival. Edition Lieux Fictifs, décembre 2008. 224 pages
- DVD 9m² pour deux de Joseph Césarini et Jimmy Glasberg, version française et VOST anglais, bonus
> Acheter le coffret sur le site de Lieux Fictifs
> Voir des extraits de 9m² pour deux