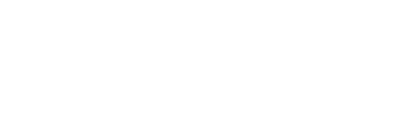Comparaison de deux belles séquences nocturnes, dans Comme un torrent de Vincente Minnelli et dans La Soif du mal d’Orson Welles. Sorties toutes deux en 1958, l’une a été filmée en noir et blanc, l’autre en couleurs.
Publié le 13/11/2014, Mis à jour le 28/02/2023
Une longue séquence nocturne constitue le point d’orgue de Comme un torrent, de Vincente Minnelli, comme de La Soif du mal, d’Orson Welles, tous deux sortis en 1958. Dans chacune d’elles, deux personnages arpentent un décor (marqué par l’industrie du loisir chez Minnelli et par celle de l’extraction pétrolière chez Welles) et sont suivis par un troisième homme, dans un mouvement qui mène vers le sacrifice et la mort. Les similitudes des deux séquences invitent à les comparer du point de vue de leur différence visuelle la plus manifeste : le fait que l’une est en noir et blanc et l’autre en couleurs, avec dans les deux cas un travail très poussé sur le procédé chromatique utilisé.
La couleur ne s’est imposée que très progressivement dans le cinéma américain. Le mouvement, engagé dans les années 1920, s’accélère après la deuxième guerre mondiale, au point qu’en 1968 tous les films tournés à Hollywood seront en couleurs. Mais en 1958, il est encore possible de choisir : comme les huit précédents longs métrages d’Orson Welles, La Soif du mal est tourné en noir et blanc, tandis que Vincente Minnelli réalise Comme un torrent en couleurs, ainsi qu’il l’a fait pour les deux tiers de ses précédents films.
1| Comme un torrent
Comme un torrent (Some Came Running, 1958) de Vincente Minnelli, produit par MGM
Vincente Minnelli a baigné très tôt dans les arts du spectacle, qu’il aborda sur leur versant populaire : Broadway, puis la comédie musicale hollywoodienne. C’est à ce genre cinématographique que son nom reste associé. Comme un torrent relève de l’autre genre de prédilection de Minnelli, lui aussi extrêmement populaire : le mélodrame. Malgré le raffinement dont ce cinéaste sait faire preuve, la dimension fondamentalement populaire de son œuvre imprègne ses films, souvent en lien intime avec son talent de coloriste. Loin de considérer avec hauteur, depuis un surplomb « artiste », les aspirations de la foule, il use de ce talent pour accompagner les errements, les espoirs et les illusions de l’individu américain. C’est particulièrement vrai dans la séquence qui nous occupe, moment culminant d’un film qui tourne tout entier autour des préjugés de classe au sein d’une petite ville américaine.


Dans cette séquence, c’est justement la foule qui envahit l’écran, avec les caractéristiques qu’on lui prête généralement de façon métaphorique : elle est ici littéralement bigarrée, bariolée, haute en couleurs. Chevelure rousse, maquillage rose et bleu, rouge à lèvres prononcés : le visage de Ginnie, cette jeune femme considérée comme vulgaire, passionnément amoureuse d’un homme plus éduqué qu’elle parce que d’une autre classe, compose un voyant assemblage de couleurs, qui tranche sur la blancheur d’une robe qui se veut virginale.
Couleurs en mouvement
Comme un torrent n’est pas une comédie musicale et pourtant tout y semble chorégraphié. La palette chromatique est elle-même affectée d’un mouvement permanent, qu’il s’agisse de celui des couleurs à l’intérieur de plans fixes, ou de couleurs mises en mouvement par le déplacement de la caméra. La séquence commence d’ailleurs sur le tournoiement des ampoules multicolores d’une grande roue, que croisent celles, encore plus vives, d’une attraction transportée en contrebas. Il y a de l’électricité dans l’air : au cours de cette séquence, les couleurs seront en large part produites par des artefacts électriques, au croisement du cinéma, de la scène et des arts forains.


Mouvement tournant, ou bien horizontal : ce plan inaugural résume les deux modalités qui seront celles, dans cette séquence, du mouvement et de ses manifestations chromatiques. Au cours de certains panoramiques, dans ce format d’image très large qu’est le CinemaScope, l’alliance de la rotation de la caméra et du balayage horizontal, qui font alterner le monochrome et le multicolore, le lumineux et l’obscur dans un vertigineux sentiment de déploiement spectaculaire du monde, suscite une impression qui renvoie à un spectacle forain, pré-cinématographique : le cyclorama, qui donnait l’illusion de faire littéralement se dérouler des vues du monde aux yeux des spectateurs. (On voit fonctionner cette attraction foraine dans une scène de Lettre d’une inconnue, de Max Ophüls.)
Dans les années 1950, l’association de l’écran large et de la couleur était considérée comme le summum du grand spectacle filmique. Dans le contexte forain de cette séquence, le fait que cette forme cinématographique moderne soit mise en relation avec le souvenir de formes de spectacles populaires pour leur part antérieures au cinéma souligne cette dimension d’opium du peuple, d’illusion collective reconduite d’époque en époque, de façon de plus en plus massive, par les formes successives du spectacle grand public en images animées. Un artifice narratif renvoyant aux premiers temps du cinéma classique est d’ailleurs également convoqué au cours de cette séquence, pour mieux s’effondrer en fin de compte : le « sauvetage de dernière minute », ce suspense en montage alterné qui concluait les films de David Wark Griffith. Ici, pas de salut final : Ginnie, jeune femme d’origine modeste qui se berce de l’espoir de vivre son amour en dépit des déterminismes sociaux, ne survivra pas à son illusion.
Illusions et repères
Dans l’avant-dernière séquence de Comme un torrent, la nuit forme la toile de fond obscure sur laquelle viennent s’inscrire des lumières et des couleurs infiniment changeantes : taches tournoyantes, reflets glissants, clignotements et éblouissements, autant d’aspects mouvants qui renforcent l’impression d’être plongé dans un spectacle tissé d’illusions fugitives, dont le décor est constamment susceptible de changer à vue.


La confusion est en outre renforcée par le fait qu’il est parfois difficile de trancher entre les phénomènes chromatiques donnés comme des perceptions objectives et ceux qui pourraient donner à percevoir la psyché du personnage de Raymond, ivre, jaloux et animé d’un désir de vengeance. En effet, à plusieurs reprises, la déraison de celui-ci semble se manifester par un embrasement monochrome, ou par l’emballement à l’écran du mouvement des taches de couleur. Minnelli joue à fond la tendance, souvent condamnée, du cinéma en couleurs à égarer l’œil dans une infinité de teintes et de nuances.



Parfois, cependant, cette confusion chromatique est contrebalancée par la possibilité donnée au spectateur de se repérer. Ce sont en effet des repères de couleur qui permettent d’évaluer les positions respectives de Raymond et de Bama, lorsque ce dernier tente d’empêcher l’ancien amant de Ginnie de rejoindre Dave pour le tuer. Signalétique dérisoire, puisque au bout du compte elle pointera surtout l’incapacité de Bama à modifier le cours du destin. Un moment de repérage visuel se démarque toutefois, lorsque Raymond monte à l’étage d’un immeuble pour distinguer le couple au cœur de la foule. Dans le plan général qui correspond à la vision subjective de Raymond depuis une hauteur, Ginnie et Dave forment pour ainsi dire les seuls éléments visuels non affectés de couleurs vives, au sein d’un plan nocturne encombré d’enseignes multicolores. Si l’on épouse le point de vue de Raymond, ce plan traduit une vision prédatrice, virtuellement meurtrière ; dans le même temps, il s’agit d’une des rares chances offertes à Ginnie et à Dave d’apparaître à l’écran d’une façon qui ne soit pas marquée au sceau de la fatalité ou du désenchantement, mais comme un couple d’amoureux ordinaire aime à se concevoir lui-même : solitaire, au sein d’une multitude.

2| La Soif du mal
La Soif du mal (A Touch of Evil , 1958) de Orson Welles, produit par Universal
Macbeth ou Falstaff, Arkadin ou Citizen Kane, je suis fait pour jouer les rois.
Orson Welles
Comme Vincente Minnelli, Orson Welles s’est imprégné des arts de la scène dès son enfance, dans une tradition plus aristocratique toutefois : celle, entre autres, du théâtre shakespearien. Citizen Kane, sorti en 1941, est considéré comme l’œuvre hors norme d’un artiste d’exception. Mais ce premier long métrage réalisé par Welles a sans doute eu également une influence capitale sur un genre cinématographique à son tout début : le film noir.
Dix-sept ans plus tard, Welles est passé du statut de wonder boy à celui de has been. Pour sa tentative de retour à Hollywood, il fait mine de jouer modestement le jeu du genre : son matériau de départ n’est pas celui d’une œuvre singulière, mais d’un film policier. On tient souvent La Soif du mal pour le représentant ultime, historiquement et stylistiquement, du film noir, tant il épouse les canons du genre : alliance de noir et blanc contrasté et de clair-obscur, prédominance des ambiances nocturnes, des ombres portées et des contre-jours, omniprésence de la mort et poids du passé. En réalité, Welles ne cède en rien sur son exigence d’artiste, et c’est même en exaspérant ces canons, en allant « au bout de la nuit » du film noir que, de façon tout aristocratique, il établit le point de non-retour du genre cinématographique sur lequel, à son origine, il eut une influence décisive.

Sombre est la nuit
Comparons cette séquence nocturne de La Soif du mal avec celle de Comme un torrent. Chez Vincente Minnelli, elle est animée d’un excès de vie. Chez Welles, elle se pare d’un excès de mort : y règnent la souillure, la déchéance, la décomposition. Dans Comme un torrent, la nuit se fait toile de fond pour des irruptions de couleurs ; dans La Soif du mal, elle est engloutissement, absorption de toute image et de toute vie, les ténèbres sur l’écran se prolongeant dans l’obscurité de la salle de cinéma.


On retrouve l’effet de « forêt visuelle » cher à Orson Welles : le jeu sur les structures des derricks et des échafaudages donne l’impression étouffante de se trouver dans une forêt de signes si dense qu’y règne une ombre perpétuelle, zébrée de lumières clairsemées. Dans la séquence de Comme un torrent, la source d’énergie de référence est l’électricité ; dans La Soif du mal, c’est l’imaginaire du pétrole qui imprègne tout, au point que même l’eau du canal devient à l’écran une masse noire et poisseuse. Le noir profond est ici la valeur de référence, à partir de laquelle se dégradent toutes les valeurs de gris, à l’exception du blanc pur qui n’apparaît jamais à l’écran.


Montage d’attractions
Paradoxe : en même temps qu’il contribue au foisonnement d’ombres et de lumières du champ pétrolifère, seul le noir et blanc assure à la séquence un semblant d’unité visuelle. Sans lui, la disjonction régnerait sans partage : d’un plan à l’autre, angles de prises de vues, cadrages, focales, mouvements de caméra, éclairages, valeurs de plans, distance des personnages à la caméra, entrées et sorties de champ se contredisent et s’entrechoquent, au risque de déstabiliser le spectateur et de lui faire perdre le fil du récit. Bien qu’Orson Welles ait affirmé : « Le metteur en scène qui me plaît le plus est Griffith. Je pense qu’il est (…) bien meilleur qu’Eisenstein », la séquence finale de La Soif du mal est d’évidence beaucoup plus proche du cinéaste soviétique et de ce que celui-ci appelait le « montage d’attractions », consistant à enchaîner les « moments agressifs » comme le ferait, au cirque, un défilé spectaculaire de numéros hétéroclites. D’ailleurs, si la séquence nocturne de Comme un torrent se déroulait dans un univers forain, le décor traversé par Quinlan, Menzies et Vargas, avec ses structures spectaculaires et ses pompes en mouvement, évoque pour sa part un parc d’attractions désert, ouvert à tous les dérèglements et aux effets formels les plus disparates.
Dans la fête foraine de Comme un torrent, la communion collective s’associait à la tradition américaine du montage alterné issu de Griffith, mais les couleurs étaient sources de confusion. Dans la traversée du désert de La Soif du mal, le chaos généralisé se fonde sur une conception du montage non hollywoodienne, mais le noir et blanc fait office d’élément unificateur minimal. Au lieu de disperser encore plus le regard comme le ferait la couleur, le noir et blanc le concentre, s’accordant en cela avec le ratio d’image qu’utilise Welles et qui paraît déjà quelque peu austère, en 1958. En effet, Welles continue d’utiliser le format standard du cinéma parlant, beaucoup moins large que le récent CinemaScope dont use Vincente Minnelli : ce format plus carré permet de resserrer l’attention autour du trio qui traverse l’espace désertique du champ pétrolifère, loin du déchaînement des foules démocratiques de Comme un torrent. Cette façon souveraine d’élire ses personnages et de choisir ses moyens esthétiques, dans un mélange de modernité et d’archaïsme, tient à la position un peu hautaine que l’artiste Orson Welles continue d’entretenir à l’égard des conventions cinématographiques de son temps, même dans un « petit film policier ». Position qu’on retrouve chez Hank Quinlan, que Welles interprète : un personnage qui veut imposer sa loi, au mépris des procédures instituées.
Cette hauteur souveraine se paie d’un poids de tragédie. Dans la séquence finale de La Soif du mal, la fragmentation du montage minimise l’intrigue au profit d’un sentiment tragique hérité de Macbeth, que Welles avait adapté au cinéma dix ans plus tôt. Au sein de ce chaos visuel, on pense à la tirade de Macbeth, après qu’il a assassiné le roi pour prendre sa place : « C’est plutôt ma main qui empourprerait les vagues innombrables, faisant de l’eau verte un flot rouge. » De la pièce de Shakespeare au petit film noir, la tirade du régicide semble encore plus désespérée, une fois ses couleurs vives passées au filtre du noir et blanc wellesien. Quinlan ne peut effacer la sombre tache de sang sur sa main qu’en souillant plus encore celle-ci dans la noirceur trouble de l’eau du canal. « Plus dure sera la chute », affirme le film noir. Sic semper tyrannis — ainsi meurent les tyrans, murmure Orson Welles.


3| En perspective : Blow Out
Blow Out (1981), de Brian De Palma, produit par Cinema 77, Geria, Filmways, Viscount Associates
La séquence nocturne située vers la fin de Blow Out, que Brian de Palma a réalisé en 1981, s’inspire manifestement à la fois de celle de Comme un torrent et de celle de La Soif du mal, que nous venons d’évoquer. Dès lors, on pourra s’intéresser à la façon dont la couleur y opère, entre autres par comparaison avec les choix chromatiques à l’œuvre dans ces deux films antérieurs.
Par Jean-François Buiré, 2014, pour Le fil des images, publication du réseau des pôles régionaux d’éducation artistique et de formation au cinéma et à l’audiovisuel