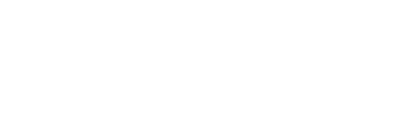Professeur de philosophie, Marc Rosmini anime depuis 2014 des ciné philo. Des ateliers qu’il contruit en écho avec les événements qui agitent notre monde et des oeuvres qui « bousculent les cadres de perception trop figés ».
Publié le 13/12/2017, Mis à jour le 25/07/2023
15 février 2015 : Marc Rosmini, professeur de philosophie, anime un atelier ciné philo autour du film La Grande bouffe de Marco Ferreri, projeté au cinéma l’Alhambra (Marseille) ce soir-là. Par le plus grand des hasards, quelques jours auparavant, la folie meurtrière et le fanatisme religieux venaient de faucher Cabu et Wolinski (entre autres), à savoir les vieux copains de Reiser, auteur d’une des affiches de La Grande bouffe. Au delà d’une tristesse perceptible, planait la promesse de faire vivre les lieux de la culture, y compris dans ce qu’elle a de plus transgressif (les dessins de Charlie, le film de Ferreri). Par ailleurs, la salle de cinéma incarne au plus haut point l’idée d’un lieu public et partagé, mais qui pourtant n’oblige pas à la fusion pathologique dans une identité (qu’elle soit nationale, religieuse, ou autre). Tout le monde voit le même film, mais – si on vit dans une démocratie – on n’est pas forcés d’être d’accord sur les interprétations et les jugements. Et c’est bien là tout le sens des ciné philo, que Marc Rosmini a mis en place en 2014 avec un petit groupe de professeur.e.s de philosophie [i]. En quoi l’expérience collective que constitue la projection d’un film dans une salle de cinéma, prolongée en l’occurrence par un débat sur ce film, est absolument singulière et irremplaçable ? Comment le mettre en place ? La parole au principal intéressé…
L’origine du projet ciné philo
« Nos temps sont troublés, et pas seulement en raison des événements sidérants que nous venons de vivre. Plus généralement les repères vacillent, et les liens sociaux et politiques ont perdu ce qu’ils semblaient avoir d’évidents. Dans ce contexte, une très forte demande de débat public se manifeste. Les évolutions récentes que nous avons vécues, particulièrement rapides dans de nombreux domaines, ont en effet conduit la société à être de plus en plus opaque et illisible à ses propres yeux. Prenant acte de cet égarement collectif, nous sommes nombreux à juger qu’il est urgent de se rassembler, de dialoguer, de croiser les points de vue, afin d’essayer de nous éclairer réciproquement et d’imaginer des solutions aux défis qui se présentent à nous.
Mon propos n’est pas d’explorer les multiples relations qui existent entre la philosophie et le cinéma, et qui ont conduit des auteurs comme Maurice Merleau-Ponty, Gilles Deleuze ou Stanley Cavell à de profondes analyses. Je voudrais plutôt réfléchir, en me basant sur la quarantaine de séances que j’ai animées durant ces derniers mois [iii], sur ce que nous avons expérimenté collectivement. Ces moments d’émotions et de réflexions partagées ont constitué la preuve tangible du pouvoir qu’ont les films, lorsqu’ils sont projetés en salle, de nous troubler, de nous interroger, de nous amener à questionner les normes, les principes, et les valeurs.
Platon et Aristote avaient défini la philosophie comme la « fille de l’étonnement ». Pour philosopher, s’étonner est donc une condition nécessaire, mais non suffisante – car, sinon, la philosophie serait synonyme d’étonnement. C’est pourquoi, si nous voulons « ciné philosopher », il convient de prolonger l’expérience du film par la discussion. Cette dernière ressemble à certains égards aux échanges qui ont habituellement cours lorsque nous sortons d’une projection avec des amis. Le ciné philo tel que nous le pratiquons, se fonde ainsi sur un principe de continuité : continuité avec le film, et aussi avec l’habitude qu’ont beaucoup de spectateurs de prolonger le plaisir de la projection en discutant. Ce qu’ajoute la dimension philosophique, c’est une forme particulière d’exigence : exigence de doute, de problématisation, d’argumentation, et de conceptualisation. Cependant, ce serait trahir le film que de dériver, dans les analyses, vers des propos trop abstraits et généraux. Tel est l’équilibre toujours instable que nous cherchons dans ces séances, entre d’une part l’ambition philosophique, et, d’autre part, la fidélité au film en tant qu’objet d’une expérience esthétique, c’est à dire visuelle, auditive, sensible, affective. Nous partons en effet du principe qu’il est impossible, dans un film, d’isoler les enjeux éthiques, politiques, anthropologiques, épistémologiques ou ontologiques des enjeux proprement esthétiques.

Le choix du film
Avant tout, il faut choisir un film. Afin d’éviter les débats trop fléchés, voire trop directement clivant, nous écartons autant que possible les films « à thèse », ou qui seraient réduits au simple rôle d’illustration d’un thème. Comme la liste en annexe le montre, nous avons prioritairement choisi des œuvres esthétiquement riches et complexes, et dont nous ne savions pas directement ce qu’on pouvait, ou devait, penser. Plutôt que de partir d’une question philosophique, puis de chercher quels films pourraient l’ « illustrer », nous avons sélectionné des œuvres qui résistent à l’interprétation, et qui bousculent les cadres de perception et de compréhension trop figés. Certains films – citons Under the skin, Melancholia, L’Étreinte du serpent ou encore La Nuit des morts-vivants – ont retenu notre attention par leur capacité à créer un monde inédit, dépaysant, déstabilisant, propre à nous arracher à nos confortables habitudes de pensée et de perceptions. D’autres, comme Le Havre, Fatima, Asphalte ou La sociologue et l’ourson ont été choisis pour le regard oblique et renouvelé qu’ils portent sur une réalité qui pourrait nous sembler familière et non problématique. Qu’il s’agisse donc d’une confrontation avec l’étrangeté radicale, ou avec l’ « inquiétante familiarité », nous avons tenté d’explorer des voies mettant la pensée en mouvement, et l’obligeant à déconstruire et reconstruire ses catégories.
Certains films ont également été choisis pour leur capacité à interroger les hiérarchies en art, notamment la frontière incertaine entre d’un côté la culture « savante » et légitimée de l’« Art et Essai » et, de l’autre, les formes populaires du cinéma de « divertissement ». Des œuvres aussi différentes que La Prisonnière du désert, The We and the I, Pas son genre ou X Men – Days of the future past nous bousculent en tant que spectateur.rice.s dans la mesure où il n’est pas évident de savoir dans quel ensemble nous pouvons les subsumer. D’aucuns pourraient les situer trop rapidement dans le « divertissement », alors que le regard cinéphilique, voire ciné philosophique, montre que d’autres cadres de perception et de compréhension sont possibles. Ainsi, de nombreux westerns, qui ont été conçus au départ comme des œuvres destinées à amuser les classes populaires, appartiennent aujourd’hui au Panthéon de la cinéphilie savante. Or, s’interroger sur la catégorie dans laquelle une œuvre est pensable, c’est déjà commencer à philosopher, c’est à dire à prendre conscience que l’usage que nous faisons du langage n’a rien d’évident ni de « naturel ». Il n’est en effet pas de pensée critique qui ne commence par une méfiance envers les mots.
Préparer la séance
Dans la mesure du possible, j’essaie de préparer et d’animer ces séances avec un.e autre intervenant.e – généralement un.e autre professeur.e de philosophie. Les films sont des réalités particulièrement complexes, puisque s’y mêlent des composantes visuelles, plastiques, sonores, musicales, langagières, narratives, dramatiques, symboliques, etc. Selon à quel aspect on est plus ou moins attentif, notre questionnement (notamment philosophique) varie. C’est d’ailleurs un des critères qui peut permettre de distinguer une œuvre d’art d’un objet visant simplement à communiquer un message : dans le premier cas, on ne sait pas à quoi on doit ou non être attentif, et, par conséquent, on ne sait pas nécessairement ce qu’il y a à penser, et à comprendre. Préparer un ciné philo à deux, c’est déjà prendre acte du fait qu’il y a plusieurs façons de se laisser questionner par le film.
A partir de ce travail préparatoire, nous dégageons donc quelques axes de réflexion, proposés aux spectateur.rice.s juste avant la projection. Ainsi, l’attention de ces dernier.e.s est dirigée vers des aspects du film – y compris des aspects formels – auxquels ils n’auraient peut-être pas été spontanément sensibles. Le plus souvent, mais pas toujours, nous établissons un lien entre le film et une question. A titre d’exemples, voici quelques titres, et les problématiques que nous leur avons associées :
- Vice Versa : Sommes-nous maîtres de nos émotions
- Fight Club : Quel est l’autre que l’on porte en soi
- Seraphine : Peut-on être artiste sans le savoir ?
- Sous le soleil de Satan : Peut-on filmer le sacré ?
- Tampopo : Quand y a-t-il art ?
- Les Sentiers de la gloire : La guerre : une éclipse de la raison ?

Marcel Marx (André Wilms) and Idrissa (Blondin Miguel) in Aki Kaurismäki’s LE HAVRE. Photographer: Marja-Leena Hukkanen. ©Sputnik Oy
L’expérience du film dans la salle obscure
Ensuite vient le temps, central, de la projection elle-même. C’est le moment de la solitude, celui où nos sens et notre conscience rompent avec leurs centres d’intérêt habituels – et le plus souvent utilitaires – pour se laisser capter par le film. Robert Smithson a exprimé cet effet de rupture dans une formule célèbre : « Allez au cinéma, c’est faire un trou dans sa propre vie ».
Voir un film, c’est accepter d’être dépaysé, et de se laisser pénétrer par le monde spécifique que le.la cinéaste a créé.
Cette immersion esthétique est toutefois légèrement différente pour le spectateur.rice d’un ciné philo, qui sait qu’après la séance, il sera conduit à participer à un dialogue d’un type particulier. Cette perspective oriente nécessairement le « libre jeu des facultés », qu’on peut définir ici comme le dialogue intérieur entre le sujet qui perçoit, le sujet qui imagine, le sujet qui est affecté, et le sujet qui pense. Le mouvement de va et vient entre l’expérience « spectatorielle » et l’expérience de réflexion théorique est dans un tel contexte particulièrement intense.
De la difficulté de recréer du commun
La perception d’un film – d’autant plus si elle a lieu dans une salle de cinéma – constitue une expérience déstabilisante pour la relation que nous entretenons à nous-même.
Le montage sonore et visuel nous place dans un contexte d’incertitude : nous ne savons jamais ce qu’il va y avoir à percevoir dans l’instant qui suit. Il n’est donc pas évident pour le sujet de maintenir son unité face à ce flux perceptif et émotionnel. Dans le meilleur des cas, si la magie du cinéma opère, nous sortons transformés de ce face à face avec le film.
Puis vient le moment de recréer du commun, de refaire société. Ceux qui ont préparé la séance reprennent tout d’abord la parole. Ce n’est pas toujours facile : sortir de l’univers du film et revenir à celui de la salle demande parfois un réel effort. Il s’agit de ne pas laisser l’émotion nous réduire au silence, mais de l’utiliser au contraire comme un stimulant pour penser. Je me souviens par exemple avoir eu du mal à trouver mes mots après des films aussi différents que Scarface, Séraphine, ou Melancholia.

Scarface de Brian De Palma (1983)
Dans notre propos liminaire, l’enjeu est donc d’éviter de plaquer un discours théorique sur le film, qui serait alors réduit à un simple prétexte. L’idée est plutôt de prolonger les interrogations dont il est porteur. Comme je l’ai déjà dit, ce qui fait la richesse particulière du cinéma, c’est qu’un film associe plusieurs formes d’expression et de système sémiotiques. Sons, musiques, cadrages, couleurs, modes narratifs, gestuelles, dialogues : tout peut donner à penser. Le cinéma est l’art du croisement des points de vue : chaque plan, la caméra saisit la « réalité » selon une perspective singulière, qui se tisse et se confronte avec les autres points de vue possibles et avec les autres plans. En cela, la discussion ciné philosophique prolonge la projection elle-même, car chaque intervenant.e parle bien du film, mais il en parle selon une perspective singulière.
Nous touchons là un point qui a été signalé par de nombreux participant.e.s au cycle ciné philo, qui avaient également expérimenté d’autres types de rencontres philosophiques ouvertes à un large public – du type « café philo ». Dans ce dernier cas, chacun arrive avec son vécu, son expérience, son capital culturel, ses références. A partir de cette diversité, il n’est pas toujours facile de savoir de quoi chacun.e parle, et de créer du commun. Dans un ciné philo, par contre, toutes les personnes présentes ont vu le même film. Un objet commun est donné, ce qui permet de créer rapidement une forme d’égalité, qui ne se réduit cependant pas à une identité. Car si l’objet est bien commun, chacun l’a perçu et l’a pensé à sa façon. C’est en cela que le ciné philo est une pratique politique, même lorsque le film n’aborde aucune problématique « politique » au sens strict. De même que la « chose publique » est commune à tous sans être identique aux yeux de tous, les spectateur.rice.s ont à la fois vu le même film et un film différent.
Le moment du débat n’est cependant pas celui d’une accumulation de monologues qui seraient simplement juxtaposés. C’est un moment d’écoute, d’échange et de partages. Dans le meilleur des cas – car toutes les séances n’ont pas été aussi fécondes – les interventions rebondissent les unes sur les autres, se prolongent, se confrontent parfois. Cette complémentarité est facilitée par l’exigence partagée par tous les intervenants, à savoir une ambition philosophique qui ne perde pas de vue la spécificité esthétique du film. Par petites touches, par esquisses successives, à travers chaque prise de parole, le film n’est pas seulement commenté : il est recréé. Dans le même mouvement, un public se constitue dans la salle. Avant la projection n’existent que des individus isolés, juxtaposés. Le partage de l’expérience du film et du dialogue ciné philosophique instituent une communauté, un tout qui est plus que la somme des parties. J’insiste : ce processus est essentiellement politique. Il peut certes exister ailleurs qu’à l’occasion d’un ciné philo. Mais ce dispositif, du moins lorsqu’il fonctionne, est exemplaire de l’expérience qu’un public peut faire de lui-même à partir d’un trouble collectif et d’une problématisation partagée.
Le ciné philo est donc un laboratoire privilégié de l’intersubjectivité. Chacun.e, en prenant la parole, attire l’attention sur un aspect du film qui avait éventuellement échappé aux autres. Pour paraphraser Marcel Duchamp, on pourrait dire que ce sont les spectateur.rice.s, et plus encore les spectateur.rice.s parlants, qui font les films. Le cinéma étant un art particulièrement discutable, la participation du récepteur au processus créatif y est particulièrement sensible. Chacun.e sort enrichi de cet exercice d’intelligence collective, y compris bien sûr ceux qui ont préparé la séance. En écoutant les interventions des uns et des autres, chacun.e prend conscience des limites de sa perception et de sa compréhension mais, dans le même mouvement, il les élargit. C’est en cela, notamment, que l’expérience est philosophique.
Cinéma et « réalité » : allers-retours
Je voudrais proposer rapidement quelques exemples de la dialectique qui peut exister entre les films et la réalité de l’existence sociale.
Pour le ciné philo autour de Fatima, il avait semblé pertinent à William Benedetto, directeur du cinéma L’Alhambra, de proposer à des jeunes filles issues de l’immigration maghrébine d’animer la discussion avec moi. J’avais donc fait cette proposition à deux anciennes élèves, qui acceptèrent. Or l’une des deux porte le voile. La présence d’une « jeune fille voilée » dans un contexte où il très rare d’en voir, et où il est encore plus rare de leur demander de s’exprimer devant un large public, suscita un certain émoi. Certains spectateur.rice.s, qui semblaient tout à fait disposés à compatir au sort du personnage principal du film de Philippe Faucon – qui, justement, porte le voile – semblèrent beaucoup moins bienveillants envers la jeune intervenante. Ce violent retour du réel – certains diraient ce retour du refoulé – fut l’occasion de réfléchir sur le statut de la fiction, sur son effet de distanciation, ainsi que sur les ambiguïtés du regard.
Dans le même esprit, j’ai animé le ciné philo consacré à Scarface (autour du thème « De quelle vérité les mythes sont-ils porteurs ? ») avec un professeur de sciences économiques et sociales, mais aussi avec un ancien élève. Ce dernier a grandi dans une cité populaire des Quartiers Nord de Marseille. A treize ans, en découvrant le film de Brian de Palma, il avait été étonné de constater à quel point les jeunes de sa cité s’étaient approprié les attitudes et les tics de langage de Toni Montana. Lui-même, d’ailleurs, avoua aux spectateur.rice.s de ce ciné philo qu’il avait cédé quelques temps à l’identification avec le personnage du film – identification particulièrement étrange dans la mesure où ce personnage semble, du début à la fin du film, tout à fait inapte au bonheur.
Cette réflexion sur l’effet que produit la fiction sur la réalité fut au cœur du débat, qui porta aussi, et symétriquement, sur les effets du réel sur la fiction. En effet, Tony Camonte, le personnage du Scarface d’Howard Hawks, est inspiré de vrais truands – principalement d’Al Capone. Or, au début du Scarface de De Palma, le personnage principal exprime son admiration pour les personnages de bandits des films noirs américains. Toni Montana cherche donc à ressembler à des personnages de cinéma. Par ailleurs, les petits caïds des cités marseillaises cherchent à imiter Toni Montana. Lors du ciné philo, c’est autour de cette spirale de l’imitation qu’avait tourné le débat, spirale démultipliée dans la mesure où Brian De Palma est un cinéaste post-moderne qui, lui-même, s’inspire de façon très ostentatoire d’autres cinéastes…
L’univers de « Scarface » est dominé par le trompe l’œil et l’artifice. Dans le film, le monde de Toni Montana est contaminé par des images. A son tour, ce film a constitué une incroyable source de citations et de reprises, autant dans le champ des productions culturelles que dans le comportement d’une partie de la jeunesse. C’est en cela qu’il nous avait semblé légitime de parler de « mythe » – « De quelle vérité les mythes sont-ils porteurs ? » était le thème de cette soirée – mais pas seulement. Car la définition de ce concept, notamment en ethnologie, le situe au-delà de la distinction entre le vrai et le faux ; pensons à la célèbre formule de Toni Montana : « Je dis toujours la vérité, même quand je mens. ». Le mythe est faux, on en a conscience, et pourtant il agit très fortement sur nous et sur notre rapport à la « réalité ».

Fatima
Le style comme moteur du questionnement
Deux exemples illustrent la façon singulière qu’a le cinéma de contextualiser les grandes valeurs et les grands principes, et de les interroger par l’invention de dispositifs formels.
Les deux séances de ciné philo que j’ai co-animées autour du film Le Havre ont été l’occasion de prendre conscience de la façon par laquelle le style d’une œuvre nous conduit à repenser les problèmes.
Dans ce film d’Aki Kaurismaki, le récit évoque de grands concepts – la solidarité, la « désobéissance civile », le positivisme juridique, l’injustice – et de grandes questions : Peut-il être juste de désobéir aux lois ? La délation peut-elle être morale ? La solidarité peut-elle tomber sous le coup de la loi ? Comment hiérarchiser nos différents devoirs s’ils semblent entrer en contradiction ?
Mais l’intérêt de cette œuvre réside surtout dans la contextualisation de ces questions, et dans la façon dont elle creuse la complexité de l’ancrage motivationnel. En effet, les motifs qui poussent les personnages à prendre des décisions dans le film ne sont pas très clairs et, quoi qu’il en soit, ils ne semblent pas relever prioritairement d’une introspection rationnelle. Or philosopher peut certes consister à définir in abstracto des normes et des valeurs ; mais ces dernières doivent également être mises à l’épreuve. Le cinéma le permet, dans une perspective casuistique prenant en compte la complexité des situations et des choix.
C’est aussi par sa stylisation, par ses décalages et ses anachronismes que Le Havre ouvre au spectateur un espace pour penser. Le récit se passe à la fin des années deux-mille, comme en témoigne notamment les actualités télévisées qui montrent le ministre de l’Intérieur Eric Besson commentant une intervention policière dans le camp de réfugiés de Calais. Mais le style du film, aussi bien en ce qui concerne la texture des images, les décors ou les costumes, évoque pour sa part le cinéma des années cinquante – on pense notamment à Mon Oncle, de Jacques Tati.
Cet effet de distanciation est accentué par le jeu des personnages et par les effets musicaux, volontairement très appuyés, ainsi que par l’usage presque dadaïste de certains objets (pensons à l’ananas avec lequel le commissaire Monet entre dans un bar). Par sa proximité avec les chromos et les images d’Epinal, la toute dernière image – un arbre en fleur dans le jardin du couple Marx – symbolise ce processus de mise à distance. Nous avons ici affaire à un « cinéma de poésie », qui ne prétend par donner une « reconstitution » réaliste des faits. Mais, en même temps, le film aborde des sujets d’actualité particulièrement brûlants. Et c’est cette tension qui donne à penser.
La manière par laquelle Kaurismaki insiste sur l’artificialité de ce qu’il nous donne à percevoir soulève ainsi la question de la « vérité » des images. Si toute image relève d’un choix, d’un cadrage, d’un style, d’une construction, ce que montre la télévision de l’intervention policière dans la « jungle » de Calais est-il plus « vrai » que le récit visuel élaboré par Kaurismaki ?
Le Havre constitue ainsi un détour, possiblement philosophique, qui permet de porter un nouveau regard sur le réel – en l’occurrence, le problème des migrants et le « délit de solidarité ».
J’ai défendu l’idée que le dispositif « ciné philo » est politique par essence, et ce quel que soit le film choisi. Il l’avait été encore plus directement lors de ces séances sur Le Havre, ou bien lors de la soirée consacrée à La Sociologue et l’ourson.
Nous avions choisi d’associer ce film à la question : « Qu’est-ce qui fait la qualité d’un débat politique ? » Comme pour Le Havre, c’est le dispositif formel qui permet ici la mise à distance sur un sujet brûlant, à savoir les débats sur « le mariage pour tous » et l’homoparentalité. En proposant une forme hybride qui croise le documentaire et le film d’animation, et en confrontant le sérieux des enjeux avec les animaux en peluche visible à l’écran, les réalisateurs instaurent ce décalage qui rend possible l’étonnement, et qui permet de reposer les questions dans des termes originaux. L’humour, en l’occurrence, se révèle en tant que valeur située au croisement de l’esthétique, du politique, et du philosophique. Je me souviens en effet que le débat consécutif à cette projection avait été passablement déminé par l’effet que le style de l’œuvre, plus encore que son « contenu », avait produit sur les spectateurs. Encore une fois, il apparaît clairement que, dans un film, la « forme » et le « fond » ne sont pas séparables, et que c’est justement cette imbrication qui stimule la pensée.
Un laboratoire en devenir
Pour conclure, j’espère avoir montré en quoi la salle de cinéma, notamment lorsqu’elle accueille un échange ciné philosophique, constitue un espace social à la fois central et décalé. En tant que laboratoire du débat, elle est un lieu dans lequel la société peut tenter de prendre conscience d’elle-même, de sa complexité, de son énergie, de ses contradictions – bref de ce qui fait qu’elle est une société démocratique. Ceux qui nous ont suivi dans ce cycle depuis qu’il existe ont maintes fois exprimé le même jugement : selon eux, cette expérience partagée constitue une source d’espoir en ce qui concerne la capacité de notre société à dépasser les débats artificiellement clivés, les malentendus, la langue de bois, les invectives et les anathèmes. Notre enthousiasme doit cependant être pondéré par les limites du dispositif : les spectateur.rice.s qui choisissent de participer à un « ciné philo » ne sont pas nécessairement représentatifs de la société dans son ensemble. Disposant en général d’un capital culturel élevé, ils partagent surtout certaines valeurs essentielles : le goût de l’échange, la curiosité (pour les films, mais aussi pour ce que chacun en dit), et le sens de l’écoute. Il serait donc stimulant, aussi bien humainement qu’intellectuellement, de tester ce dispositif avec des publics moins familiers de l’exercice de l’exégèse cinématographique et du débat pluraliste.
Quoi qu’il en soit, reconnaissons que le cinéma, par le trouble qu’il suscite en chacun de nous et par sa complexité, possède un pouvoir spécifique. S’il peut nourrir des formes particulièrement riches d’intersubjectivité, c’est d’abord parce qu’il s’adresse de manière incomparable à notre subjectivité. Le ciné philo apparaît ainsi comme un espace dans lequel le sujet-spectateur peut prendre conscience de sa capacité à aiguiser ses sens, à remettre en question ses certitudes, et à étendre le champ de son entendement. D’un point de vue plus collectif, nous avons vu que la salle de cinéma constitue un lieu possible de résistance aux divers processus de séparatisme social et au triomphe de l’homo munitus – à savoir l’homme barricadé et replié sur l’entre-soi.
Dans le contexte de crise des repères et d’inquiétudes généralisées que j’évoquais au début de ce texte, veillons donc à favoriser tout ce qui, à l’instar de ces moments ciné philosophiques, peut nourrir l’intelligence partagée et le sens de la communalité [iv].
Par Marc Rosmini, professeur de philosophie
[i] Le collectif des Philosophes Publics est constitué de professeurs de philosophie décidés à faire vivre le débat partout où cela est possible, et à expérimenter diverses formes d’échanges, parmi lesquelles les ciné philo.
[iii] Citons : John Ford, « La Prisonnière du désert », George Romero, « La Nuit des morts-vivants », Maurice Pialat, « Sous le soleil de Satan », David Lynch, « Sailor et Lula », Aki Kaurismaki, « Le Havre », Michel Gondry, « The We and the I », Lars Von Trier, « Melancholia », Gus Van Sant, Harvey Milk…
[iv] Commun qualifié par Rosanvallon comme étant « décisif pour fortifier la vitalité d’une communauté » et « indexé sur l’implication et la curiosité des citoyens ».