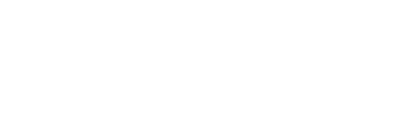L’arrivée de l’émission « Videomaton » puis des webcams préfigure un changement de prisme notable. Désormais, c’est notre propre image, notre intime, qui circulent.
Publié le 26/06/2020, Mis à jour le 27/06/2023
Le texte proposé ici est le dernier épisode d’un article en trois épisodes :
– L’émergence d’internet et la télévision
– La fin du cinéma ?
– Videomaton et webcam : les débordements de l’intime
Par Joël Danet – Laboratoire SAGE – UMR 7363 – DHVS – Université de Strasbourg
Cette recherche s’appuie sur les ressources et les fonds de l’INA Grand Est et de Vidéo Les Beaux Jours – membre Grand Est de la Cinémathèque documentaire. This research received funding from the European Research Council (ERC) The healthy self as body capital (BodyCapital) project under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 694817).
Videomaton et webcam : les débordements de l’intime
« Videomaton » au début des années 80, les webcams en ligne au milieu des années 90 constituent deux expériences audiovisuelles qui annoncent la circulation massive de l’image de soi dans les médias sociaux. L’émission « Videomaton » a tranché avec la télévision-paillettes de son temps. Jeunes, vieux, garçons, filles, se présentaient tels qu’ils étaient, sans apprêt, sans maquillage, dans une cabine de prises de vues pour transmettre un message personnel. Les webcams ont diffusé sur le net les images de particuliers filmées chez eux, par leurs moyens personnels. Loin des plateaux illuminés, hors des formats déterminés par le jeu ou le reportage, sans objectif avoué, ces productions reposaient sur la simple présence de soi devant la caméra et l’intérêt que trouvaient les autres à la contempler. Ce type de contenus, mis à la portée de toutes et tous, a encouru les reproches d’exhibitionnisme et de voyeurisme dans la presse intellectuelle et les publications éducatives. Cependant, ils témoignaient sans doute du besoin de renouveler le spectacle habituellement diffusé par les médias et de faire société par écran interposé. Il reste que ces deux exemples de mise en scène de soi ont obéi, par leurs dispositifs, à des logiques opposées. D’un côté, l’accueil du tout-venant pour des interventions au temps limité dans un espace neutre. De l’autre, un film dédié à une unique personne, dont le décor est le chez soi, pour un temps sans borne. Quelles ont été leurs motivations ? A quels usages s’ouvraient-elles ? Traiter ces interrogations nous invite à considérer de plus loin les images personnelles que nous faisons circuler aujourd’hui.

Videomaton : une expérience de parole anonyme à la télévision
Samedi 16 juin 1984, 10h20, sur Antenne 2. Filmés en plan fixe sur fond de store vénitien fermé, des inconnus se succèdent, regardent la caméra, parlent quelques secondes, puis la lumière s’éteint : c’est le moment de céder la place au suivant. Un homme d’une soixantaine d’années, blouson sur T-shirt blanc, regard débonnaire, élocution claire. Il collectionne les 78 tours de chansons interprétées par Damia, chanteuse de café-concert. Certains lui manquent, en particulier « Aimez-vous les moules marinières », alors si quelqu’un veut les lui offrir pour vider son grenier, il les accepte volontiers. N°1. Une jeune fille, cheveux longs, chemise et blouson, visage sage. Elle dit avoir fondée avec une copine de 19 ans une association d’aide aux enfants pauvres dans les villages boliviens. Si d’autres lycéens veulent venir en aide à l’association, ils sont les bienvenus. N°4. Une dame âgée, très maquillée, coloration blonde et bandana, regard tragique et voix cassée : « Je suis seule, je suis trop seule, je voudrais connaître des gens de tous les milieux, de tous les âges. » Un silence et elle ajoute avec détresse : « Contactez Antenne 2 s’il vous plaît ! » Quand la lumière s’éteint, elle se lève en se tordant les mains : elle aurait encore tant de choses à dire. N°5. Un jeune homme, le visage rond chaussé de lunettes à la monture épaisse, chevelure blonde pâle, regard perdu. Les rais noir et blanc de son t-shirt semblent prolonger ceux du store derrière lui. Il tutoie la caméra. Il s’adresse à la personne qu’il aime (un garçon ? une fille ?), qui l’a quitté, il l’a cherché par les gendarmes, par de annonces à la radio, il est venu de Roanne jusqu’à Paris pour faire cette annonce. « En plus du chômage, toi qui te barre, je ne sais plus comment faire. » Il va finir par se suicider s’il n’a pas de réponse. « Appelle-moi ou écris-moi, mais fais quelque chose. » Son dernier regard, de biais, exprime plus de détresse que lorsqu’il fixait la caméra, quand il était encore porté par l’énergie du message à transmettre. N°11. Un jeune homme habillé avec une fantaisie stricte, pull avec col en V et fin nœud papillon, regard clair et pétillant : « Je cherche un château en ruines entre zéro et dix-neuf kilomètres de Paris, en mauvais état, voyez, tout cassé, pas trois pierres dans un jardin. » N°14. Une femme d’une cinquantaine d’années, elle n’a pas quitté son manteau gris épais, sa chevelure est d’un même gris, peignée sans soin, ses traits sont tirés, sa bouche mince fardée fait un trait rouge. Elle lit son message écrit comme un télégramme : « Viens à la maison. Daniel décidé. Viens le plus tôt possible. Maman. » Aussitôt après avoir dit « Maman », elle adresse à la caméra un regard d’une désolation qui ne s’oublie pas. N°15. Un garçon un peu dandy joue une gamme sur une guitare 12 cordes, s’interrompt pour dire qu’il recherche un impresario, puis reprend son arpège appliqué. La lumière s’éteint alors qu’il n’a pas fini de jouer. N°17 [1].
« Une émission faite par vous et qui vous est destinée »
Chaque semaine, du 11 février 1984 au 30 avril 1985, la télévision publique a ouvert un quart d’heure de son programme aux propos libres des inconnus. Ils venaient tels qu’ils étaient pour faire part d’une requête personnelle aux téléspectateurs alors présents devant leurs postes. Ces interventions de tous ordres – annonce de vente ou d’achat, courrier du cœur, avis de recherche, promotion professionnelle… – s’enchaînaient sans ordre sinon celui de leurs venues. Ne dépassant pas les trente secondes, elles étaient livrées telles quelles, sans remontage ni ajout de commentaire. Le nom de l’émission « videomaton » renvoie au « photomaton » dont elle adapte en quelque sorte le principe de prises de vues automatique à l’environnement télévisuel [2]. Au moment où défile le générique du début qui consiste en une animation électronique, une voix féminine explique son principe comme un mode d’emploi affiché sur la paroi d’un appareil public :
Videomaton est une émission qui est faite par vous et qui vous est destinée. Soyez attentifs. Vous allez voir des petites annonces et des messages personnels. Chacun a un numéro. Si l’un d’eux vous intéresse, c’est simple, vous notez le numéro et vous écrivez à Vidéo maton 2 av. Montaigne Paris VIIIe. Nous ferons suivre votre courrier à la personne intéressée.
Comme nous l’apprend l’émission « Moi je » du 30 avril 1985, dont l’un des sujets porte sur le procédé de réalisation de « Videomaton », c’est un car de régie, garé dans l’espace public, à Paris ou en région, qui fait office de cabine de prises de vues. Celles-ci se déroulent pendant des séances de sept heures sur trois jours. Invitée dans l’émission « Un temps pour tout » du 11 octobre 1984, Pascale Breugnot, productrice de « Videomaton » avec Bernard Bouthier, intervient pour en expliquer le principe et informer les téléspectateurs que le « petit camion équipé en studio » de « Videomaton » sera posté au niveau du 60 avenue des Champs Elysées de 11h à 18h les 17, 18 et 19 octobre [3]. Dernier clin d’œil au modèle du photomaton, l’émission reprend son cadre fruste et générique. Eclairé en douche, le sujet est filmé en angle plat et en plan taille. Derrière lui, les lames horizontales du store se sont substitué aux plis verticaux du rideau orange qui occupe habituellement le fond des cabines photographiques.

De la même manière que le photomaton est un photographe mécanique, l’émission « Videomaton » donne l’illusion qu’il n’existe pas d’intermédiaire entre le sujet filmé et la caméra. Le même sujet, dans l’émission « Moi je », consacrée à la fabrication de « Videomaton », révèle que le tournage des annonces était en réalité supervisé par un responsable de la chaîne, sans doute la réalisatrice Nedjma Scialom (qui succède à Richard Rein à partir de l’édition du 20 octobre 1984). Par un montage d’annonces ratées, il fait entendre à plusieurs reprises sa voix, avant ou pendant la prise : « Mettez-vous bien sur le tabouret », « Très mauvais, le trou », « Regardez bien le téléspectateur et allez-y ! » « Restez devant la caméra au moment où vous dites : ‘engagez-moi !’ », etc. Ces instructions adressés à l’inconnu accueilli dans la cabine témoignent du souci de mettre sa prestation aux normes de diffusion télévisuelle (élocution claire, propos cohérent, message intelligible) [4]. Il n’en reste pas moins que, ces interventions étant effacées au montage, l’émission ne laisse voir qu’une succession d’apparitions anonymes et laissées à l’état brut, et c’est dans cette apparente disponibilité et absence de cadre éditorial que gît son projet. Rappelons-nous de la première phrase du commentaire de générique : « Videomaton est une émission qui est faite par vous et qui vous est destinée ». Cette intention de neutralité que traduit l’absence d’artifices dans l’image invite à son appropriation, aussi bien par la personne qui intervient dedans que par celle qui la regarde. Ainsi, « Videomaton » esquisse l’utopie de créer une hétérotopie dans le flux de la télévision française, alors massivement regardée et limitée à trois chaînes – puis quatre à partir de novembre 1984. Elle consisterait en un environnement médiatique universellement accessible, ouvert à un dialogue multipolaire, de gré à gré, en dehors de toute contingence éditoriale.
Sonder la population dans toute la diversité de ses identités et de ses désirs
« Videomaton » pousse la démarche jusqu’à se présenter comme un pur service, une courroie de transmission par la voie unificatrice de la diffusion hertzienne. En fin d’émission, la même voix que celle qui s’est faite entendre à son début rappelle son principe : « Des messages vous ont intéressé ? Vous en avez bien noté le numéro ? Alors écrivez-nous à Videomaton. » Dans l’émission « Un temps pour tout » évoquée plus haut, Pascale Breugnot assure que les réactions du public sont nombreuses et que des appels lancés dans l’une ou l’autre des éditions ont trouvé leurs réponses. Pour autant la vocation de l’émission ne se réduit pas au scénario fonctionnaliste qu’elle s’est donnée. Toujours dans « Un tout pour tout », Pascale Breugnot affirme que « Videomaton » vise autant à « analyser les sentiments » qu’à « rapprocher les cœurs ». Son emploi du terme « analyser » n’est pas anodin. Tout le temps qu’elle a duré, « Videomaton » a sondé la population française dans toute la diversité de ses identités et de ses désirs. Il en ressort cette « archive du temps présent », collection d’instantanés qui, mises bout à bout, capte l’ambiance sociale d’une époque : en ce milieu des années quatre-vingts, vieux, jeunes, femmes, hommes, racontent une France en tension entre deux âges, fascinée par les progrès de la cybernétique et nostalgique du temps de la musette et des bals populaires, excitée par les nouvelles formes de sociabilité permises par les outils de communication, épuisée de solitude dans une ville qui sépare les destins. Par cette quête du portrait collectif, constamment en cours d’une édition l’autre, esquissée au moyen d’un dispositif expérimental, reposant sur une parole intime et émancipée des attentes d’une audience ciblée, « Videomaton » s’inscrit dans un courant journalistique innovant et participatif. Les producteurs qui ont conçu son principe, Pascale Breugnot et Bernard Bouthier, sont également responsables de « Psy show », émission centrée sur les confessions publiques de couples anonymes, et de « Moi je », émission regroupant des documentaires traitant de sujets placés au point aveugle du traitement journalistique courant, comme la sexualité en prison (chez les hommes comme chez les femmes), ou la pratique de l’autopsie, ou encore l’addiction à la télévision dans les foyers populaires. Dans l’émission citée plus haut, « Un temps pour tout », Pascale Breugnot décrit sa démarche comme la promotion d’une forme de télévision « hors les murs » : « L’idée est que la télévision sorte de ses studios et qu’elle aille au-devant des téléspectateurs (…) C’est une télévision de service, de communication directe avant le satellite [5]. » Les émissions conçues par le tandem Breugnot-Bouthier ne sont cependant pas isolées. Des productions contemporaines privilégient également l’enquête sociale centrée sur les pratiques intimes, tels « Que deviendront-ils », réalisé 1984 à 1989 par Michel Fresnel et Hélène Delebecque, ou « L’amour en France », réalisé en 1989 par Daniel Karlin et Tony Lainé.
Mettre le particulier au cœur de la mise en scène
A leur volonté de promouvoir le sujet de société original, voire tabou (la sexualité), ces journalistes à tendance documentariste combinent la volonté d’ériger le particulier au cœur de la mise en scène. Il ne figure plus dans le poste comme le participant d’un jeu ou un témoin d’enquête, mais pour lui-même, et c’est son parcours et ses goûts qui activent le propos du programme. Pour atteindre le même objectif, « Videomaton » développe cependant une autre stratégie que le traditionnel recours au format du reportage ou du débat en plateau. Par son principe qui rompt avec la saisie du réel et emprunte à la démarche de l’art conceptuel, le champ télévisuel devient tout entier investi de la parole et de la présence physique des personnes qui s’y invitent. Sa médiation minimale, dont la contrepartie est l’apparent retrait du discours journalistique, annonce l’évolution que Gérard Leblanc identifie au début des années 90 dans le cinéma documentaire, à savoir « une tendance à la valorisation de l’objectif et à l’évacuation du subjectif derrière l’extension des moyens de saisie du visible (substitution de la caméra au cinéaste.) [6] ». Pour le journaliste en quête d’une prise de parole authentique, il ne s’agit pas de céder sa place mais d’imaginer le moyen de piéger la spontanéité comportementale des différents participants. Le travail d’analyse que propose l’émission, selon le propos de Pascale Breugnot, revient alors à la charge de son public. A lui d’interpréter les postures et les messages qui se succèdent sans commentaire. A lui aussi d’éprouver l’émotion qu’ils inspirent sans qu’elle lui soit explicitée. A cette dimension sociologique en libre-service s’ajoute une dramatisation qui ne s’avoue pas. La succession des passages, mettant en jeu un individu chaque fois différent, que rien n’annonce, constitue une galerie de personnages constamment renouvelée et imprévisible : d’abord le jeune homme chic, ensuite la concierge âgée, après l’illuminé, encore après la cadre quinquagénaire au chômage…. Souvent, l’annonce passée est moins une information (quelqu’un cherche ceci, a besoin de cela) qu’une forme de message où passe quelque chose de soi d’essentiel, voire de vital. A propos de sa conception personnelle du journalisme filmé, Daniel Karlin, réalisateur de « L’amour en France » a affirmé :
On pourrait dire que ma manière de filmer, c’est de la radio assez bien filmée. Ma remarque n’a rien de dépréciative. Serge Daney a écrit à propos de mon travail : ‘Et si, après tout, le gros plan d’un visage de quelqu’un se racontant, c’était aussi et d’abord ça la télévision [7] ?’
Or cette remarque de Serge Daney, s’applique parfaitement au dispositif de « Vidéomaton ». Pure expression télévisuelle, cette émission a cependant tranché avec la production de son temps. En créant les conditions d’une télévision intransitive, par un brutal face-à-face entre ses participants et ses téléspectateurs, elle a tenté de changer le mode de réception de ce média de masses tel que les responsables des chaînes l’avaient jusqu’ici imposé.
La webcam : la vie comme spectacle permanent
Après l’expérience isolée de « Videomaton », il faut attendre l’apparition des sites personnels sur internet pour que les personnes anonymes puissent de nouveau diffuser massivement leur propre image filmée. C’est à la fin des années quatre-vingt-dix qu’apparait sur la toile le phénomène des « webcamés », ces particuliers qui diffusent en continu sur la toile les images prises par leur webcam personnelle. Pour Nicolas Thély, chercheur qui en a étudié les manifestations et le rapport spécifique au spectateur qu’il instaure, c’est la « la pièce maîtresse d’une web-intimité naissante sur le réseau Internet [8] ». Des inconnus ont accédé de cette manière à la notoriété sans avoir eu à se prévaloir de compétence à transmettre ni d’œuvre à exprimer. Jennifer Ringley, connue par son pseudonyme « Jennicam », est aujourd’hui considérée comme une pionnière des youtubeurs, à ceci près qu’elle n’a jamais éditorialisé sa présence selon un savoir ou une expérience dont elle aurait été détentrice, ni fait de placement de produit. De 1996 à 2003, cette étudiante au Ducksinkon College, en Pennsylvannie, diffuse sur internet les images captées toutes les quinze minutes par une webcam pointée vers le lit de sa chambre, et ceci sans interruption, de jour comme de nuit. La plupart du temps, le site « Jennicam » montre une pièce vide, la jeune fille partant pour assister à des cours ou pour d’autres occupations personnelles. Quand elle est présente, on la voit accomplir des gestes banals, lire sur son lit, se brosser les dents, regarder son ordinateur. Mais le spectacle fascine, comme en témoigne la BBC : « « Ce diaporama de l’ordinaire était totalement captivant. Quatre millions de personnes – ce qui représentait alors une bien plus grande proportion des utilisateurs internet– regardaient ses mises à jour quotidienne [9]». Comment comprendre ce besoin de susciter et consommer le spectacle d’une personne qui se montre pour ce qu’elle est, sans autre mobile que manifester sa présence de manière intermittente selon qu’elle pénètre ou non dans le champ de sa caméra postée à dessein ? La motivation narcissique a été pointée dès le moment où l’emploi utilitaire de la vidéo, dans le cadre de l’enseignement ou de la formation professionnelle, a suscité un engouement pour son usage personnel : se filmer non plus pour se critiquer, mais pour se contempler. Avec la diffusion de l’image de soi sur le réseau du net, un enjeu relationnel s’ajoute, propre à une sociabilité par écran interposé, voire un intérêt esthétique par la spectacularisation du banal que suscite un environnement technologique nouveau et encore incertain.

Les nouveaux Narcisses
Avant même l’ère d’internet, des interventions dans les milieux pédagogiques ont mis en garde contre l’excès d’auto-représentation que favorise la démocratisation du film. Ainsi le psychosociologue Philippe Kaeppelin dans son article « Les nouveaux Narcisses – du magnétoscope et de son usage » paru en 1981 dans la revue Education 2000. Avec la généralisation de l’emploi de la vidéo, écrit-il alors, les initiatives d’auto-filmage et de mise en réseau d’images de soi se multiplient à des fins d’autoscopie. Elles sont appliquées aussi bien dans les instituts de formation que les milieux où l’image publique est un enjeu : métiers de la communication, psychologie, pédagogie, politique… Analysant la finalité de ces usages, Philippe Kaeppelin convient qu’ils peuvent « éventuellement faciliter un ajustage de soi-même avec certaines réalités apparentes ». Il peut résulter de l’analyse de sa performance filmée, et de sa remémoration dans la situation réelle, une amélioration comportementale : se présenter de manière plus attractive, parler avec davantage d’assurance, perdre ses tics ou ses réflexes de protection. Cette analyse peut être guidée par un spécialiste, comme en témoigne l’expérience du filmage des groupes « Balint », groupes de parole réunissant des médecins pour qu’ils se fassent mutuellement part de leurs difficultés relationnelles avec les patients [10]. Philippe Kaeppelin observe même que la confrontation à sa propre image est susceptible d’ébranler la confiance de celui qui pensait la contrôler : « Sous l’effet du miroir électronique, un voile imaginaire se déchire. » Mais il ajoute qu’en contrepartie, d’autres personnes peuvent au contraire se sentir valorisées par leur image, et chercher à s’y complaire, à s’abîmer en elle.
La manifestation de certains comportements constitue immanquablement un nouveau voile imaginaire. Un voile, est-ce assez dire ? Un rideau, une panoplie de déguisements, bref de quoi séquestrer les réalités affectives et leur fonctionnement derrière une muraille d’apparences.
Philippe Kaeppelin redoute que par sa pratique répétée, l’auto-filmage devienne fin en soi, découplée de ses finalités performatives, mue par une attirance inavouée pour la découverte et la diffusion renouvelée de sa propre mise en images. De cette dérive naîtrait la diffusion d’une culture, « un imaginaire de la fuite en avant qui nous rendra de plus en plus aveugles sur les raisons de nos modes d’expression [11]. » Près de vingt ans plus tard, la multiplication des webcams personnelles, mettant à la disposition de toutes et tous la représentation de l’individu pour lui-même, représente en quelque sorte l’épanouissement de cet imaginaire stérile.
La réflexion prospective de Kaeppelin tient ensemble le plaisir de se voir et le désir de se savoir vu. La jouissance de soi par l’image que renvoie le « miroir électronique » s’amplifie par sa diffusion. Avant Internet, la télévision a constitué l’environnement de prédilection pour le satisfaire, notamment par les émissions imaginées par Pascale Breugnot dont le principe reposait sur la participation d’inconnus invités à témoigner de leurs vies. Selon elle, leur parole devait permettre aux téléspectateurs qui en prenaient connaissance de se situer : suis-je pareil, différent, en quoi [12] ? Il reste à se demander si la motivation des invités se limitait à ce partage d’expériences. Ce n’est pas le point de vue de Monique Sauvage et Isabelle Veyrat-Masson qui écrivent à leur sujet : « Le français moyen s’expose sans pudeur et sans crainte, la popularité même éphémère acquise à la caméra, est préférable, pour lui, aux risques de l’exhibition [13]. » Accéder à l’arène des plateaux représente une promotion personnelle en attirant ainsi l’attention d’un public dont on a jusqu’alors fait partie. Selon Jean-Louis Comolli, se montrer à la télévision est par ailleurs un moyen de rendre sa vie plus intense en l’extrayant de son cours ordinaire. Dans un entretien judicieusement intitulé « ‘L’autre’ des deux côtés », il insiste sur la frustration que procure le sentiment de mener une vie anonyme et sans relief.
Au moins, on est là on est vus par les autres, on existe devant les autres, et on existe devant soi-même d’une façon peut-être plus forte, plus riche, plus intéressante que quand on est tout seul chez soi devant son bol de café au lait [14].
Le site dans un coin de l’écran
Mais pour les « webcamés », le développement d’internet et son absence relative de cadre en font le nouveau lieu approprié pour opérer cette sublimation de la vie réelle. Dans le programme dont ils ont eu l’initiative, et dont ils restent les maîtres, il s’agit justement d’inclure « le bol de café au lait » dans l’image. Le trivial est un élément nécessaire de la mise en scène du programme, qui se substitue au plateau scénographié et illuminé des chaînes de télévision, voire au sobre volet fermé de « Videomaton ». Montrer l’ordinaire de l’environnement doit escorter l’apparition de la personne filmée, non comme un espace neutre, non qualifié, mais comme un lieu banal qui ferait miroir à celui où évolue celui qui le regarde. Dans un entretien réalisé en 1999 pour fêter les trois ans de « Jennicam », la jeune fille explique qu’elle a été très émue de recevoir un courrier électronique dans lequel un spectateur la remerciait d’avoir montré que, comme lui, elle faisait sa lessive le samedi soir. En manifestant qu’elle n’avait rien de mieux à se proposer à cette heure festive, elle le soulageait de vivre la même situation. La satisfaction de se savoir vu ne tient pas uniquement à une complaisance égotiste, elle se nourrit de la relation créée par le dispositif. Les banalités s’échangent et les solitudes se réconfortent mutuellement par l’interposition de la webcam : « Avec Jennicam, ils mettent le site dans un coin de leur écran, et c’est comme avoir quelqu’un dans la pièce d’à côté [15]. »
Cette empathie que suscite le webcamé relativise le jugement amer qu’Olivier Mongin émet en 2004 en observant l’évolution des pratiques sociales liées aux moyens de communication. Selon lui, la relation hiérarchique entre regardeur et regardé a été modifié par la réduction des frontières entre public et privé et à la disparition du sentiment d’admiration pour les stars qui en résulte. Cette relation à présent nivelée est devenue fatalement conflictuelle. « Aujourd’hui, avec les écrans nouveaux, et pas uniquement de la télévision, dont la principale révolution est d’empêcher l’identification à des stars, il ne reste plus qu’à regarder nous-mêmes à travers le petit écran. (…) Quand on ne voit plus sur l’écran que des projections de soi-même, reste à jouer le rapport de force puisque tout le monde peut prendre la place de chacun [16]. » Au contraire, l’anecdote que conte Jennifer Ringley témoigne de l’émergence d’un sentiment de sympathie collective pour l’inconnu érigé en un unanime point de mire, tendresse complaisante qui s’apparente à celle que le réalisateur Weir avait mis en scène en 1998 dans The Truman show. Cette relation nécessite que la webcam inclue autant que possible dans son filmage les repères communs avec ceux qui la regardent. Cette identification par l’espace – montrer le coin du lit, la tasse de café sur la table, le cintre jeté sur l’oreiller – se redouble dans la dimension du temps. Le récit formé par la répétition des jours filmés doit tendre vers l’uniformisation des situations qui les jalonnent. « Si je n’étais pas normale, ce ne serait pas aussi intéressant » reconnaît Jennifer Ringley. L’effet miroir doit agir sur celui auquel on offre sa propre image, il doit pouvoir s’y reconnaître suffisamment pour l’élire parmi toutes celles qui la concurrencent. Il suppose cependant une disponibilité de soi, voire une mise en exclusivité de soi, que contrarie le fil ordinaire de la vie sociale. Jennifer Ringley décide d’arrêter Jennicam quand les relations qu’elle a nouées avec les personnes vivant autour d’elle entraîne des situations qui ne sont plus partageables avec celles et ceux qui l’observent depuis leur ordinateur [17].
Un « nouvel acteur de la vie scopique »
C’est en suscitant une rencontre virtuelle, susceptible de se transformer en relation du même ordre, que Jennifer Ringley explique l’intérêt qu’elle trouve à diffuser les images de sa webcam personnelle auprès des inconnus. Comment comprendre, cependant, l’attachement qu’ils lui vouent? En quoi consiste cette posture de regardeur qu’il engage ? Repose-t-elle uniquement sur la quête d’une présence humaine sur laquelle projeter sa curiosité, voire son affection, sans avoir à s’engager en retour ? N’entre-t-il pas dans la fréquentation régulière des programmes de webcam un goût pour l’image elle-même, son apparence singulière, son grain, son rythme ? Pour celles et ceux qui ont joué le jeu et regardé les webcamés de manière chronique, cette expérience spectatorielle reste un souvenir sans réplique possible. Aujourd’hui, il parait inenvisageable de regarder régulièrement et durablement ce type d’images alors conditionnées par les limites techniques que connaissait la diffusion de contenus audiovisuels sur Internet. Outre que leur définition est particulièrement pauvre, elles sont contraintes par la fragmentation permanente et irrégulière de leur flux. Enfin, il reste à s’imaginer comment il a été possible de s’intéresser, au-delà du quart d’heure de curiosité, au spectacle d’un bout de pièce où se meut une personne qui, au contraire des inconnus de « Videomaton », agissent sans s’adresser au spectateur, parfois pour l’abîmer dans de longues plages d’inertie.
Dans son livre Vu à la webcam, le chercheur en Esthétique et critique d’art Nicolas Thély interroge :
Comment identifier ce nouvel acteur de la vie scopique qui n’est pas un simple spectateur ni un téléspectateur, cet internaute plus mateur que surfeur, qui reste des heures durant devant son écran sans en tirer quelque chose de véritablement concret [18] ?
Selon lui, vouloir répondre à cette question implique de se confronter soi-même au spectacle continu d’une webcam tout en prenant en note les impressions qu’inspire cette situation. Parmi toutes celles qu’il a identifiées, il choisit de suivre « Cam@home », la webcam d’une jeune femme d’Amsterdam, Corrie. Le beau texte qui en résulte, « Regarder d’un œil neuf », tâche d’articuler la description du film en cours avec celle de ses émotions pendant qu’il le suit. Ses observations concernent le statut particulier du temps et de l’espace dans sa « mise en scène », compte tenu des allers et venues du personnage principal et des aléas techniques lors de sa diffusion. Il remarque que l’attente régulièrement créée par l’absence de Corrie produit chez lui à la fois de l’impatience et un intérêt dramatique pour l’image de la pièce vide.
Conséquence immédiate, l’image devient elle-même attractive, enfin, dans un premier temps, cela créé un suspense (…) Quand l’image est vide, je la perçois comme en attente d’une action à venir, je ne prends pas de plaisir à la regarder telle quelle [19].
Nicolas Thély rappelle que la diffusion de la webcam consiste en des éruptions d’images fixes qui se renouvèlent régulièrement sans qu’il n’y ait de limite de durée imposée à l’ensemble (par un format de séance ou une grille de programme). Par son flux accidenté et « ontologiquement ouvert vers l’infini », la webcam impose de se reposer indéfiniment la question : « et puis après, qu’est-ce qu’elle va faire ? Et qu’est-ce que je rate si je pars ? ». En poursuivant son expérience par-delà la lassitude et les déceptions causées par des gels d’images, Nicolas Thély caractérise le besoin spécifique que crée la fréquentation au long cours de la webcam :
Il faudrait questionner ce nouveau qui se produit presque dans la répétitivité de chaque journée. J’avance ici l’hypothèse du désir de l’inattendu, mais ce n’est pas vrai, ce n’est pas l’insolite ni l’inattendu qui me captive, c’est le renouvellement de la ‘normalité’ avec ces micro-différences [20].
Sans doute le plaisir procuré par la découverte de ces variations du même dépend de la précarité des conditions de visionnement. La progression des images par à coup, au prix de gels fréquents, et la crainte de rater un évènement qui ne reviendra pas, suscitent une fascination du regard en plus de l’attachement affectif qu’inspire la compagnie régulière d’une personne par écran interposé. Ce désir de voir, ici, est intensifié par un effet de direct sans mémoire, la webcam fonctionnant comme un « robinet constamment ouvert » d’images qui s’évaporent. Déjà, en 1981, l’artiste Jacques Ristorcelli, plasticien et pionnier de l’art vidéo, a imaginé un dispositif filmique où une jeune fille filmée se voit par un retour sur moniteur pendant, et non après le tournage : « Elle pourrait se voir sur la télé, filmée… comment dire filmée sans que ça enregistre ? ‘ça passe en direct’. Se voir et non plus se revoir [21]». En quelque sorte, la webcam a assouvi ce fantasme et l’a même installé dans la durée. La vie, devenue direct permanent, produirait un « film absent [22] » qui organise son champ de relations selon qu’on est regardeur ou regardé.

Au milieu des années 80, l’émission « Videomaton » a créé dans la grille des programmes des chaînes publiques un espace d’adresse direct aux téléspectateurs de la part de personnes anonymes, non invitées par la chaîne, mais « qui passaient par là » et ont profité de l’aubaine d’un camion de régi installé sur leur chemin pour faire passer par la télévision un message personnel, que ce soit pour vendre des jouets de collection ou pour lancer le SOS d’une vie en naufrage. A partir de la fin des années 90, l’ouverture de la toile internet à un usage populaire a inspiré des sites de webcams personnels, mettant à disposition de toutes et tous, de manière continue et sans contrôle, l’image de n’importe qui. Deux exemples, à quinze ans de distance, où des inconnus ont investi les médias de masses pour se montrer à d’autres inconnus. Aujourd’hui que nous fréquentons les médiaux sociaux et que nous nous distrayons par la téléréalité, nous pourrions leur concéder le statut, souvent ingrat, de produits précurseurs de ceux dont nous faisons usage. Il faut souligner toutefois des caractères qui leur sont propres et, à ce titre, les figent dans leur temps.
- L’absence de scénario : le pêle-mêle des passages dans « Videomaton », le tout venant des situations dans la webcam en ligne, laissent à chaque fois le public sans le guide d’un récit qui organise et rythme les images, comme le font un jeu avec ses règles, une conférence avec son plan, une histoire avec sa linéarité et son aboutissement.
- L’absence de logique de groupe : c’est le brassage social qui constitue le casting de « Videomaton », et c’est le public d’une chaîne généraliste qui regarde l’émission. La webcam en ligne est le produit d’une initiative solitaire lancée dans un espace non encore compartimenté par les usages de secteurs et de communautés.
Images de formatage inconnu, sans le contrôle d’une structure narrative, circulant hors des réseaux d’affinités électives, fertile en expériences inédites pour le spectateur et en rencontres excentriques pour le citoyen… ne serions-nous pas inspirés de les reconsidérer comme des expériences stimulantes, à mêmes de renouveler le mode de fabrication des discours et des représentations qu’aujourd’hui, chaque jour, nous nous transmettons mutuellement ?
Par Joël Danet – Laboratoire SAGE – UMR 7363 – DHVS – Université de Strasbourg
[1] « Videomaton », diffusion le 16 juin 1984 sur Antenne 2, réal. Richard Rein. Notice INA n° CPB91003441.
[2] Le photomaton est un procédé mis au point par l’ingénieur Anatol Marco Josepho, brevetée en 1924. Le mot qui le désigne est formé à partir de photo et automaton. En 1928, les premiers appareils sont installés dans différents lieux à Paris, dont les Galeries Lafayettes, les locaux du Petit Journal ou le Jardin d’acclimatation. Cf. Clément Chéroux, « La photographie par tous, non par un » dans Quentin Bajac, Clément Chéroux, Guillaume Le Gall (dir.), La subversion des images, Paris, 2009, p. 52.
[3] « Un temps pour tout – les agences matrimoniales », diffusion le jeudi 11 octobre 1984 sur Antenne 2. Réal : Jean-Pierre Spiero. Notice INA n° CPB84057056.
[4] « Moi je », diffusion le 30 avril 1985 sur Antenne 2, sujet « Videomaton » réal. Benoist Dentan. Notice INA : CPB91004891.
[5] « Un temps pour tout – les agences matrimoniales », cf. note 3. En France, en 1984, la généralisation de la diffusion télévisuelle par satellite est encore partielle.
[6] « Interagir » par Gérard Leblanc dans Documentaires, n°8 – engagement et écriture, 1er trim. 1994, p.32.
[7] « Daniel Karlin – ils ont parlé d’amour », entretien avec Jacques Henric, Art press, n°289, avril 2003, p.17.
[8] Nicolas Thély, Vu à la webcam – essai sur la web inimité, Paris, 2002, p.11.
[9] « L’histoire de Jennicam, la première femme à avoir exposé sa vie sur internet » par Grégor Brandy, Slate, 21 octobre 2016 — mis à jour le 21 septembre 2017.
[10] Pour se donner une idée de l’introduction du film dans la démarche du groupe Balint, voir le film Sur les traces de Balint réalisé en 1976 par Eric Duvivier, ainsi que sa notice dans la base de données Medfilm : https://medfilm.unistra.fr/wiki/Sur_les_traces_de_Balint
[11] Philippe Kaeppelin, « Les nouveaux Narcisses – du magnétoscope et de son usage » dans Education 2000 – Audiovisuel, communication, pédagogie, n°20 – novembre 1981, p. 68.
[12] « Rembob’Ina, les grands soirs du petit écran – ‘Privés de télé’ avec Pascale Breugnot », diffusion le 2 février 2020 sur LCP. Notice INA n° : S886485_023.
[13] Monique Sauvage et Isabelle Veyrat-Masson, Histoire de la télévision française, Paris, 2012, p. 176.
[14] « L’autre des deux côtés » – entretien avec Jean-Louis Comolli dans Les carnets de Filmer à Tout Prix, 2004, p. 68.
[15] « Patient zero of the selfie age: why JenniCam abandoned her digital life » sur News.com.au, av. 2015.
[16] « Le grand déballage : quand les stars n’ont plus le droit de faire rêver » par Olivier Mongin dans Esprit n°11, nov. 2004.
[17] “L’histoire de Jennicam…”, op. cit.
[18] Nicolas Thély, op. cit., p. 27.
[19] Nicolas Thély, op. cit., p. 30 et p.33.
[20] Nicolas Thély, op. cit., p. 40.
[21] « Emmène-moi » par Jacques Ristorcelli dans Education 2000 – Audiovisuel, communication, pédagogie, n°20 – novembre 1981, p. 30.
[22] « Emmène-moi », cf. note 19.